Check nearby libraries
Buy this book
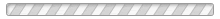
Un livre intitulé : « LES ATOUTS DU COOPERATISME AFRICAIN : Etude prospective de la contribution du système coopératif à la relance économique de l’Afrique Subsaharienne »
A travers cette étude, l’auteur souligne la dissonance entre les valeurs socioculturelles africaines et les fondements de la politique économique que les experts ultralibéraux s’évertuent à appliquer à l’Afrique Subsaharienne en tentant, sans succès, d’universaliser des réformes préétablies à l’ensemble des pays à travers le monde.
Check nearby libraries
Buy this book
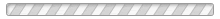
Subjects
Economic conditions, CooperationPlaces
Sub-Saharan Africa| Edition | Availability |
|---|---|
|
1
Les atouts du coopératisme africain: étude prospective de la contribution du système coopératif à la relance économique de l'Afrique subsaharienne
2007, Bureau d'études stratégiques du corps des inspecteurs des finances
in French
2807300456 9782807300453
|
aaaa
|
Book Details
First Sentence
"PUBLICATION COMPLETE DU LIVRE Adresse mail : albertlutete @ yahoo.fr A Madame Docteur NKONDI JULIE et à mes As LUTETE. Dedicated to a large number of Africans who are poverty-stricken and would like to change their lifestyle. AL RETRO LUTETE PREFACE La République Démocratique du Congo (RDC), de par son histoire et sa situation géographique, constitue un meilleur observatoire de l’économie de l’Afrique Subsaharienne et des enjeux de la mondialisation pour cette région. C’est donc de ce pays que l’on peut analyser la réalité du système sociopolitique et économique postcolonial en vue d’appréhender les causes profondes de la déliquescence du continent noir et d’envisager les voies de sortie de crise, notamment une stratégie de transition historique vers une structure de « développement autocentré». Une telle dynamique pourra susciter une véritable révolution susceptible de transformer les structures d’exploitation et d’extraversion économique héritées de la colonisation. Aussi, tous les politiques et les scientifiques devraient s’accorder pour reconnaître la nécessité impérieuse de renforcer la recherche à l’effet de dégager un ensemble d’objectifs, de politiques et de stratégies de développement national. C’est dans cette optique que s’inscrit si heureusement ce travail de Monsieur Albert Lutete Mvuemba, Inspecteur des Finances de son état. En effet, une telle réflexion fouillée sur les atouts du coopérativisme africain, conçue dans une perspective de la contribution du système coopératif à la revitalisation de l’économie sociale au Congo, en cette période de post-conflit où, d’une part, les forces vives réclament un décollage rapide et sûr et, d’autre part, des esprits féconds recommandent la mise en œuvre des modèles endogènes pour un développement autocentré, cette étude tombe à point nommé. Il s’agit en d’autres termes, on ne le dira jamais assez pour le Congo et l’Afrique, de répartir du bon pied, de reconstruire l’identité culturelle aliénée en vue d’en faire le fer de lance de notre développement durable. Loin d’isoler l’Afrique du savoir universel auquel elle fait partie intégrante, il importe de noter qu’universalité ne signifie aucunement uniformité – l’endogénéisation des stratégies et mécanismes de développement lui permet d’affirmer, sans aucun doute, sa personnalité, en y apportant sa précieuse contribution. Stanilas Kabasele notamment, dans son analyse des corrélations entre « Pauvreté et conflits sociaux à Kinshasa », prône la régénérescence des capacités entrées en maquis des lustres comme fondement de lutte contre la pauvreté et ses retombées néfastes en milieu congolais ( ). Monsieur Albert Lutete Mvuemba a élaboré un essai aux fins de relancer le débat sur le choix des institutions et des politiques pouvant contribuer efficacement à l’amélioration dans toutes les sphères de la vie des Africains. L’auteur remonte loin dans l’histoire précoloniale, à travers l’étude des Royaumes d’Ethiopie-Axoum (l’an 1000 av. J.C), de KOUCH (an 800 av. J.C), des civilisations minières d’Afrique méridionale (Ve - XVIIIe siècle) et du Royaume Kongo (XVe – XVIIIe siècle). Il relève que l’Afrique avait déjà atteint le niveau d’organisation étatique fondée sur la solidarité interethnique et visant la cohésion intégrale de la société, le regroupement des communautés autonomes, ainsi que la participation de chaque membre à la vie sociopolitique et économique. Il établit ensuite que l’ascension de l’Afrique a été brutalement arrêtée par la conquête coloniale. En tant que choc extérieur, la colonisation a instauré en Afrique une société capitaliste extravertie au service des intérêts économiques et stratégiques des puissances occidentales. La persistance des structures de domination politique, économique et culturelle, plus de quatre décennies après les indépendances, explique, pour une bonne part, les contre-performances enregistrées par les pays africains sur les plans socioéconomiques tandis que, sur ces entrefaites, l’Asie de l’Est continue sa marche vers le progrès. En effet, l’auteur formule l’hypothèse que l’Afrique ne peut se développer en faisant foi aux structures économiques extraverties qui engendrent notamment la dépendance politique, l’individualisme anarchiste, la confiscation des libertés publiques, les discriminations, l’exclusion et la marginalisation des gens du peuple. Il va sans dire que si les pays africains sont confrontés à de graves crises financières et économiques, c’est surtout parce qu’ils hésitent à s’engager résolument sur la voie des réformes systémiques. Bien pire, les oppressions qui se sont implacablement abattues sur les Africains depuis cinq siècles les ont presque tétanisés tout en détruisant toutes les institutions sociopolitiques et économiques qui consolidaient jadis la participation populaire au travail collectif, la solidarité, la concertation et l’harmonie sociale. Dans ces conditions, le mouvement coopératif n’a pas pu marquer l’évolution des pays africains alors qu’il a eu un impact décisif dans le progrès socioéconomique et politique des pays tels qu’Israël, Danemark, Suisse, Canada et, de nos jours, le Venezuela. Dans ce climat de plus débilitants, l’auteur suggère l’adoption du système coopératif à cette étape de relance économique, afin de conjurer la débâcle de l’Afrique et de parvenir au développement dans la justice sociale, l’égalité politique et dans la solidarité. Dans sa démarche, il intègre, autant que faire se peut, les valeurs humanistes tirées de l’Afrique précoloniale dans la doctrine coopérative en suivant « la pente culturelle africaine » et débouche sur « le coopératisme authentiquement africain ». Dans la dernière partie de cet ouvrage intitulée, à juste titre : « les atouts du coopératisme africain », l’auteur propose une feuille de route réaliste pour l’édification de l’économie coopérative en vue de l’avènement de l’Homo africanus, pétri des valeurs culturelles propres, voué au service de la collectivité et agent du développement endogène de son environnement local. Au moment où les altermondialistes remettent en question les bases du libéralisme économique et de la globalisation qui en résulte, la motivation qui a principalement présidé dans le choix de ce thème est de sensibiliser les peuples d’Afrique Subsaharienne, particulièrement son élite, sur les vertus du système coopératif. Il en appelle à toutes les valeurs traditionnelles et progressistes pour réformer la société postcoloniale de type dualiste en vie d’enclencher la renaissance de l’Afrique après cinq siècles d’obscurantisme et de domination. Sans nul doute, le coopératisme raisonnablement africanisé est à même de contribuer à la relance économique du continent. Son apport pourra être capital aussi bien dans l’introversion des structures socioéconomiques et l’intégration du monde rural, que dans la mutation du secteur agricole, ou encore dans la création d’une classe d’entrepreneurs autochtones, la participation populaire, l’apprentissage de la démocratie, la bonne gouvernance, la formation de la jeunesse ou enfin dans le relèvement de la moralité publique en Afrique Subsaharienne. Cette région pourra, sous les auspices des coopérateurs, renouveler ses institutions, ses mœurs et ses politiques en vue de s’adapter aux conditions techniques et scientifiques nouvelles, dans le respect de sa propre culture. Il convient de retenir que l’apport de cet ouvrage tient au fait que, se basant sur les spécificités et les particularités de l’histoire de la formation économique et sociale congolaise, l’auteur met en relief, après une analyse critique, le rôle prépondérant du mouvement coopératif recentré sur l’âme africaine, susceptible de garantir le cheminement théorique et empirique capable d’assurer le développement de l’économie nationale. Pour un essai, cet ouvrage est suffisamment documenté et peut constituer la base des dissertations plus formelles à promouvoir par les chercheurs des Universités africaines. Les gouvernants, les praticiens de l’économie sociale, les gestionnaires des ONG, des associations mutualistes et des sociétés coopératives pourront y trouver une mine d’enseignements sur l’édification d’une société autrement juste et prospère. C’est dans ce cadre qu’un partenariat vient d’être signé entre HIVA de l’Université Catholique de Louvain et la Chaire de Dynamique Sociale de l’Université de Kinshasa, déterminés à consolider la contribution de la société civile congolaise au développement durable de la nation. Une telle société est celle qui se montrera toujours capable d’inventer des réponses novatrices basées sur le créneau d’endogénéisation en vue d’affronter et de relever, avec succès, tous les défis que lui impose son histoire. Sylvain SHOMBA KINYAMBA Professeur Ordinaire, Université de Kinshasa AVANT- PROPOS A travers l’histoire de l’humanité, les grands courants de pensée ont marqué de manière décisive l’évolution politique, économique et sociale du monde. Des hommes de génie tels que, Saint Thomas d’Aquin, Adam Smith, Karl Marx ou J. M. Keynes ont, à leur époque, largement contribué à l’élaboration des paradigmes de croissance économique et de développement humain. Ainsi, la pensée économique s’est-elle enrichie progressivement de l’apport des diverses Ecoles qui se sont succédées et influencées, tout en s’opposant les unes aux autres. Leurs divergences portaient essentiellement sur les rôles et les droits respectifs de l’individu et de l’Etat dans l’organisation de la société. Joseph Lajugie dans son ouvrage intitulé : « Les doctrines économiques », soutient que la filiation des doctrines et systèmes économiques ne s’est pas faite en direction continue, mais, en quelque sorte, « en spirale ». Des conceptions abandonnées une première fois pour la thèse opposée, ont été ensuite reprises à un degré plus élevé d’abstraction, quitte à être de nouveau délaissées pour la doctrine adverse, elle-même mieux systématisée. Suivant cette dialectique, on est d’abord passé d’un communisme aristocratique, chez les philosophes de l’Antiquité, à l’individualisme libéral des auteurs classiques du XVIIIe siècle. Ensuite, on est revenu au siècle subséquent à une nouvelle forme de communisme, un communisme désormais égalitaire ou tout au moins sans classes. Enfin, l’enchaînement de ces idéologies les unes aux autres, malgré leurs antagonismes, a abouti, sur le terrain de la politique économique, à un rapprochement des mesures pratiques . On assiste aujourd’hui à un véritable brassage des doctrines qui mélange les courants anciens et nouveaux, les influences politiques, économiques et religieuses. Un trait remarquable de cette évolution contemporaine des doctrines économiques est, en effet, la convergence de la plupart d’entre elles vers une sorte d’humanisme économique. Ce concept tend à assurer le développement harmonieux de toutes les personnes humaines qui composent le corps social, en évitant l’exploitation de certaines catégories sociales par d’autres et l’asservissement de l’individu à un Etat oppresseur. Il demande, tout à la fois, que l’homme développe ses forces créatrices, libère son intelligence et restructure sa société aux fins de son épanouissement. Cette démarche scientifique, accélérée dès l’aube des temps modernes, à la Renaissance, devrait amener l’homme à conquérir la liberté de pensée et d’action grâce à la connaissance et à la domination des lois de la nature. Plus que jamais, cette force libératrice est devenue incontestablement la trame de l’histoire depuis le siècle des Lumières (XVIIIe siècle) et plus précisément, depuis la révolution française de 1789 . Nombre de réformateurs sociaux ont, à qui mieux mieux, consacré leurs œuvres à la lutte pour la libération totale de l’homme . Le coopératisme et le néo-socialisme, le corporatisme et le dirigisme, le christianisme social, le néo-libéralisme sont, à de degrés divers, autant de manifestations de ce souci d’assurer, de manière effective, grâce à une certaine organisation de la société, les droits de la personne humaine sur le plan économique . Ce courant humaniste connaît, à l’heure de la mondialisation, une large diffusion en Occident et dans certains pays en développement. Cependant, l’Afrique Subsaharienne reste à la traîne, malgré les nombreuses tentatives, de la part de son élite, d’élaborer des doctrines politiques et philosophiques propices au développement mental, moral, économique et politique de l’homme africain depuis l’amorce du XXe siècle. En effet, dans sa conquête de la souveraineté, l’intelligentsia africaine prôna la négritude, l’africanisme, l’indépendantisme, etc. Après 1960, la nomenklatura autochtone puisa à la même source afin de bâtir le nationalisme, l’authenticité et l’émancipation culturelle. Cet échafaudage fut soutenu par un grand apport d’idéologies étrangères, à savoir le capitalisme, d’une part, le socialisme et le monopartisme, d’autre part. La démarche tendait à s’objectiver, sur les plans économique et social, dans l’exploitation de ressources africaines à l’initiative et au profit des autochtones. A part l’euphorie des années 70, notre continent a connu des déconvenues et des contre-performances qui attestent l’échec des systèmes socioéconomiques et politiques concoctés par les leaders africains sous les auspices des partenaires extérieurs. Force est de reconnaître que les quatre décennies de réformes n’ont pu apporter à l’Afrique Subsaharienne ni croissance, ni stabilité. C’est dire que les idéologies délirantes n’ont pas contribué à galvaniser les masses, ni à libérer leurs énergies créatrices pour le progrès social. Bien au contraire, les nations entières ont été soumises à des cures expérimentales de la part des Institutions de Bretton Woods après la crise de la dette en 1982. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les penseurs indépendantistes ont, à leur corps défendant, renforcé les fondements du néo-colonialisme ou pareillement, pérennisé le système capitaliste extraverti hérité de l’époque coloniale. Face à la débâcle de l’Afrique Subsaharienne, il est d’une nécessité impérieuse de relire son histoire, d’étudier sa culture et sa société traditionnelle afin d’en dégager la nouvelle doctrine pouvant amener l’Africain à reprendre en mains son économie et en tirer parti. Dans la foulée de réformes, les conceptions libérales classiques qui sous-tendent les politiques économiques actuellement en vigueur devraient être reconsidérées. Car il est impossible d’élaborer une théorie et partant une politique économique valable pour tous les temps et tous les pays . Les conditions économiques et sociales étant dynamiques, les systèmes économiques efficients ne peuvent résulter que d’une observation méthodique des faits historiques en vue de dresser un tableau aussi complet que possible de l’activité humaine. C’est pour cette raison que nous avons puisé dans la société traditionnelle africaine et dans son passé colonial, les matériaux appropriés en vue de mener une « étude prospective de la contribution du système coopératif à la relance économique de notre continent ». Mis en chantier au mois de mars 1995, cet ouvrage a connu une longue gestation, laquelle explique que certaines données statistiques soient quelque peu dépassées au moment où nous les mettons sous presse. Nous exprimons notre vive gratitude à nos collègues Inspecteurs Principaux des Finances FUNDJI WATO, KITENGE KISIMBA, KIBAL PWEY MPIAL, NKANKA BOKANGA, SAMOLIA MONOMATO et YEMBA KUMINGA ainsi qu’à l’expert du C.P.C.C. KUTELAMA BATUA qui ont bien voulu corriger le manuscrit et formuler les observations pertinentes en vue de parfaire le texte. Nos remerciements s’adressent à Messieurs Guy MILONGO et Jean-Paul NSAPU qui ont assuré très efficacement la présentation matérielle de cet ouvrage. Que nos amis trouvent également ici l’expression de nos remerciements. Il faut citer notamment LUSONGAMO-KUA-NTUDIKILA, Président de l’Organisation non gouvernementale (ONG) SECURITE ALIMENTAIRE DES CATARACTES, Müller LUTHELO NYUDI, Propriétaire-gérant des établissements NEW AIR BROUSSE, le Révérend Pasteur Paul DIWAMBUENA KIAKU et Donat MADILO KIZEBU. INTRODUCTION A l’aube du troisième millénaire, la situation socioéconomique et politique de l’Afrique subsaharienne est incontestablement critique. Les faits et les chiffres attestent la débâcle de cette région qui, pourtant semblait, au début des années 60, tout illuminée des promesses de lendemains meilleurs pour sa population. L’ambition et l’espoir suscités par les indépendances contrastent donc avec le pessimisme d’aujourd’hui. En effet, le rêve d’ascension s’est évanoui en 1975 après une période de croissance rapide. Dès lors, la situation économique de la plupart des pays africains s’est effondrée à cause de la détérioration des termes de l’échange, d’une part, des mauvaises politiques macroéconomiques, d’autre part. Si indépendantiste que cela pût leur apparaître, l’interventionnisme, mené par des gouvernements par trop modernisateurs, a stérilisé les crédits faciles des années 70 dans des investissements improductifs, ajournant, ipso facto, les réformes des structures socioéconomiques héritées de la colonisation. Ainsi, la marche vers le progrès économique de l’Afrique postcoloniale s’est brisée sur des obstacles majeurs, notamment la faiblesse des institutions publiques, l’inefficacité des politiques budgétaire, financière, commerciale et agricole, l’insuffisance du capital humain et d’infrastructures de base, le cercle vicieux de l’endettement et le déficit chronique du secteur public, l’inadaptation de l’idéologie libérale… Faute d’innovation stratégique, l’Afrique subsaharienne a enregistré des contre-performances économiques comparativement aux pays de l’Asie de l’Est qui ont vu leurs revenus doubler à deux reprises de 1967 à 1992 . Sur le plan social, l’immense majorité d’Africains vivent en dessous du seuil de pauvreté, à la limite de la survie, à telle enseigne qu’ils ne peuvent envisager l’avenir avec optimisme. En désespoir de cause, ils sont enclins à battre en brèche leurs valeurs humanistes traditionnelles pour s’engager, dans une sorte de folie suicidaire, à des guerres interethniques ou interreligieuses, lesquelles menacent de désintégration les Etats postcoloniaux . En vue de conjurer ce scénario catastrophe, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale ont conclu depuis 1985, avec lesdits Etats, des programmes drastiques d’ajustement structurel s’appuyant sur deux piliers, à savoir : la stabilisation économique et la libéralisation des échanges commerciaux par une politique d’ouverture de l’économie et de promotion du secteur privé. Même si, en 1994, une poignée de pays a réussi à stimuler la croissance, le bilan de cette expérience est globalement décevant. La mauvaise application des politiques d’ajustement a exacerbé la contraction de l’activité économique dans notre continent, entraînant, par contrecoup, des coûts économiques et sociaux exorbitants . Ces résultats médiocres signent l’échec des stratégies économiques, des institutions et de la société africaine postcoloniales ainsi que celui de la coopération internationale . Derrière cette déconfiture se profile, en vérité, celle des idéologies libérales que les experts jusqu’au-boutistes des pays industrialisés s’évertuent à appliquer à l’Afrique afin de l’initier à la modernité suivant un modèle copie carbone de l’économie occidentale . Au-delà des faiblesses propres à cette démarche, il est indéniable que les années quatre-vingt ont fait justice des vertus du libéralisme, et sonné le tocsin de la nouvelle crise de la pensée économique . En Afrique, la faillite de l’Etat a relancé le débat sur l’adéquation entre les politiques économiques mises en œuvre, la réalité socioculturelle et les aspirations profondes des populations. Depuis, les politiques, les scientifiques et les praticiens s’accordent à poser un regard critique sur l’histoire économique de l’Afrique aux fins de définir les stratégies devant sortir ses populations de l’ornière. En juillet 1990, la conférence ministérielle des gouvernements africains et de ceux des pays donateurs a adopté à Maastricht une résolution recommandant la réalisation d’études prospectives nationales à long terme . Sur la même lancée, les dirigeants africains et leurs partenaires de l’Union Européenne ont examiné, en février 1995 à Paris, des nouvelles stratégies de développement de l’Afrique, tandis qu’à Libreville, du 18 au 19 janvier 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement africains se penchaient sur le problème de misère des masses, en présence des délégués des institutions internationales. En septembre 2000, 189 pays ont signé la déclaration fixant les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), une série de huit objectifs intégrant des cibles clairement définies pour la réduction de la pauvreté et d’autres sources de privations humaines. Par la suite, une réunion de suivi des leaders du monde entier s’est tenue à Monterrey (Mexique) en mars 2002. Il s’en est dégagé un consensus sur les stratégies, politiques et responsabilités mutuelles dans la poursuite desdits objectifs : les pays en développement se doivent d’améliorer la gouvernance et les pays développés se sont engagés à relever le niveau de l’aide publique au développement et à ouvrir leurs marchés . Ces mêmes questions ont été soulevées en 2002 à Johannesburg, lors du sommet mondial pour le développement durable et ont fait, depuis l’année 2001, l’objet des sempiternelles négociations du cycle de développement de Doha. Parallèlement, les Présidents sénégalais, sud-africain, algérien et nigérian ont, au terme d’un long processus, conçu et mis en branle la nouvelle stratégie pour le progrès de l’Afrique. Basé sur un nouveau partenariat pour le développement, le NEPAD sous-tend la réalisation de l’Union Africaine. Partout à travers le monde, depuis les manifestations de Seattle en décembre 1999, et par la suite, celles de Washington, Prague, Davos, New York, la société civile internationale profite des sommets de l’OMC, du G8, des institutions de BRETTON WOODS et du Forum économique mondial, pour dénoncer les abus de la mondialisation et du libéralisme économique. Elle réclame l’ouverture de débats publics en vue de la recherche de solutions à tous les problèmes essentiels de l’humanité : économie, politique, environnement, sécurité alimentaire, niveau de vie des populations du tiers-monde… L’édition 2002 du « World economic forum » a, qui pis est, mis à nu les contradictions entre les dirigeants économiques et politiques des pays riches et les tenants de l’anti-mondialisation, aboutissant à l’institutionnalisation du Forum social mondial à Porto Alegre. Les deux démarches économiques et sociales sont-elles devenues inconciliables ? Cette évolution historique impose à chaque Nation l’organisation d’un forum sur les possibilités de croissance durable afin d’arrêter un ensemble réaliste d’objectifs, des politiques et d’actions pour la relance économique . C’est sur ces entrefaites que la Banque Mondiale et le FMI ont enclenché, dans les pays africains, le processus d’élaboration des documents propres de stratégie pour la réduction de la pauvreté des masses. La nouvelle approche a pour objectifs une plus grande internalisation des politiques et une collaboration renforcée entre tous les partenaires au développement. Le présent ouvrage s’inscrit dans le cadre de ce bouillonnement de la pensée économique visant la recherche de la meilleure voie du démarrage de l’économie africaine, après l’échec de deux tentatives marquantes : la colonisation et le dirigisme postcolonial. A cet effet, il paraît nécessaire de mener une analyse systématique des Etats africains contemporains, en relevant leurs fondements socioéconomiques et politiques ainsi que leurs modèles de gouvernement aux fins de dégager les contraintes internes et externes de leur développement. Par ailleurs, une étude ontologique du coopératisme et de la société africaine précoloniale débouche sur le système coopératif typiquement africain consacrant, en fait, la renaissance de l’Afrique traditionnelle après cinq siècles d’obscurantisme . Notre propos est d’examiner, de manière prospective, l’apport de la doctrine coopérative aux politiques et stratégies de relance économique de l’Afrique Subsaharienne. Aussi, notre étude s’articule-t-elle autour de trois parties énumérées ci-après : 1. les notions générales sur le système coopératif ; 2. la problématique du passage de la société traditionnelle africaine à l’économie moderne ; 3. les atouts du système coopératif africain. Enfin, nous tirons la conclusion à la fin de l’ouvrage en vue de synthétiser la réflexion et suggérer quelques orientations stratégiques. PREMIERE PARTIE LE SYSTEME COOPERATIF CHAPITRE PREMIER : NOTIONS GENERALES SUR LE SYSTEME COOPERATIF Cette partie liminaire est consacrée à la définition des traits caractéristiques de la société coopérative. Il y est également question de la description du coopératisme, de son historique, de sa philosophie et de son apport dans l’essor économique des différents pays. 1.1. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES D’UNE SOCIETE COOPERATIVE Il n’est pas aisé d’élaborer une définition universelle d’une société coopérative. Pour résoudre cette difficulté, nous procédons à l’analyse descriptive de chaque catégorie de coopérative . De prime abord, une société coopérative est un groupement de personnes qui mettent en commun leurs ressources en vue de réaliser ensemble un objet défini. En tant que société, elle constitue un être juridique distinct de la personne de ses membres et est dotée de la capacité civile. Elle a un nom, c’est-à-dire sa dénomination sociale, un domicile, son siège social, un patrimoine propre qui ne se confond pas avec celui de ses membres et une durée de vie, qui est, en principe, celle fixée par les statuts constitutifs . Sur le plan doctrinal, la coopérative se caractérise par le fait qu’elle ne recherche pas systématiquement à réaliser un profit, mais à assurer une coopération effective entre ses membres par les services qu’elle leur rend et par les justes prix qu’elle pratique . En fait, le but poursuivi en constituant une coopérative est de parvenir à une réduction des coûts des biens et services en supprimant le profit capitaliste et la surenchère des intermédiaires, à seule fin d’assurer le bien-être de ses membres, et ce, dans toutes les branches de l’activité humaine . Sur le plan formel, la coopérative peut être une société commerciale ou une société civile, selon son objet. Ainsi, une société coopérative est commerciale lorsqu’elle fait habituellement des actes de commerce : assurances, crédit … Elle est alors soumise aux règles du droit commercial . Dans le cas contraire, la société coopérative est civile. On peut ranger sous cette forme, les coopératives agricoles et les coopératives de consommation, car si elles achètent et vendent des marchandises, elles ne les font pas dans un but spéculatif, de sorte que leurs actes ne constituent pas des actes de commerce au sens du code de commerce, sauf quand elles revendent leurs produits non seulement à leurs adhérents, mais aussi à des tiers . En tant que société civile, la coopérative est régie par le droit civil. A la lumière de ces considérations juridiques, nous pouvons définir une coopérative commerciale comme étant une société qui fonctionne sous une dénomination sociale, avec sept associés au minimum n’ayant pas la qualité de commerçants, pouvant se retirer à tout moment ou être exclus, et dont l’étendue de responsabilités peut être librement limitée sinon illimitée, et dont les parts, nécessairement représentatives du capital exprimé sont incessibles aux tiers . Une coopérative civile, quant à elle, est plutôt une association de personnes constituée pour un objet précis. Pour mieux appréhender la doctrine du coopératisme, il convient de faire un aperçu historique de ce mouvement. 1.2. HISTORIQUE DU COOPERATISME L’histoire du coopératisme commence en 1844 à Rochdale, en Angleterre, avec la fondation, par 28 ouvriers tisserands, de la « société des équitables Pionniers de Rochdale ». En constituant la première coopérative de consommation de l’histoire, les pionniers étaient animés du désir d’établir des nouveaux rapports économiques basés sur le service et non le profit ; sur l ‘entraide et non sur les rivalités ; sur les valeurs et les besoins humains et non sur la possession du capital . Ils eurent le mérite de dégager, dès cette époque, les règles fondamentales du système coopératif. A l’instar des Pionniers, les premiers penseurs du coopératisme songèrent, avant tout, aux intérêts et au sort des populations urbaines. Robert OWEN, le docteur William KING, Charles FOURIER et les autres coopérateurs voulurent, par l’action coopérative, améliorer la situation sociale de l’ouvrier, de l’artisan, de tous ceux qui furent les victimes du jeune capitalisme triomphant. Seul, Friederich RAIFFEISEN s’inquiéta du sort des paysans accablés de dettes et courbés sous des taux d’intérêts exorbitants dans le milieu rural. A l’origine, il n’y eut qu’une poignée de coopératives gérant un volume d’activités marginales. Elles éprouvèrent beaucoup de difficultés à se faire connaître des cercles officiels. Pour les représentants de la victorieuse économie capitaliste, les coopératives représentèrent bien plus l’ultime recours des désespérés que des entreprises respectables. Toute allusion au fait qu’elles eussent pu jouer un rôle influent ou décisif dans les rapports économiques fut qualifiée de vœu pieux et jugé parfaitement utopique, eu égard aux réalités socioéconomiques d’antan. A cette époque, deux types de coopératives œuvrèrent respectivement dans les secteurs du crédit et de la consommation, avec quelques milliers de membres, uniquement en Europe Occidentale. En France, les statuts des différentes catégories de coopératives ont été élaborés au cours de la période 1830 - 1920 suivant la chronologie ci-après : - le 10 décembre 1915, promulgation de la loi relative aux sociétés coopératives de production ; - le 13 mars 1917, avènement des banques populaires ; - le 07 mai 1917, réglementation du crédit aux coopératives de consommation ; - et le 5 août 1920, organisation formelle des coopératives agricoles et du crédit mutuel agricole . Au fil des années, les coopératives se frayèrent un chemin jusqu’aux régions les plus reculées et gagnèrent les groupes les plus isolés, tels que les aborigènes australiens, les Esquimaux du Canada, les Indiens des Andes… En outre, tous les secteurs de l’économie s’ouvrirent à ce genre d’entreprise. Les coopératives connurent une grande expansion malgré les accusations et les attaques dont elles furent l’objet de la part des petits boutiquiers et grands négociants, des usuriers et banquiers, des industriels et grossistes, tant et si bien que le nombre d’adhérents représenta 11,3% de la population mondiale en 1964. Le mouvement coopératif s’internationalisa par la fondation de l’Alliance Coopérative Internationale (A.C.I.) en 1895 à Londres. Ni les changements, ni les révolutions, ni les guerres mondiales ne freinèrent le développement du mouvement coopératif. Bien au contraire, l’idée coopérative conquit le monde entier : les Nations Unies, les congrégations religieuses, les personnalités éminentes, les politiciens influents et les révolutionnaires appuyèrent l’idéal coopératif. Après leurs indépendances, les mouvements coopératifs des pays anciennement colonisés s’affilièrent à l’ACI qui connut une nouvelle période de croissance. Au-delà, il est vrai que les coopératives se sont régénérées au niveau mondial par la responsabilité de leurs membres et par la viabilité commerciale accrue. Aussi, ont-elles bénéficié de l’appui de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) qui a adopté en 2002 la recommandation n° 193 relative à la réforme et la promotion du système coopératif. Les gouvernements et les partenaires sociaux ont été appelés à soutenir le développement des coopératives fortes, autonomes et viables sur le plan financier. Dans le cadre d’une autre initiative, l’OIT s’est jointe à l’ACI pour lancer l’opération « coopérer pour sortir de la pauvreté », une campagne mondiale de coopération qui est le résultat d’un partenariat continu entre les deux institutions . Plus d’un siècle de vie du mouvement coopératif a permis à ce dernier d’affiner sa philosophie telle que nous l’examinons dans les lignes qui suivent. 1.3. PHILOSOPHIE DE LA COOPERATION A cette étape de notre étude, nous relevons les principes qui sous-tendent la philosophie de la coopération en vue de mettre en exergue les idées, les sentiments, les dispositions, les intentions, bref, l’esprit qui anime l’action coopérative. 1.3.1. Philosophie de la coopération Le système coopératif est fondé sur quatre principes, à savoir : l’adhésion libre, le pouvoir démocratique, la répartition du trop-perçu proportionnellement aux opérations et la limitation du taux d’intérêt du capital primitivement versé. 1°) L’adhésion et la démission libres La société coopérative est ouverte à toute personne qui désire y adhérer pourvu qu’elle remplisse les conditions prévues par les statuts, accepte de mettre en pratique la philosophie coopérative et assume volontiers les responsabilités inhérentes à la qualité de membre. Aussi librement qu’il adhère, tout membre peut, de son plein gré, se retirer de la coopérative en respectant les dispositions statutaires. Le principe de la « porte ouverte » garantit la participation, dans l’action de développement, de tous les résidents d’une cité, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur ethnie, leur tribu, leur religion… Ainsi, les coopératives affichent leur neutralité en bannissant toute discrimination dans le recrutement de leurs membres, pas plus qu’elles n’acceptent de servir des fins politiques, religieuses ou tribales parce qu’elles ont leurs propres principes, leur propre philosophie et poursuivent leur voie propre en toute indépendance. 2°) Le pouvoir Démocratique Tous les associés d’une coopérative sont placés sur un pied de stricte égalité. Dans les assemblées générales où sont prises les décisions, un homme a une voix quel que soit le nombre de parts sociales détenues. Etant donné que les membres disposent des droits égaux, le mouvement coopératif ne risque pas d’être détourné au seul profit de membres riches ou des plus anciens. En tout état de cause, la coopérative est créée par ses membres et pour ses membres. Toutes les décisions s’y prennent par ces derniers en conformité avec les principes coopératifs, sans avoir à tenir compte des autorités étatiques, ni des partis politiques. Le principe « un homme, une voix » instaure la démocratie au sein des structures coopératives tant il incite aux débats d’idées et à la compétition loyale entre les membres aux fins de l’émergence des dirigeants les plus méritants. 3°) La répartition du trop-perçu proportionnellement aux opérations A la fin de l’exercice comptable, après règlement des frais, la constitution des réserves et le paiement d’un intérêt statutaire limité sur les parts sociales et sur l’épargne des membres dans les coopératives de crédit, l’excédent des recettes par rapport aux dépenses est réparti sous forme de « ristourne » proportionnellement aux quantités de produits apportés par chacun des membres, ou au travail qu’il a fourni, aux achats qu’il a effectués, aux intérêts qu’il a payés, ou aux services dont il a bénéficié. Néanmoins, en cas de dissolution de la coopérative, le boni de liquidation est remis, sans contrepartie, à d’autres coopératives ou à des œuvres sociales, après remboursement aux associés de la valeur nominale de leurs parts. 4°) La limitation du taux d’intérêt sur le capital primitivement versé Les coopératives ont un caractère non lucratif, partant, elles excluent le profit de leurs opérations. Leur ambition est de transformer le profit en revenu parce que le profit ne repose sur aucun fondement moral et ne découle d’aucune justification économique. Au contraire, le revenu, qui est le fruit du travail, est intrinsèquement honnête et justifié, même s’il est très élevé. Aussi, les parts sociales détenues par les membres ne rapportent-elles que des intérêts limités. Cependant, le niveau du taux, quoique assez bas, doit tenir compte strictement du coût d’opportunité, c’est-à-dire du revenu que les parts sociales pourraient générer si le capital qu’elles représentent était placé dans le système bancaire. Les quatre principes susévoqués constituent l’essence d’une vraie société coopérative et conditionnent l’efficacité de son action. C’est dire qu’à contrario, toute coopérative qui ne respecterait pas ces principes ne pourrait être qu’une société commerciale à but lucratif opérant sous le couvert d’une coopérative. L’observance de ces principes témoigne donc, dans le chef des coopérateurs, d’un esprit coopératif. 1.3.2. Esprit coopératif L’esprit coopératif consiste en deux attitudes qui traduisent les piliers psychologiques de la structure coopérative tout entière. Il s’agit du « self-help » et de l’entraide. Le mot « self-help » n’a pas d’équivalent adéquat en français. Il signifie approximativement, effort personnel ou aide à soi-même. C’est à juste titre que les experts en cette matière ont consacré l’expression anglaise. Pour le peuple, le « self-help » se manifeste dans l’union des forces, la prise en main de ses affaires, la résolution par lui-même de ses problèmes en comptant les uns sur les autres et en partageant les risques liés auxdites affaires. Pour l’individu, cela implique l’adhésion volontaire, l’engagement moral à concentrer au sein de l’entreprise coopérative ses affaires, aussi bien que la participation aux activités de la coopérative, la prise des décisions conjointement avec les autres membres, la responsabilité partielle envers eux et le contrôle réciproque. L’entraide est le prolongement du « self-help ». Elle s’exprime à travers la devise : « tous pour un, un pour tous », en ce qu’elle requiert de la part de celui qui veut être aidé d’offrir d’abord son assistance. Pour tout dire, il s’agit de l’aide qui engendre l’aide . Dans la pratique, l’esprit coopératif mène au regroupement de tous ceux qui ont des besoins communs et qui ont décidé d’y faire face par des actions communes. L’union entre les coopérateurs est cimentée par les liens communs : lieu de résidence ou de travail, profession, problèmes ou besoins identiques… Lorsque les coopérateurs sont pleinement imprégnés de cet esprit, il est facile de développer l’action coopérative. Inversement, lorsqu’il fait défaut, les chances de succès de cette entreprise sont fort minces . En fait, l’esprit coopératif induit des changements révolutionnaires dans les rapports économiques et sociaux. Il modèle, d’une part, la vision que les hommes ont du monde, de la vie, de leurs difficultés, et d’autre part, la manière d’agir et de rechercher des solutions à leurs problèmes socioéconomiques. Dès lors, la révolution coopérative exalte les valeurs telles que la foi, l’amour, la confiance, l’honnêteté, le travail, la solidarité, l’entente, la responsabilité… En dernière analyse, le progrès coopératif ne se réalise que dans un contexte où les principes, la philosophie et l’esprit coopératifs sont respectés. Ce climat psychologique est l’élément catalyseur de l’édification du système coopératif. 1.4. LE SYSTEME COOPERATIF OU L’ECONOMIE COOPERATIVE Dans cette section, nous traitons de l’édification du système coopératif avant de le comparer, tour à tour, au capitalisme, au socialisme et au communisme . 1.4.1. Edification du système coopératif Les coopératives peuvent être créées dans toutes les branches de l’activité humaine. Traditionnellement, elles ont exercé leur action dans les secteurs essentiels, à savoir : l’agriculture, l’artisanat, la production industrielle, les mines, le logement, le transport, la distribution des biens et du crédit… Plus tard, la coopération s’est étendue à des domaines nouveaux : éducation, culture, loisirs, services sociaux, gardiennage… Néanmoins, on ne peut parler du système coopératif ou de l’économie coopérative que lorsque les coopératives, au bout d’un processus de développement, s’installent dans les principaux secteurs de l’économie et y occupent une position déterminante. Il n’est pas nécessaire, pour ce faire, qu’elles remplacent toutes les autres formes d’entreprises, ni que tout le monde soit groupé dans les coopératives. Mais, il suffit de développer à grande échelle un système intégrant verticalement et horizontalement les coopératives des différents secteurs . Cette hypothèse paraît réalisable du fait que les coopératives, bien qu’étant des petites entreprises, s’assemblent souvent dans les unions ou fédérations afin d’éviter que leur développement soit entravé par un morcellement excessif. Les unions sont généralement constituées sur le plan local ou régional entre des coopératives de même nature, appartenant au même cadre professionnel. Elles permettent aux coopérateurs d’accroître leur influence sur le marché afin d’obtenir des meilleures conditions. Les fédérations, par contre, groupent, soit des unions, soit des coopératives sur le plan national. Elles ont essentiellement des buts de propagande, d’éducation et de défense des intérêts corporatifs. A cet effet, elles disposent des services juridiques et de documentation en vue de renseigner utilement les coopératives membres de la fédération . A la vérité, l’édification de l’économie coopérative repose d’abord et avant tout sur les membres, les coopérateurs ; elle dépend de leur activité, de leur zèle, de leur dévouement à la cause commune, de leur participation aux affaires coopératives, de leur persévérance. Car, une coopérative ne peut réussir, progresser et prospérer que si ses membres ont besoin d’elle, la soutiennent, la gèrent et la contrôlent. Toutefois, le développement du système coopératif relève également de l’Etat, de sa politique. Mais, tout compte fait, cette politique est tributaire elle-même de l’attitude des coopératives, de leur organisation, de leur dynamisme et de leurs objectifs. 1.4.2. Le coopératisme et les autres systèmes Par-delà les ressemblances avec le capitalisme, le socialisme ou le communisme, le coopératisme est un système autonome, forgeant son propre destin par la simple mise en pratique de ses principes. Il est intéressant d’établir un parallèle entre ces systèmes, deux à deux. 1.4.2.1. Le coopératisme et le capitalisme Le capitalisme a pris naissance dans les villes italiennes du Moyen Age, vers le XVe siècle. Il est basé sur la propriété privée du capital, l’initiative individuelle et la recherche du profit. Les fondements du capitalisme contrastent avec la philosophie, l’esprit et les principes coopératifs. Ces dissemblances peuvent être résumées en cinq points ci-après : 1° Dans le système capitaliste, la propriété est l’élément dominant, et le capital est le maître. De manière autonome, les entrepreneurs capitalistes affectent, à qui mieux mieux, leurs ressources dans les activités de production et de distribution suivant les seuls calculs avantages-coûts ; le bien-être général n’étant pas leur préoccupation. Ce processus individualiste est censé garantir le progrès et la prospérité dans une ère de la technologie et de la modernité. Dans la perspective d’une telle idéologie de progrès, l’individu, loin d’être sociable, se suffit à lui-même et a pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance de biens terrestres. Cela a favorisé, dans les débuts de l’ère industrielle comme plus tard sous le régime de l’apartheid, une répartition inégale des richesses, à tel point que les travailleurs se sont retrouvés exclus de l’accès aux biens essentiels qu’ils avaient contribué à produire et auxquels ils avaient droit. A l’inverse, l’économie coopérative fonde son existence sur l’élément humain, sur la participation et non sur la propriété. De fait, les membres de la coopérative sont les maîtres ; le capital est relégué au rôle de serviteur tandis que la propriété privée acquiert un rôle social à jouer . La tâche primordiale est d’organiser les hommes qui désirent les services de l’entreprise coopérative et non de rechercher les actionnaires pour le partage d’éventuel profit. Ainsi ce système restitue-t-il leur dignité aux valeurs humaines en rétablissant l’être humain dans son rôle moteur de l’économie, contrairement au capitalisme qui, à force d’aduler la compétition et la dimension financière et économique de la vie collective, déshumanise la vie dans l’entreprise. Et pourtant, l’homme a besoin d’un ordre social juste et équitable pour la réalisation de sa libre personnalité . 2° Dans une entreprise capitaliste, les hommes sont au service du « capital » et travaillent en échange d’une rémunération fixe. Le résultat de l’activité économique appartient au capital ou à son propriétaire. Mais, en vertu des principes coopératifs, le capital obtient une rémunération fixe, un intérêt limité ; le résultat de l’activité économique revient aux coopérateurs eux-mêmes. La doctrine coopératiste sert donc les intérêts des populations sans exclusive tandis que le capitalisme reste une doctrine de classe, celle de la bourgeoisie. 3° Le capitalisme se caractérise par la recherche du profit ; les firmes capitalistes instrumentalisent leurs clients pour consolider leur capital et pour améliorer la position socioéconomique de leurs propriétaires. Le profit et le prix constituent, dans cette optique, les motivations des opérateurs économiques et, assurent, dans l’ensemble de l’économie nationale, une meilleure allocation des ressources entre les différents secteurs en vue de la consolidation du bien-être général. Le capitalisme rime ainsi avec l’individualisme. L’homo oeconomicus, le modèle de l’agent économique, poursuit systématiquement son intérêt personnel, sans entraves, dans un environnement de libre concurrence . Par contre, la caractéristique fondamentale de l’économie coopérative est la suppression systématique et inconditionnelle du profit. Cela se fait par la limitation des intérêts sur les parts sociales et la restitution aux membres de ce qu’ils auraient payé en trop ou obtenu en moins, c’est-à-dire par la vente au prix coûtant. Le coopératisme trouve injustifié le profit tiré par le capitaliste, mais encourage, toutefois, l’aspiration bien humaine à un revenu élevé. Il n’accepte non plus de travailler à perte parce que les coopérateurs se liguent pour obtenir la valeur réelle de leur argent en marchandise ou en services, sans y ajouter un profit inexplicable. Il en est de même des vendeurs, producteurs, artisans, paysans ou autres qui obtiennent la valeur réelle ayant cours sur le marché sans que cette valeur ne soit diminuée par le profit prélevé, par surcroît, par l’intermédiaire ou par l’employeur capitaliste. En outre, la réalisation dudit revenu ainsi que sa redistribution se font en toute transparence, en fonction des efforts productifs de chaque coopérateur, dans un environnement débarrassé de l’égoïsme et de l’individualisme . 4° L’activité de l’entreprise capitaliste ne transforme pas le statut social de ses usagers. Ils restent clients, acheteurs, vendeurs ou ouvriers, ayant des intérêts divergents et antagonistes. Dans ce système, l’actionnariat des ménages demeure un leurre, tant les droits de petits actionnaires sont constamment bafoués par les grands argentiers. La conspiration contre les intérêts de petits sociétaires se révèle souvent à l’occasion des offres publiques d’achat ou de scandales financiers à l’instar de la faillite frauduleuse de la société ENRON aux Etats-Unis. Manifestement, le modèle capitaliste industriel conjuguant le libéralisme et le machinisme ne peut aller sans créer un clivage de la société en deux classes opposées : le cercle des capitalistes et le prolétariat. Ainsi, le progrès social entraîne inévitablement une certaine agitation sociale . Même au sein du groupe d’entrepreneurs, la morale n’a plus cours et la concurrence n’est souvent pas loyale : tous se battent à couteaux tirés, en rognant les coûts et en jouant les coudes, utilisant les licenciements comme l’ultima ratio. Delà à croire que la montée à travers le monde des rivalités, de la xénophobie, du racisme et de toutes sortes de discriminations reste liée à l’impérialisme et, donc, à l’évolution normale du système capitaliste. Conscientes de ce risque d’implosion, les sciences sociales modernes, notamment le management, obligent insidieusement la classe ouvrière à rejouer la loi de la jungle en cherchant à lui faire adopter les intérêts du patron, ce qui est une formidable naïveté doublée d’un contresens historique . Ainsi, les grands et rapides changements de l’époque contemporaine posent à l’humanité un défi : celui de mettre les conquêtes scientifiques et techniques, la production de la masse ouvrière, l’entreprise et toutes les structures économiques, sociales et politiques au service des vraies finalités humaines. Pour sa part, le développement coopératif opère de nombreuses transformations, nullement limitées au seul secteur économique, mais qui s’étendent aux domaines social, moral, philosophique, politique et éducatif. En participant aux activités d’une coopérative, tout membre acquiert un nouveau statut social ; il devient copropriétaire de la coopérative et entrepreneur avec un rôle social nouveau, plus important et plus responsable. De fait, ses intérêts s’identifient à ceux de l’entreprise dont il est désormais un intime. Cette fusion d’intérêts peut même être totale comme dans le cas des Kibboutz israéliens. Le processus de croissance économique est, en l’espèce, harmonieux, résorbant bien de frictions inhérentes aux mutations sociales. De même, le mouvement coopératif contribue à améliorer le standard éducatif et moral des populations pour en faire des agents de développement et de défense des droits civiques. Sans nul doute, de par leur participation aux activités coopératives, leur soumission aux normes coopératives de gestion, leur assistance aux assemblées démocratiques, leur information objective sur les problèmes socioéconomiques nationaux et locaux, leur contribution à la diffusion d’un savoir et de techniques directement applicables à l’échelle locale, les coopérateurs acquièrent le sens de responsabilité, la confiance en eux-mêmes et la solidarité permettant à chacun de s’élever à une pleine vie personnelle et, tous ensemble, à améliorer leur productivité et leurs revenus . 5° Le capitalisme est un adversaire de la propriété et de l’économie publiques. En effet, la doctrine libérale fait l’apologie du libre-échange, d’une liberté illimitée n’admettant aucune intervention des pouvoirs publics, même en faveur des classes déshéritées. C’est la conception de l’Etat-gendarme, producteur de sécurité . Quoiqu’une coopérative authentique ne puisse être une propriété publique, la coopération ne s’oppose pas aux entreprises publiques. Bien au contraire, elles peuvent collaborer, s’allier et marcher, la main dans la main, contre la spéculation et les abus du marché. 1.4.2.2. Le coopératisme et le socialisme A la fin du XIXe siècle, apparut le courant socialiste dont le fondement théorique est le marxisme. Malgré quelques divergences sur les méthodes et sur la nature du régime à instaurer, toutes les tendances socialistes s’accordent à lutter contre le capitalisme et son fondement essentiel : la propriété privée. Le Manifeste du Parti communiste fut pendant longtemps à la base de l’action socialiste. Selon cet document, le socialisme est la première étape avant la seconde, définitive, qui est le communisme. Mais au cours de la première guerre mondiale, se produisit la rupture entre le socialisme et le communisme consacrant l’existence de deux mouvements distincts. Cependant, si le coopératisme présente quelques ressemblances avec le socialisme, ils divergent à plus d’un titre. En ce qui concerne les similitudes, nous pouvons énumérer les points suivants : 1° Origine idéologique commune Le socialisme et la coopération ont des origines communes. Ils sont issus des mêmes conceptions idéologiques et ont subi tous les deux l’influence des premiers défenseurs de la justice sociale : « les socialistes utopistes ». 2° Tendance aux transformations sociales Les deux mouvements poursuivent des objectifs sociaux, à savoir, l’amélioration du sort des couches sociales opprimées, mécontentes et désespérées. D’après Marx et Engels, la transformation sociale est inéluctable parce qu’elle est la conséquence logique des contradictions internes du régime capitaliste, alors que les socialistes utopistes, volontaristes, spiritualistes et réformistes croient au pouvoir souverain de la volonté humaine pour modifier progressivement les institutions économiques. Quant aux coopératistes Buchez (1831), Charles Gide, Schulze–Delitsh, Raiffeisen et les Equitables Pionniers de Rochdale (1844), une révolution économique ne doit pas adopter spécifiquement la doctrine socialiste . 3° Des bases humaines Ils tirent, tous deux, leurs forces du peuple, en particulier de ceux dont les moyens sont limités parce qu’ils s’appuient sur la puissance qu’acquièrent les gens grâce à leur nombre et à la valeur qu’ils possèdent en tant qu’êtres humains. Pour ce faire, le socialisme organise les masses dans des partis socialistes, le coopératisme les regroupe au sein des coopératives. 4° Une foi absolue en la démocratie Le socialisme et le coopératisme ont besoin de la démocratie pour prospérer mais contribuent également à sa construction. Ils cultivent l’esprit démocratique dans les milieux de ceux qui sont souvent en butte aux difficultés et dont certains, en désespoir de cause, deviennent des proies faciles aussi bien pour la dictature que le communisme, et se laissent prendre au piège de leurs promesses mensongères. Ils suscitent le respect et la conscience de soi-même parmi ces gens en leur apprenant qu’un avenir plus heureux ne les attend que s’ils protégent, défendent et renforcent les libertés publiques mais non s’ils les perdent ou capitulent devant des dictateurs totalitaires, qu’ils soient de gauche ou de droite. 5° L’internationalisme L’unité, l’égalité et la fraternité entre les peuples et les nations sont les valeurs qu’exaltent les deux mouvements. Mais, l’Internationale Socialiste repose sur le concept marxiste de négation de la notion de mère patrie et de l’anéantissement des capitalistes sur la scène internationale. Par contre, l’internationalisme coopératif est fondé sur les individualités nationales et non leur suppression, sur le fédéralisme et non l’uniformité, sur la fidélité à la mère patrie et non son rejet. Cependant à part ces ressemblances, le coopératisme et le socialisme s’opposent totalement surtout en ce qui concerne leur but et leurs méthodes comme nous le démontrons ci-après : 1° Les préoccupations politiques et économiques Le socialisme est un mouvement essentiellement politique, en comparaison du coopératisme qui est avant tout un mouvement économique. En tant que mouvement politique, le socialisme vise d’abord la prise du pouvoir, tant les transformations socioéconomiques ne peuvent venir que d’en haut, par des mesures législatives, par le pouvoir de l’Etat. Plus d’initiative personnelle, ni profit individuel, chacun appliquant les directives du plan. L’Etat fixant les prix en vue d’orienter la production. Pour le mouvement coopératif, c’est dans le domaine économique qu’il faut chercher en premier lieu à gagner force et influence. Par ses conquêtes économiques progressives, il influencera inévitablement les conditions sociales et politiques. 2° Le concept de classes et le concept sans classes Les fondements sociaux de ces deux mouvements populaires ne sont pas identiques et ne reposent pas sur les mêmes couches sociales. Le socialisme est un mouvement du prolétariat ou des travailleurs industriels. C’est une idéalisation de la classe ouvrière en vue de la défense de ses intérêts à travers les partis socialistes. Ces derniers ne regroupent pas forcément des travailleurs mais plutôt tous ceux qui partagent une même option politique, tout en appartenant éventuellement à des classes sociales différentes et ayant des intérêts économiques distincts. Le coopératisme, pour sa part, ne soutient aucune classe sociale. En dehors de toute discrimination, les coopératives regroupent tous ceux qui ont des intérêts économiques similaires et sont confrontés aux mêmes problèmes, mais peuvent avoir des opinions politiques opposées. 3° L’attitude à l’égard de la propriété privée Etant l’antithèse du capitalisme, le socialisme condamne la propriété privée en tant que base de relations et de structures économiques. Cela est si vrai que de nombreux socialistes ont attribué, pendant très longtemps, à la nationalisation totale une espèce de pouvoir magique, et l’ont considérée comme une panacée . Mais plus tard, après le constat des effets dévastateurs de la nationalisation complète en Russie, le socialisme a abandonné son ancienne politique de nationalisation à outrance et s’est intéressé davantage au contrôle du capital et à son utilisation qu’à son transfert entre les mains de l’Etat. Inversement, la coopération n’a jamais considéré la forme de propriété comme déterminante. Bien plus, elle a ressenti, dès son origine, le besoin des ressources du domaine de la propriété privée pour se constituer et prospérer. L’attitude de la coopération est donc différente : elle respecte le capital privé au même titre qu’elle le transforme en source de rétribution pour les usagers, au lieu de ne demeurer que la base du profit. La lutte coopérative s’exerce donc contre le profit et autres abus de la propriété plutôt que contre le type de propriété. Bien évidemment, il est plus important de répartir équitablement les richesses que d’enlever aux gens ce qu’ils possèdent. 4° La question religieuse A leurs débuts, socialisme et coopératisme affichaient tous les deux une attitude de neutralité à l’égard de la religion. Tandis que le coopératisme conservait cette attitude, sans y déroger en rien, le socialisme, conformément à l’enseignement marxiste du matérialisme dialectique, développa un athéisme militant . N’est-ce pas là les germes du totalitarisme insidieux ? Car, en libérant les peuples de la loi morale afin de devenir indépendants de Dieu, les soi-disant révolutionnaires instaurent l’obscurantisme et poussent leurs adeptes à renier leur nature d’êtres créés à l’image divine, ayant des droits inaliénables et transcendants. Ainsi, ils deviennent de proies faciles de l’arbitraire, acceptant l’abolition des rapports fraternels et le règne de la terreur, la haine, la corruption, les discriminations, la confiscation des libertés fondamentales… . Mais, à la suite de la rupture définitive entre communisme et socialisme, ce dernier adopta une position plus modérée et plus réaliste, revenant à la politique de neutralité. 5° La fin et les moyens Le socialisme et le coopératisme poursuivent des buts différents par des méthodes opposées, et sont donc irréconciliables. Pour atteindre ses buts, le socialisme prône l’utilisation des moyens révolutionnaires, c’est-à-dire, l’usage de la force, de la lutte, de la destruction des structures socioéconomiques existantes. Il affirme que sans la destruction préalable de l’Etat bourgeois, il serait impossible de bâtir une nouvelle et meilleure société . Alors qu’un vrai processus de libération sacrifie à l’exigence de la morale et du respect de chaque être humain dans ses droits à la vie et à la dignité, l’enseignement révolutionnaire marxiste recommande le renversement violent de l’ordre social passé parce que « les prolétaires n’y ont rien à perdre que leurs chaînes mais ont un monde à gagner » . Il suffira d’une grève générale déclenchée par les leaders du prolétariat pour réaliser le cataclysme inévitable qui balayera propriété privée et capitalisme. Georges SOREL, syndicaliste révolutionnaire, attribue un pouvoir purificateur et fait de ladite grève un véritable mythe, une idée force susceptible de faire triompher le socialisme . Pour sa part, KARL MARX considère ce schéma général comme étant fatal. A l’opposé du socialisme, le coopératisme préconise la poursuite des objectifs révolutionnaires de coopération par une action constructive, par des moyens pacifiques et par des méthodes évolutionnistes, et non en provoquant des désordres sociaux. Il s’applique donc à forger son propre système et à bâtir l’économie coopérative parallèlement au système existant, plutôt qu’à la place de ce dernier et sur ses ruines. Par ailleurs, la différence entre les deux mouvements apparaît clairement à la lumière de leurs objectifs ou du caractère de la victoire finale qu’ils recherchent. Par la victoire finale du mouvement socialiste, le pouvoir de l’Etat augmentera considérablement. La population, libérée de l’emprise du capitalisme, dépendra par contre de l’Etat. Elle s’en remettra à lui seul pour la solution de ses problèmes, ce qu’il fera de façon uniforme, centralisée et bureaucratique. En définitive, cette victoire finale amènera le socialisme qui se caractérisera par un système administratif hautement développé dans lequel une oligarchie opprimera de nouveau les masses . Dans le cas d’une victoire de la coopération, le pouvoir du peuple, fondé sur le self-help et l’entraide, sera accru. La population sera alors à même de régler ses problèmes par l’intermédiaire des structures coopératives, selon un processus démocratique, dans un esprit de décentralisation et en tenant compte de la nature différente de chaque problème, des besoins, des préférences, des ressources et de l’environnement des coopérateurs concernés. Ainsi, la population sera affranchie de la double domination du capitalisme et de l’Etat, grâce à l’instauration du coopératisme au sein d’une République coopérative qui se distinguera par le développement, au plus haut degré, de relations essentiellement coopératives entre les hommes. 1.4.2.3. Le coopératisme et le communisme Le Marxisme prolongé par LENINE est la base doctrinale et pratique de divers partis communistes . Bien que le communisme soit de nos jours un système dépassé, nous le mentionnons dans le présent ouvrage par souci d’être complet et d’éviter toute assimilation avec le coopératisme. Le communisme est en effet un ennemi particulièrement dangereux pour les coopératives, en raison des méthodes subtiles qu’il utilise dans ses menées contre le coopératisme. Contrairement au fascisme, le communisme n’a jamais déclaré une guerre ouverte contre les coopératives. C’est plutôt par des procédés machiavéliques, en les maltraitant et en les instrumentalisant, qu’il parvient à les détruire. Il les étrangle progressivement, l’une après l’autre, tout en leur jurant un amour indéfectible et en proclamant sa foi en l’idéal coopératif. Dans les lignes qui suivent, nous élucidons les motivations de l’acharnement du communisme contre l’économie coopérative. 1° Réalisme politique Le communisme propose à un monde complexe des solutions simplistes et superficielles ; tout ce qu’il offre au peuple, c’est une nationalisation totale et une société sans classes. L’idéal communiste ne peut pas convaincre la majorité des populations parce que cette dernière ne peut librement accéder au statut de prolétaire voué au service d’un employeur unique, dominateur, qu’est l’Etat communiste. Le coopératisme, par contre, représente un système concret, réaliste et respectueux de l’initiative individuelle et collective, fondamentalement rivé sur la satisfaction des besoins humains. A la vérité, les Pionniers de Rochdale, initiateurs du mouvement coopératif, n’étaient pas des rêveurs mais avaient les pieds sur la terre des réalités économiques et « domestiques ». Conscients du fait qu’ils ne pouvaient résoudre l’ensemble des problèmes socioéconomiques complexes par des mesures politiques unilatérales, ils avaient décidé la création des structures communautaires, se finançant elles-mêmes, unifiant les intérêts individuels pour la recherche des solutions aux problèmes concrets d’approvisionnement, de logement, d’emploi, d’éducation, d’infrastructure, de sécurité, etc., permettant ainsi la contribution directe de l’effort productif des classes laborieuses à l’amélioration de leur bien-être. La force du mouvement coopératif ne réside donc pas dans la présentation littéraire d’un rêve à la grandeur du monde, réalisable dans un futur éloigné, mais plutôt dans ses principes cardinaux issus de la vie et œuvrant pour la vie, d’application simple partout, dans n’importe quel contexte économique pourvu qu’ils ne soient pas proscrits, ni mis hors la loi par les autorités publiques. C’est ainsi que le coopératisme exerce un attrait certain sur les peuples et les nations. 2° Opposition idéologique Le communisme s’oppose à l’essence même de l’économie coopérative à savoir, la suppression du profit. En fait, le communisme, tout comme le capitalisme, est fondé sur la tendance au profit ; la querelle entre ces deux systèmes se situant au niveau de la propriété. Ceci a été clairement démontré par l’économiste soviétique EVSEI LIBERMAN. C’est pour cette raison que les régimes communistes violent les principes rochdaliens de la coopération. 3° Dépendance vis-à-vis de l’Etat L’Etat communiste recherche par tous les moyens à garder une mainmise sur les coopératives. Il s’oppose à l’idée des coopératives contrôlées par leurs membres pour leurs membres alors que, par essence, l’action coopérative est indépendante vis-à-vis de l’Etat et de partis politiques. 4° Relations entre les coopératives et leurs membres Les coopératives installées dans les pays communistes n’ont pas grand chose de commun avec celles des pays démocratiques. En général, dans les pays communistes, les coopératives villageoises sont, en fait, imposées aux paysans qui n’ont pas d’autre choix que de travailler dans les fermes collectives s’ils veulent avoir une source de revenus. Ils ne considèrent pas les coopératives comme leurs propres organisations défendant leurs intérêts, mais plutôt comme des entreprises étatiques contre lesquelles ils doivent se protéger. Normalement, les gens tentent de réaliser coopérativement ce qu’il leur est impossible d’accomplir individuellement. Dans le système communiste, c’est l’inverse qui se produit : les paysans essayent d’obtenir isolément ce qui leur est inaccessible dans les coopératives. 5° Incidences sociales et politiques Le système communiste n’apporte pas de changement dans le statut social des agents économiques ; ceux-ci restent travailleurs, clients ou vendeurs… Mais en participant dans une coopérative, l’usager de l’entreprise devient copropriétaire, avec un rôle social nouveau, celui d’entrepreneur. Dans une économie de type communiste, le résultat de l’activité appartient au capital ou à son propriétaire, en l’espèce, l’Etat communiste. Ce n’est pas le cas dans le système coopératif où le résultat revient aux coopérateurs. Fondamentalement, le communisme ne peut œuvrer qu’au milieu de la pauvreté et du désespoir en engendrant le chaos, la confusion et la misère . A son opposé, le coopératisme recherche, en priorité, l’amélioration des conditions de vie de la population, et partant, le progrès social et économique. Sur le plan politique, le communisme ne peut survivre sans la dictature, c’est-à-dire un système de gouvernement où les dirigeants communistes détiennent le pouvoir absolu. Tandis que le coopératisme rejette l’idée de parti unique et le monolithisme politique, de la même manière qu’il s’oppose aux monopoles économiques. 6°) Divergence d’objectifs L’objectif du communisme est de mettre fin à toute indépendance économique et à toute initiative individuelle. Il ne s’intéresse pas à l’expansion des idées et de la philosophie coopératives, mais s’active plutôt à détourner les coopératives de leurs objectifs pour préparer la révolution communiste, au terme de laquelle, chaque citoyen ne devra dépendre que de l’Etat, et ne pourra être employé que par lui. Au niveau international, le communisme considère les assemblées coopératives comme une plate-forme pour la diffusion de la propagande communiste. 7°) Philosophie et méthodes Les Contrastes philosophiques constituent un fossé infranchissable entre le communisme et le coopératisme. Alors que celui-ci se fonde sur la morale, la liberté de l’individu, la persuasion, le volontariat et la libre décision, celui-là repose fondamentalement sur l’immoralité et la contrainte. Sachant bien que sa structure unilatérale et ses solutions platoniques ne peuvent séduire le peuple, le communisme recourt à la force . En vue de l’édification de leur système, les communistes usent des techniques et subtilités machiavéliques telles qu’elles ont été conçues par LENINE et magistralement appliquées par STALINE, en particulier. Ils recourent sans scrupule à la conspiration, la subversion, la trahison, l’espionnage, la délation et la haine. Tous les moyens étant bons du moment qu’ils servent la cause communiste. Partout et toujours, c’est par la coercition, la violence, la terreur, la crainte, bref, la manipulation du peuple que le communisme s’installe . En terrifiant les populations, les démoralisant, les humiliant, elles deviennent ainsi lâches, misérables, soumises et parfaitement dressées à accepter et à exécuter tout ce que leur commanderont les dirigeants communistes . Ceux-ci ont, en réalité, rejeté l’idée de Dieu en décidant souverainement du bien et du mal ou des valeurs, ne s’appuyant, chacun, que sur soi, afin de se réaliser et se suffire dans sa propre immanence. Devenu ainsi son propre centre, le politicien communiste a eu constamment tendance à s’affirmer et à satisfaire son désir d’infini en se servant des choses : richesses, pouvoirs et plaisirs, au mépris des autres hommes qu’il dépouillait injustement et traitait en objets ou en instruments. Aussi, a-t-il contribué, pour sa part, à la création des structures d’exploitation et de servitude que par ailleurs il dénonçait . Par contre, le coopératisme offre des solutions concrètes à quiconque veut en tirer parti par des méthodes libérales, directes et adaptées aux différentes catégories sociales. Il prône la probité dans les relations économiques et sociopolitiques, refuse la conception totalitaire communiste qu’il juge incompatible avec la nature et la dignité humaines. 8°) Concept de classes sociales Le communisme repose sur une classe unique, celle des « prolétaires ». Contrairement à cette doctrine, le coopératisme recrute ses membres parmi les différents groupements : citadins, paysans, salariés, indépendants, artisans… De ce fait, le mouvement coopératif ne peut qu’attirer l’ensemble de toutes les catégories sociales. 9°) Primauté de l’élément humain Dans l’économie communiste la propriété est l’élément dominant, et le capital est le maître. En effet, elle fonde son existence sur le transfert du capital entre les mains de l’Etat. Par contre, l’économie coopérative se base sur le peuple, sur sa participation aux activités coopératives, le capital étant relégué au rôle de serviteur. Le coopératisme met son point d’honneur à organiser les hommes afin qu’ils jouent un rôle moteur de l’économie. C’est pour cette raison que l’idéologie coopérative contribue, dans une nation, à la sublimation de la personne humaine lorsqu’elle est renforcée par un grand apport des valeurs chrétiennes. 1.4.3. Réalisations économiques à travers le monde Il est difficile de mesurer l’impact du mouvement coopératif dans l’économie mondiale en raison de l’absence de statistiques complètes et actuelles. Néanmoins, Georges DAVIDOVIC, dans son ouvrage déjà cité, tente de retracer depuis 1844 l’évolution statistique du système coopératif dans le monde . Dans le secteur du commerce de détail, la part du marché contrôlée par les coopératives de consommation, malgré la concurrence des grands magasins, des supermarchés et des sociétés à succursales multiples, a accru sensiblement jusqu’à atteindre environ 11 % en Europe durant l’année 1975. Au cours de la même période, les coopératives se sont développées de manière spectaculaire dans le secteur agricole européen. Elles produisaient les outils et machines agricoles et contrôlaient 80 % du marché des produits laitiers. Dans le domaine du crédit, les réussites sont nombreuses, particulièrement dans la mobilisation de l’épargne en région rurale. En Amérique du Nord, les coopératives de crédit « crédit unions », créées vers l’année 1900, ont réalisé des progrès considérables et impressionnants. Après la seconde guerre mondiale, la coopération a conquis avec succès les domaines des assurances et de l’habitat. Par ailleurs, le développement du mouvement coopératif a contraint les Etats de l’OCDE à prendre des lois et règlements propres à limiter les abus du système capitaliste. Il convient toutefois de noter que ce n’est qu’au début du XXe siècle que les coopératives ont débordé l’Europe. En vue de mieux appréhender les réalisations économiques du mouvement coopératif, nous allons évaluer son action en Suisse, au Danemark, en Israël, en France, en Allemagne, au Canada et dans certains pays en voie de développement. 1° Les réalisations du mouvement coopératif suisse A bien des égards, la Suisse est l’expression vivante de l’idéologie coopérative, à savoir : l’association volontaire, le fédéralisme, la neutralité et l’entraide. Elle présente, comme une coopérative, un parfait exemple d’unité dans la diversité. En effet, la Suisse regroupe quatre communautés ayant quatre langues différentes : l’allemand, le français, l’italien et le romanche, en adoptant le mot d’ordre coopératif : « un pour tous - tous pour un », symbole de la solidarité coopérative. Depuis sa fondation en 1291, la Suisse s’est développée sur une base coopérative. Les conditions naturelles fort difficiles forcèrent très tôt la population à suivre la voie de la coopération. C’est ainsi que les trois cantons qui furent à l’origine de la confédération helvétique possédaient une économie agricole fondée principalement sur des coopératives d’un style primitif, appelées Markt-Genossenschaften. Déjà au XVIIIe siècle, deux éducateurs célèbres, J.H.Pestalozzi et E.VON FALLENGERG, propagèrent l’esprit coopératif dans ce pays, si bien qu’à la naissance du mouvement coopératif moderne à Rochdale, en 1844, la Suisse fut l’un des tout premiers pays où il fut implanté sans aucune difficulté et où, par la suite, l’économie coopérative accomplit des rapides progrès. Ainsi, naquit en 1900, la première coopérative Raiffeisen d’épargne et de crédit suisse, tandis qu’en 1975, on enregistra 1.164 coopératives dans ce secteur. L’engouement est tel que 70 à 90% des membres desdites coopératives participaient régulièrement à leurs assemblées générales qui, proportionnellement, étaient bien mieux étoffées que les assemblées communales . A tout prendre, les traditions coopératives et l’application, à l’échelle nationale, des principes coopératifs, ont permis à la Suisse de développer l’industrie de précision, le tourisme et le secteur bancaire dans une contrée dépourvue de richesses naturelles et de conditions agricoles, industrielles ou commerciales propices au développement économique. C’est grâce à l’esprit de self help, de confiance en soi et d’entraide que le peuple suisse a pu maîtriser un milieu peu clément et devenir une nation prospère. 2°) Les réalisations du mouvement coopératif danois Vers le milieu du XIXe siècle, le Danemark fut vaincu, morcelé, humilié et abandonné par ses alliés. Se trouvant presque sans ressources face à un avenir lamentable, il se tourna vers la seule richesse qui lui resta : sa population. Les écoles populaires (Folks High Schools) furent organisées dans les campagnes où la jeunesse rurale bénéficiait d’un enseignement technique . Mais, c’est dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque le Danemark s’engagea résolument sur la voie de la coopération, que les agriculteurs danois obtinrent des succès inespérés. Sous l’influence salutaire des coopératives, ils augmentèrent rapidement la qualité et le volume de leur production, notamment dans le domaine de l’élevage où l’importance du travail humain reste considérable. Certains produits agricoles tels que le beurre ou le lard, provenant presque exclusivement des coopératives, conquirent les marchés locaux et étrangers. A noter qu’à cette époque, les coopératives agricoles contrôlaient, soit l’exportation, soit la préparation en vue de l’exportation des produits de la ferme qui constituaient les trois cinquièmes des exportations danoises. Ainsi, la paysannerie danoise devint, depuis, l’une des plus riches d’Europe. Ces performances sont d’autant plus impressionnantes qu’elles ont été réalisées par des coopératives regroupant des propriétés fort petites, souvent même minuscules. Quoique la population fût devenue urbaine à 75 % après la seconde guerre mondiale, les coopératives agricoles continuèrent à contrôler une bonne part des exportations danoises. En même temps, l’économie coopérative fit une percée importante dans les villes, notamment dans la distribution des marchandises, l’assurance et le crédit. 3°) Les réalisations économiques du mouvement coopératif israélien L’Etat d’Israël constitue la preuve exceptionnelle du pouvoir créateur de l’homme. Son exemple démontre que l’homme est parfaitement capable de façonner son destin sur un sol inhospitalier, dans un milieu hostile et dans des conditions extrêmement difficiles, s’il est poussé par le zèle coopératif . C’est également la preuve vivante de la capacité de l’homme à transformer, par l’action coopérative, ses idées en faits, ses rêves en réalités. L’histoire d’Israël débute bien avant sa création à la fin de la seconde guerre mondiale, avec l’arrivée, à l’aube du XXe siècle, des premiers pionniers juifs en Palestine qui faisait alors partie de l’Empire Ottoman. Ces pionniers, qui avaient fui les persécutions en Russie, étaient complètement démunis, mais très riches en valeurs humaines . Ils avaient la ferme conviction qu’ils ne parviendraient à rebâtir la nation juive qu’en unissant leurs efforts par l’action coopérative, conformément à la devise : « un pour tous- tous pour un ». C’est de l’association de tous ces éléments que naquirent les Kibboutz, coopératives dont les membres vivent et travaillent ensemble comme dans une grande famille suivant le principe : « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». En effet, selon Joseph BARATZ, qui en est l’un des pionniers, un kibboutz n’est pas une association, ni un parti constitué en groupe, mais plutôt, une existence vécue en commun. Il ne s’agit pas seulement de se trouver d’accord sur des principes, mais de savoir donner et recevoir, comprendre autrui et dépouiller son propre égoïsme . Augmentant peu à peu en nombre, en force et en influence, les Kibboutz avaient atteint une efficacité étonnante à la création de l’Etat d’Israël et contribuèrent à son implantation et à son développement de multiples façons. Particulièrement, ils ont offert un abri, de l’espoir et de la sécurité aux nouveaux colons qui arrivaient chaque année de tous les coins du monde, surtout après la seconde guerre mondiale. C’est principalement au sein des Kibboutz que la nation Israélienne a acquis confiance, autonomie et courage d’affronter n’importe quel danger, n’importe quelle difficulté. Pareillement, les plus éminentes personnalités politiques du jeune Etat y ont développé des qualités d’hommes d’Etat et de leaders. S’il est vrai que la population juive mondiale a soutenu financièrement le peuple d’Israël, il n’en demeure pas moins que ce n’est nullement la finance, mais l’élément humain, les valeurs cardinales, l’esprit coopératif prôné par les pionniers qui ont permis d’accomplir tant de prodiges. 4°) Les réalisations économiques du mouvement coopératif français Le mouvement coopératif français a connu un très grand développement dans les secteurs de distribution et de l’agriculture . A travers le temps, il faudrait noter les performances suivantes : - en 1968, les banques populaires (coopératives de crédit) venaient au sixième rang des institutions bancaires françaises pour l’importance des dépôts ; - en 1978, les caisses de crédit agricole occupaient la quatrième place parmi les grandes banques françaises pour le volume de dépôts ; - en 1981, il a été créé 200 coopératives ouvrières de production lesquelles, dans la plupart des cas, ont été constituées par les ouvriers des entreprises en cessation d’activités, sauvegardant environ 3.000 emplois dans les secteurs les plus divers : verrerie, imprimerie, luminaires, etc. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une bonne structuration du secteur coopératif. En effet, les unions coopératives et les coopératives isolées sont regroupées dans les fédérations, coiffées, elles-mêmes, par le Conseil Supérieur de la coopération. Ce dernier comprend les représentants du Gouvernement (la Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale), de l’Assemblée Nationale, du Sénat et les délégués des organisations coopératives. Pour le financement, l’Etat français a créé la Caisse Centrale de crédit coopératif, sous forme d’union des sociétés coopératives, spécialisée dans l’octroi des avances aux coopératives. Les performances des coopératives françaises administrent, sans conteste, la preuve du rôle moteur desdites entreprises même dans un contexte libéral où elles constituent la face humaniste de l’économie occidentale que les économistes positivistes contemporains se refusent à explorer en vue de dégager un modèle scientifique pouvant servir de fondement de nouvelles stratégies de développement durable. En 1999, en effet, les banques coopératives collectaient 60 % des dépôts, avec 189.641 salariés, plus de 600 milliards d’euros de bilan, près de 25 millions de clients et 2 millions de sociétaires. La coopération agricole regroupait 90 % d’exploitations agricoles, 30 % de parts du marché de l’industrie agroalimentaire, 3.700 entreprises, 13.500 coopératives de mise en commun du matériel agricole (SUMA), 64 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 1,1 millions de sociétaires. Tandis que les coopératives d’habitation possédaient 40.000 lots, 3.941 unités produites, 11.537 logements… Les coopératives scolaires étaient composées de 49.551 entreprises et 100 associations départementales dispensant des services à 4.156.748 élèves . 5°) Les réalisations économiques du mouvement coopératif rural en Allemagne Le mouvement coopératif rural allemand, connu sous le nom de son fondateur Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, prit naissance dans un petit village rhénan pendant la disette de 1846 . Dès 1883, environ 1.000 coopératives existèrent tandis qu’au tournant du siècle, ce chiffre décupla. Les détails suivants témoignent de l’envergure des coopératives rurales dans le cadre de l’économie de la République Fédérale d’Allemagne en 1971 : - la somme totale des dépôts auprès de 6.362 banques rurales Raiffeisen atteignait 44,25 milliards de DM dont 34 milliards de dépôts d’épargne ; - les crédits à court, moyen et long termes accordés aux membres étaient de l’ordre de 31 milliards de D.M ; - les banques Raiffeisen et leurs filiales étaient disséminées dans près de 15.000 endroits ; - 45 % des ventes des produits agricoles étaient canalisés sur le marché à travers les coopératives rurales. Plus tard en 1998, l’Allemagne réunifiée comptait toujours un grand nombre de coopératives, soit, selon les statistiques de l’A.C.I., 10.320 entreprises réparties comme suit : 4.434 dans l’agriculture, 1.477 dans l’artisanat, 2.421 banques, 1.940 coopératives immobilières, 4 coopératives de consommateurs… Cette tendance s’est généralisée dans toute l’Europe et atteste que le mouvement coopératif a fait une percée dans l’économie du Vieux Continent, comme le relève le tableau synoptique ci-après : Tableau 1. L’importance économique de la coopération en Europe en 1998 Nombre d’entreprises Nombre de membres Nombre de salariés Total Europe 288.560 soit 100 % 140.307.328 Soit 100 % 4.892.384 Soit 100 % Dont pour le secteur primaire 108.510 soit 37 % 17.052.561 Soit 12,2 % 1.037.922 Soit 21,2 % Dont pour le secteur Secondaire 47.220 soit 16,4% 1.435.717 Soit 1,0 % 978.805 Soit 20,0 % Dont pour le secteur Tertiaire 132.830 soit 46,0 % 121.819.050 Soit 86,8 % 2.875.657 Soit 58,8 % N.B. : 45 % d’entreprises sont installées dans l’UE et 61 % du nombre total des membres. Source : ACI « Statistics and information on european co-operatives », Genève, Décembre 1998. 6°) Les réalisations coopératives au Canada Le 6 décembre 1900, Alphonse Desjardins fondait à Levis (Québec) la première coopérative d’épargne et de crédit du Canada et de l’Amérique du Nord, au terme d’une longue démarche qui l’avait mis en contact avec les experts européens de la coopération . L’œuvre amorcée par Desjardins était devenu, en 1975, le Mouvement des Caisses populaires Desjardins, soit 1.251 caisses populaires, deux sociétés d’assurance vie, deux sociétés d’assurance générale, une société d’investissement et une résidence pour l’éducation des adultes. Toutes ces entreprises étaient regroupées et coordonnées par la Fédération de Québec des caisses populaires Desjardins. La coopération a marqué l’évolution de l’économie québécoise à tel point que l’on dit souvent que sans les caisses populaires, le Québec ne serait pas ce qu’il est . 7°) Le nouveau mouvement coopératif vénézuélien Quoique le mouvement coopératif vénézuélien pèche par une étatisation à outrance et s’expose à un risque lancinant de dérive totalitaire, l’expérience vaut bien la peine d’être mentionnée dans cette étude. En 1998, il y avait seulement 762 coopératives au Venezuela. Ces Coopératives, comme le reste de la société vénézuélienne, ont survécu aux mesures d’ajustement structurel initiées sous la présidence de Carlos Andrés Pérez en 1989. En effet, au cours de deux dernières décennies, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Venezuela n’a fait pratiquement que baisser, et les inégalités ont atteint un niveau extrême. On estimait à 80 % la part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et à plus de 50 % celle qui travaillait dans le secteur informel. L’économie vénézuélienne était par ailleurs fortement dépendante des exportations du pétrole. Une grande partie de la nourriture était importée du fait que la production nationale alimentaire se situait à un niveau bien inférieur du niveau de production minimum d’autosuffisance d’un pays, selon les indicateurs du FAO . Pour faire face à cette situation économique et sociale, le nouveau régime a mis l’accent sur le développement local, diversifié et durable ainsi que sur l’engagement à respecter les différentes identités et cultures du Venezuela. Dans cette optique, il fallait inclure les secteurs historiquement marginalisés de la société, en cherchant à démocratiser l’économie, à combattre les inégalités et à encourager la solidarité afin de rembourser la « dette sociale » accumulée envers les secteurs populaires. Le modèle de production coopérative a, petit à petit, défini les stratégies de développement de la « révolution bolivarienne ». Le coopératisme est devenu un axe transversal des politiques publiques du Gouvernement. La constitution bolivarienne de 1999 a promu les coopérateurs en tant qu’acteurs économiques clés dans l’économie sociale de la nation. Les coopératives y sont décrites comme des outils d’inclusion économique, de participation (article 70) et de décentralisation de l’Etat (article 184). « De façon plus significative, l’Etat doit promouvoir et protéger les coopératives » (articles 118 et 308). Ce n’était pas le cas jusqu’à ce que la Loi spéciale des associations coopératives soit promulguée en septembre 2001 et que le nombre de coopératives commence à croître, passant de presque 1.000 coopératives en 2001 à plus de 2.000 l’année suivante et plus de 8.000 en 2003. Dans cette politique volontariste de changer le modèle économique, social, politique et culturel du pays, afin de mettre en place un Etat de justice et de droit, le Gouvernement a lancé des programmes d’éducation, de santé et de culture grâce auxquels des formations scientifiques, techniques, de gestion ou d’histoire, de la citoyenneté et des valeurs coopératives sont dispensées. Les diplômés de Vuelvan Caras ont été formés et encouragés à fonder des coopératives. Entre décembre 2004 et mai 2005, sur 264.720 diplômés, 70 % ont fondé 7.592 nouvelles coopératives et ont bénéficié d’un financement d’environ 265 millions de dollars US. Dans son rapport d’août 2005, l’Organisme national responsable des coopératives, la SUNACOOP, recensait 83.769 coopératives dont plus de 40.000 coopératives créées en 2004 et presque 30.000 autres formées entre janvier et août 2005. Le nombre total de membres des coopératives atteignait 945.517 en octobre 2004, bien plus que les 215.000 de 1998. En septembre 2004, le Gouvernement vénézuélien a créé un Ministère de l’Economie Populaire (MINEP) pour soutenir, coordonner, élaborer les politiques de promotion des micro-entreprises. Le MINEP est décentralisé en comités techniques régionaux regroupant les représentants des institutions d’Etat subordonnées à ce ministère, l’Institut national pour l’éducation, les organisations coopératives de production et de financement. L’objectif est de susciter une synergie décentralisée d’institutions publiques accessibles au public, transparentes et soumises à un contrôle citoyen accru. En janvier 2006, le MINEP comptait commencer la formation de 700.000 étudiants en vue de les organiser au bout d’un an au sein de 2.000 nouvelles coopératives. Partout à travers le pays, les coopératives diverses se regroupent pour monter des projets et reçoivent le soutien technique et des crédits nécessaires de MINEP (73,5 % des coopératives dans l’Agriculture, 14,8 % dans l’Industrie et Travaux Publics et 10,4 % dans le Tourisme). Nombre de gouvernements locaux, d’institutions publiques, y compris la compagnie pétrolière du Venezuela, (Petroleos de Venezuela « PDVSA ») ont fait de la place aux petites entreprises, en particulier aux coopératives. Ces établissements et institutions ont établi des procédures d’appel d’offre qui, tout en exigeant une qualité et des coûts compétitifs, ne discriminent pas les petites entreprises ni les coopératives. Ils ont aussi encouragé les employés du secteur privé à fonder leurs coopératives. Par exemple, la CADELA, une des cinq branches régionales de la compagnie d’électricité nationale publique, a incité les personnes employées dans des entreprises sous-traitants de maintenance et de sécurité à quitter leurs employeurs privés pour former leurs propres coopératives. La division des travaux publics de la principale municipalité de Caracas a encouragé la création de Cabinets de travaux locaux dans lesquels les habitants s’organisent eux-mêmes en « tables de travail » pour décider des chantiers publics à ouvrir en fait d’infrastructures et supervisent eux-mêmes les travaux. La Communauté décide aussi quelles coopératives du voisinage se chargeront de leur exécution. La clé du succès des nouvelles coopératives au Venezuela consiste à trouver un équilibre entre volontarisme et pragmatisme, de façon à ce que l’ardeur au changement se traduise effectivement par une transformation concrète et durable. Afin que l’appui de l’Etat n’exacerbe pas la corruption, la Constitution Bolivarienne a consolidé les mécanismes de contrôle social. La loi contre la corruption en 2003, la loi organique d’audit de la République en 2003 et la loi organique de l’administration publique permettent aux citoyens d’exercer un contrôle social sur les ressources publiques et d’obliger les fonctionnaires à être transparents. Pour sa part, la SUNACOOP organise régulièrement des audits dans les coopératives afin de leur fournir une évaluation pédagogique concernant la légalité, l’efficacité, le management, le respect des principes coopératifs. Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact réel des coopératives au Venezuela, mais ce ne serait pas complètement erroné d’affirmer qu’elles ont contribué à l’augmentation de l’emploi dans le secteur formel et à la croissance économique sans que celle-ci ne provienne exclusivement des exportations du pétrole. 8. Le mouvement coopératif tanzanien Le mouvement coopératif tanzanien remonte aux années 30 et a connu son âge d’or pendant la 1ère décennie de l’Indépendance . Depuis lors, les perspectives se sont amenuisées, si bien que pendant un certain temps, les coopératives étaient devenues un outil pour les politiques gouvernementales et ont effectivement été intégrées aux structures étatiques. Fort de cette situation privilégiée, le mouvement coopératif est resté sourd aux besoins de ses membres et ne s’est donc pas préparé à la concurrence du secteur privé quand la libéralisation du commerce a été introduite dans les années 90. Le tournant s’est opéré en 2000, lorsqu’une Commission Gouvernementale a cherché ce qui pouvait être fait pour redynamiser le secteur coopératif du pays. La Commission fut brutale dans sa critique du mouvement qui, disait-elle, souffrait du manque de capitaux, de structures trop rigides, de la carence de dirigeants, de détournement de fonds et de vols. Sur ces entrefaites, une série d’étapes concertées ont été franchies pour renverser la tendance. Une nouvelle législation relative aux coopératives, qui a notamment pour but de renforcer la participation démocratique des membres, a été adoptée en 2003, et le gouvernement a approuvé un Programme global de réforme et de modernisation des coopératives (CRMP) de 2005 à 2015. La responsabilisation des membres et la viabilité commerciale ont été les deux thèmes centraux de la réforme. Le progrès réalisé est à l’image des exemples de réussites coopératives suivantes : les SACCO (Sociétés Coopératives de Crédit et d’Epargne) avec environ 1.400 coopératives référencées, dont les membres travaillent dans le secteur formel et dans l’économie informelle. L’une d’elles, la Posta na Simu, fournit les services d’épargne et de prêts aux employés de la compagnie tanzanienne des télécommunications, de la Poste, de la Banque postale… En outre, la coopérative rurale de Mamsera qui regroupe les producteurs de café et s’occupe de la commercialisation du même produit. Le Programme de réforme 2005 à 2015 est financé par le Gouvernement et bénéficie aussi du soutien d’autres donateurs extérieurs. Cependant, un élan a été donné à la source pour revigorer les principes démocratiques de la coopération en réorganisant les élections des membres du Conseil d’Administration de chaque coopérative. Ces élections ont clairement indiqué aux responsables de la vielle garde et aux membres de la coopérative que les anciennes méthodes étaient en train de changer. 9°) Le mouvement coopératif congolais Faute de statistiques mieux élaborées, il est difficile d’apprécier l’évolution du mouvement coopératif en République Démocratique du Congo. Néanmoins, nous pouvons en juger à travers l’histoire de la coopération pendant la colonisation et après l’indépendance politique . 9.1. Le mouvement coopératif au Congo Belge Le développement du coopératisme au Congo Belge était lié à la politique agricole coloniale, bien que la société coopérative ait été formellement rangée par le Décret du 27 février 1887 parmi les sociétés commerciales. En effet, les premières associations professionnelles précoopératives furent créées par les colons afin de faire face aux entreprises multinationales qui disposaient de leurs propres services commerciaux, d’installations de stockage adéquates et vendaient, sur base de contrats commerciaux, leurs produits sur les marchés internationaux et locaux. C’est par le biais de la coopération que lesdites associations apportaient à leurs membres un appui technique, matériel et financier en vue de mieux affronter la concurrence internationale ainsi que les aléas de la conjoncture mondiale. Cependant, il a fallu attendre la promulgation du décret du 23 mars 1921, se référant simplement à la loi belge, pour que les premières coopératives exclusivement réservées aux agriculteurs d’origine européenne (colonat européen) fussent autorisées à fonctionner. Dans le but de stimuler la production agricole parmi les populations autochtones en milieu rural, et, en même temps lutter contre la baisse de productivité, le gouvernement colonial instaura, à partir de 1936, un programme de modernisation de l’agriculture par les paysannats. En fait, le pouvoir colonial visa, par la promotion desdites structures, le remplacement de l’agriculture extensive par une agriculture plus intensive ainsi que l’amélioration de la distribution des biens et services à travers le pays. Contrairement au système traditionnel de l’agriculture itinérante et à celui de cultures obligatoires, le paysannat s’objectiva dans la délimitation des lotissements agricoles, l’individualisation de leur exploitation, l’exécution d’un programme précis suivant les méthodes culturales définies par l’administration coloniale et la déportation des populations des zones peuplées vers les zones les moins peuplées. Il était question de stabiliser la population rurale pour en faire de vrais paysans, c’est-à-dire une corporation d’élites issue de la masse rurale et attachée à la terre, d’une part, et de préserver la fertilité du sol en vue d’accroître la production vivrière et celle destinée à l’exportation, d’autre part. Vers la fin de l’époque coloniale, on comptait près de 2.500.000 agriculteurs répartis dans une centaine de paysannats permettant à la Colonie de s’autosuffire sur le plan alimentaire et de se classer parmi les grands exportateurs des produits agricoles. Cependant, le lotissement ont évolué sans cadre légal suscitant de nombreux conflits suite à la violation des propriétés des domaines fonciers appartenant à des communautés parentales, et, par-dessus tout, à la tentative d’éclatement du cadre et de l’autorité traditionnels ainsi que la dilution de la responsabilité et de la propriété collectives du fait de l’isolement imposé aux paysans lotis . En 1947, devant la pression des sociétés cotonnières dont le nombre de planteurs diminuait de manière constante, le gouvernement colonial engagea des études qui débouchèrent sur l’approbation, en 1949, de la constitution des coopératives par les indigènes en vue de leur stabilisation et intégration dans les coopératives de consommation . Au-delà des coopératives créées par les autorités coloniales, les compagnies privées, les missionnaires et même les autochtones prirent l’initiative de la fondation de certaines coopératives, à l’exemple de la coopérative des produits agricoles du Manianga (COPAM). Afin de doter le mouvement coopératif autochtone d’un cadre juridique, l’Etat colonial édicta les principes généraux régissant l’agrément et le fonctionnement des coopératives au Congo Belge et Ruanda-Urundi, suivant le décret du 16 août 1949. Celui-ci fut abrogé par le décret du 4 mars 1956 portant autorisation de création des coopératives indigènes. Ainsi, 77 coopératives, créées en exécution du décret précité, furent en activité à la fin de 1958. Toutefois, l’essor du mouvement coopératif a été brisé par suite de la discrimination raciale et de la confiscation des libertés publiques, entraînant des contrôles excessifs, de mesures par trop restrictives et l’immixtion de l’Etat colonial dans la gestion des sociétés coopératives indigènes en violation des principes de « gestion démocratique » et de « porte ouverte ». A titre d’illustration, l’analyse du décret du 24 mars 1956 révèle de nombreuses dispositions liberticides sous forme d’accords préalables (articles 7,16 et 22), sélection des créanciers de la coopérative (article 16), droit de veto sur les décisions des organes de gestion coopérative (article 21), contreseing du Gouverneur de Province ou de son délégué dans tout acte engageant la coopérative pour un montant supérieur à un seuil fixé d’autorité. La tutelle administrative était telle que les ruraux, en particulier, ne pouvaient pas concevoir que les coopératives étaient « leur affaire », d’autant plus qu’elles ne répondaient pas à une réelle nécessité économique pour les membres . 9.2. Le mouvement coopératif Congolais après 1960 Après l’indépendance politique, de nombreuses coopératives agricoles fermèrent consécutivement au départ des colons et, surtout, à celui de l’autorité coloniale qui fut, pendant toute l’époque coloniale, la source principale d’appui technique, matériel, financier et juridique des coopératives. A la faveur de la restauration des libertés publiques, le Gouvernement, les confessions religieuses et les particuliers constituaient un grand nombre de coopératives de 1960 à ce jour. Dans la foulée, le Vicaire Bernard tenta en 1964 la création d’un kibboutz à 4 Km du village Kinkole, avec les membres de l’Association de jeunes ouvriers de Léo-Ndjili. Sur le plan juridique, les experts de l’ONU en mission au Congo, entourés d’un groupe de fonctionnaires locaux, avaient entrepris en 1963, sans succès, la révision de la législation coloniale sur la coopération. De même, en 1968, le projet de loi sur les coopératives agricoles avait été rejeté. Ce n’est qu’en 2002 qu’a été promulguée la loi n° 002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de crédit, soustrayant celles-ci du régime général institué par les colons. Mais l’expérience coopérative postcoloniale s’avère être un échec dans la mesure où son action n’a pas eu une incidence ni sur la vie des membres, ni sur le reste de la communauté nationale. Les raisons de cette contre-performance sont principalement la faible participation des masses dans la conception et la gestion des coopératives, l’ignorance de l’idéologie coopérative et l’absence d’encadrement des pouvoirs publics. Ces derniers ont, non seulement laissé la législation coloniale fournir les principes devant gouverner les activités coopératives, mais aussi renfermé les coopératives dans des carcans juridiques en faisant d’elles, toutes, des sociétés commerciales, en violation de la doctrine et de l’esprit coopératifs. En effet, les origines de la plupart des coopératives sont exogènes : soit à l’initiative d’experts expatriés, des missionnaires, de la diaspora ou des citadins vivant en dehors des activités coopératives. Or, il est établi que tout ce qui est fait pour aider autrui sans sa participation va, paradoxalement, contre ses aspirations et ses intérêts. Dans la plupart des cas, les promoteurs, les minorités influentes, et les employés coopératifs ont détourné les activités coopératives à leur profit. C’est le cas des coopératives créées ou réhabilitées à partir de 1997, pour s’occuper du recouvrement des recettes publiques et de la paie des fonctionnaires en lieu et place des comptables publics. D’où, l’urgence d’une action visant la résorption des goulets d’étranglements politique, juridique et financier en vue de susciter l’éveil coopératif. De sa part, le gouvernement congolais devrait réviser la loi-cadre en y intégrant les principes fondamentaux du coopératisme aux fins de garantir une gestion réellement démocratique des coopératives et d’assouplir la procédure de leur création, de sorte que les coopératives à vocation nationale soient enregistrées au niveau central et que les autres le soient à l’échelon de l’administration des provinces, des villes, des communes, des secteurs et localités, selon que leurs activités se circonscrivent respectivement dans ces entités . En priorité, le gouvernement devrait engager les réformes du système éducatif en vue d’améliorer le capital humain dans tous les secteurs socioéconomique et politique en mettant un accent particulier sur la formation des coopérateurs. Ainsi, l’on pourra bâtir une «économie sociale coopérative» dans laquelle les « middle classes », constitués de ruraux et autres exclus du système capitaliste colonial, joueront un rôle prépondérant. A tout prendre, le mouvement coopératif congolais, contrairement aux expériences réussies dans les pays occidentaux, n’a pu induire l’accroissement de la production et du revenu, pas plus qu’il n’a permis le transfert technologique et managérial. Par ailleurs, l’échec du mouvement coopératif en République Démocratique du Congo est dû à l’abandon du monde rural par le Gouvernement. Cela se traduit par l’insuffisance, dans l’arrière–pays, de services techniques d’encadrement, d’organismes de financement et d’infrastructures sociales, éducatives, commerciales et communicationnelles. Ici, comme partout ailleurs en Afrique Subsaharienne, les masses rurales marginalisées ont été réduites à fournir la main-d’œuvre bon marché aux gros exploitants, souvent, étrangers . Cette situation est symptomatique de la médiocrité des politiques coloniale et postcoloniale de développement qui ont bloqué le processus de transformation de l’économie traditionnelle africaine en une économie moderne d’échange, comme nous le démontrons dans les lignes qui suivent. DEUXIEME PARTIE LE PASSAGE DE LA SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE A LA MODERNITE CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA MUTATION DE LA SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE VERS L’ECONOMIE MODERNE Des études récentes expliquent la pauvreté et les famines en Afrique Subsaharienne par le fait, entre autres, que les économies de quasi-subsistance héritées de la colonisation n’aient pas pu se transformer, après les indépendances, en économies modernes d’échange, en raison des politiques médiocres . Dans cette partie de notre étude, nous examinons rétrospectivement les mutations socioéconomiques et politiques que cette région a connues afin de mettre en relief toutes les contraintes fondamentales à son essor. A cet effet, il convient de rappeler le concept de démarrage économique classique, lequel permet de circonscrire les problèmes généraux de développement. 2.1. CONCEPTION CLASSIQUE DU DEMARRAGE ECONOMIQUE Le démarrage est le passage d’une société traditionnelle à une société utilisant systématiquement les vastes possibilités qu’offrent la science et la technologie modernes . Selon W. W. ROSTOW, c’est la période pendant laquelle une société finit par renverser les obstacles et les barrages qui s’opposaient à sa croissance régulière. Dans cette étape, les facteurs de progrès économique élargissent leur action et en viennent à dominer toute la société. A partir de ce moment, la croissance devient la fonction normale de l’économie ; les intérêts composés s’intègrent dans les coutumes et dans la structure même des institutions. Cependant, le passage, de la société traditionnelle à la société moderne, ne peut se faire sans une période de transition au cours de laquelle la société elle-même crée les conditions préalables au démarrage. Dans l’histoire économique, ces conditions se sont créées en Europe occidentale à la fin du XVIIe siècle par suite, d’une part, de l’application des innovations scientifiques et techniques à l’agriculture ainsi qu’à l’industrie, et d’autre part, de l’effet du dynamisme nouveau imprimé à l’économie par l’expansion latérale des marchés mondiaux et la concurrence internationale . Toutefois, de nos jours, on constate que le démarrage n’est pas souvent enclenché par une cause interne, mais à la suite de la pression exercée de l’extérieur par des sociétés plus développées. Ces invasions, au sens propre ou au figuré, sont susceptibles d’ébranler les sociétés traditionnelles et d’amorcer le processus de modernisation. Aussi, en Asie de l’Est, le Japon et les « quatre tigres » (Hong-Kong, Corée, Singapour et Taiwan) ont-ils contribué, au cours de deux dernières décennies, à l’essor du commerce intrarégional et transféré à grande échelle leur capital industriel à leurs voisins pauvres, après avoir largement augmenté leur capacité technologique et leur productivité ainsi que la rémunération de leur main-d’œuvre . Dans tous les cas, la période de transition entre la société traditionnelle et l’étape du démarrage se caractérise par le développement de l’économie à un rythme modéré avec recours aux méthodes traditionnelles à faible rendement. L’idée de progrès économique se répand de plus en plus dans la société ; l’instruction étend son objet et s’adapte aux besoins de l’activité économique moderne. Sur ces entrefaites, les différentes composantes de la société, individus ou groupes d’intérêts, prennent progressivement conscience de la nécessité de révolutionner les affaires publiques et l’économie nationale. Pour répondre à cet appel de la société, un nouveau type d’hommes, très entreprenants, apparaissent dans le secteur privé et dans l’appareil étatique, décidés à mobiliser l’épargne et à prendre des risques pour moderniser le pays . Ainsi, les banques et les autres institutions financières se créent ; les investissements s’accroissent, notamment dans les transports, communications et dans les secteurs primaire et secondaire. Des nouvelles industries de transformation se développent en utilisant des nouveaux procédés. Dans l’ensemble, le commerce, intérieur et extérieur, connaît un essor considérable. Néanmoins, les structures et les valeurs sociales traditionnelles et les institutions politiques à base régionale persistent encore pendant cette période de transition. En conséquence, l’étape du démarrage ne pourra effectivement s’amorcer que lorsque, sur le plan politique, il sera question d’édifier un Etat national centralisé et efficace qui s’appuiera sur des coalitions teintées d’un récent nationalisme, en opposition avec les intérêts régionaux traditionnels, avec le pouvoir colonial ou avec l’un et l’autre ensemble . A ce stade, l’élite prend pleinement conscience de ses responsabilités dans la recherche des voies et moyens de résoudre les problèmes existentiels de gens du peuple (nourriture, logement, eau, énergie, santé, éducation, sécurité…). Plus il y aurait de scientifiques, de professionnels et d’experts consciencieux, vite le pays évoluerait dans la voie du progrès social . Car, comme l’affirme John Maynard Keynes, l’essor économique ne dépend pas de l’excellence de quelques individus, mais de l’échelle à la quelle on peut produire des hommes compétents dans toutes les professions, c’est-à-dire la pérennisation du capital humain qualifié . Il convient de noter que pendant cette mutation, les taux de l’investissement et de l’épargne s’élèvent et, dans certains cas, avec l’appui des capitaux étrangers. Le développement industriel entraîne des effets positifs dans d’autres secteurs (services, habitat…), tandis que les revenus des agents économiques augmentent. On assiste alors à une migration de la main-d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie et les services, d’une part, de la manufacture ancienne vers les industries de substitution émergentes, d’autre part . Au-delà de tous ces changements, le démarrage ne peut réussir qu’à condition d’une modification radicale de la productivité de l’agriculture puisque la société qui se modernise devient de plus en plus tributaire de la production agricole. Il n’y a pas de révolution industrielle sans une mutation agricole préalable ou concomitante. En ce qui concerne particulièrement les pays de la zone tropicale, Arthur LEWIS démontre qu’ils ne peuvent rééquilibrer à leur profit les termes de l’échange et relever leur revenu national qu’en améliorant les rendements de la production agricole vivrière, et non ceux de cultures d’exportation . En réalité, l’accroissement de la production agricole destinée à l’exportation n’a pour seul effet que la baisse du niveau des prix sur les marchés internationaux étant donné la stagnation de la demande mondiale . A tout prendre, le démarrage implique l’intégration de tous les secteurs de l’économie nationale en vue de la création d’une agglomération économique dynamique susceptible de développer les échanges commerciaux et d’attirer les capitaux étrangers. Il faut se rendre à l’évidence qu’il est difficile de démarrer un processus d’industrialisation en vendant sa production industrielle à l’étranger. En général, l’on commence par exploiter le marché intérieur, que l’on connaît et qui est protégé pour passer, plus ultérieurement, à l’exportation qu’après avoir appris à rendre ses coûts concurrentiels . De cette manière, tout le potentiel de croissance disponible sera utilisé à mesure qu’on se met en branle pour la conquête des marchés extérieurs offerts par le mouvement de mondialisation . En dernière analyse, la conception classique du démarrage économique de W. W. ROSTOW n’est que la description de la filiation des mutations intervenues lors de deux premières révolutions industrielles. Celle qui a tiré son origine du développement de l’exploitation du charbon, de l’acier et du textile, ainsi que celle déclenchée par les progrès de la mécanique, de l’automobile et de l’utilisation du pétrole et de l’électricité, avec les marchés comme talon d’Achille . Graphique 1. Le cycle international de production industrielle. Source : MICHAEL WALTON, « Asie de l’Est : l’enfant prodige devient adulte » in Finances et Développement, septembre 1997, p.8. En réalité, l’histoire économique n’en a pas moins continué d’évoluer à la vitesse des innovations techniques. En effet, depuis le début des années 70, la microélectronique et l’informatique ont métamorphosé les modes de production de la quasi-totalité du secteur industriel et signé l’entrée des sociétés occidentales dans une troisième révolution industrielle . Des nouveaux matériaux, la biotechnologie et l’automatisation ont généré des nouvelles fabrications, révolutionné la conception des produits existants, dépassé les formes traditionnelles d’organisation du travail et de la production entraînant l’essor de nouvelles industries, la crise et le chômage dans les secteurs traditionnels . Une nouvelle géopolitique de l’économie et de l’industrie a pris naissance à l’avantage des pays qui regorge des hommes et de structures capables de s’adapter aux exigences du progrès .Tous les pays du monde doivent relever les nouveaux défis que posent la mondialisation, la compétition technologique, la pollution de l’environnement, la crise de l’énergie, la menace des armes nucléaires, le terrorisme, la corruption… Ne pouvant rivaliser avec les pays émergents, dont la Chine, en matière de prix, les pays occidentaux sont appelés à accélérer la recherche et l’innovation technologiques afin de maintenir leur suprématie et conserver un modèle assurant une forte productivité et une large protection sociale. Les économies émergentes, pour leur part, s’activent autour d’une feuille de route stratégique pouvant résorber leurs contraintes institutionnelles et structurelles, l’inégalité des revenus et la fracture sociale ainsi que la détérioration de l’environnement, aux fins d’optimiser leurs chances de maintenir une croissance soutenue. La succession rapide d’échecs et de succès démontre que la réussite économique ne dépend plus de caractéristiques culturelles ou institutionnelles nationales permanentes, mais d’un bon climat politique, de l’efficacité des politiques macroéconomiques et sectorielles ainsi que la maîtrise des mouvements cycliques (expansion et récession) par-delà les chocs endogènes et exogènes. L’action des pouvoirs publics est devenue tellement déterminante qu’elle explique pourquoi certains pays arrivent à conserver des taux de croissance élevés et non pas d’autres . L’Afrique Subsaharienne, quant à elle, privée de toute initiative en matières politique et économique, a subi le contrecoup de trois révolutions industrielles sans pouvoir véritablement amorcer son démarrage économique. En effet, la transplantation de la législation et des structures socioéconomiques occidentales pendant la période coloniale a provoqué la résistance de la société africaine traditionnelle, donnant naissance à un système dualiste et contre-productif, juxtaposant deux secteurs et deux modes de production, moderne et traditionnel, au profit exclusif des colons. Plus tard, la décolonisation a, qui pis est, favorisé la fondation des Etats artificiels orientés vers les objectifs économiques des puissances métropolitaines en complicité avec l’aristocratie locale, au lieu d’apporter une vraie révolution. Les facteurs de croissance économique ne pouvaient pas être réunis dans un contexte caractérisé, non seulement, par la reconduction du système capitaliste colonial, mais aussi, par la persistance et la perversion des structures ainsi que des valeurs sociopolitiques et économiques traditionnelles . Tous ces obstacles au passage de la société traditionnelle à l’économie moderne d’échange font l’objet de la prochaine section du présent chapitre. Mais auparavant, il sied de préciser les caractéristiques fondamentales de la société africaine précoloniale. 2.2. LA SOCIETE AFRICAINE PRECOLONIALE Sans avoir une vision immobiliste de l’histoire de l’Afrique, nous tentons, dans les lignes qui suivent, de reconstituer la société africaine traditionnelle, avec ses traits culturels, en remontant à la période de son apogée, entre le XIIe et le XVIe siècles, avant l’impact décisif des interventions extérieures sous forme de traite de Noirs et de colonisation. Toutefois, les actions et les réalisations des siècles précédents ont également influencé nos réflexions . 2.2.1. Aperçu historique de l’Afrique précoloniale Par-delà les particularités de chaque groupe ethnique, l’analyse de l’histoire précoloniale permet d’appréhender les similitudes dans l’organisation politique, judiciaire, économique et sociale des peuples africains. 2.2.1.1. Organisation politique, administrative et judiciaire Avant l’époque coloniale, l’Afrique avait déjà dépassé le stade archaïque d’organisation clanique ou villageoise. Elle s’était hissée à un niveau supérieur d’organisation conventionnelle, artificielle, géographique plus étendue, sous forme de royaumes ou empires fondés sur la solidarité interethnique . L’un des plus anciens royaumes est celui de KOUCH, appelé encore MEROE ou NAPATA, situé sur le territoire de l’actuel SOUDAN. Celui-ci fut d’abord soumis à l’Egypte avant de devenir indépendant vers l’an 800 avant Jésus Christ et, à son tour, domina le pays des pharaons. Méroé, sa capitale, la plus fameuse, fut un haut lieu de civilisation. C’est elle qui, semble-t-il, a transmis ses éléments les plus féconds à l’Egypte pharaonique . En parcourant l’histoire africaine, on découvre un grand nombre d’empires et de royaumes dotés d’une organisation politique et administrative efficace . Sur le plan administratif, les Etats africains précoloniaux étaient subdivisés en provinces, districts et villages nettement limités, et jouissant de l’autonomie de gestion. Cela assurait la participation de chaque membre à la vie sociopolitique et économique. De la même manière, on distinguait le gouvernement central, de l’administration provinciale, sur le plan politique. Le Roi était l’autorité suprême dont le pouvoir avait un caractère surnaturel, astreignant ses sujets à une fidélité indéfectible. Il était choisi parmi les membres de la famille royale par l’assemblée des chefs politiques et religieux. Cependant, l’Etat était dirigé à partir de la cour royale composée, selon le cas, d’un conseil d’Etat dont les conseillers étaient désignés dans la famille royale ou dans celles des grands dignitaires. En outre, la reine mère, les officiers du palais, le conseil des chefs de village, des devins, des prêtres occultes ou féticheurs faisaient partie de ladite cour. En réalité, tous ces organes gouvernaient et contrôlaient presque toutes les décisions du Roi. La défense du Royaume était assurée par une garde royale soumise à la discipline militaire. Les finances publiques étaient gérées avec transparence. Les recettes, constituées de quelques tributs annuels sous forme de redevances en numéraire ou de dîmes en nature, étaient portées au Roi au cours d’une cérémonie solennelle. C’est aussi à cette occasion que le Roi programmait les dépenses publiques, le reliquat était affecté aux dépenses de la maison royale. Quant à l’administration provinciale, elle était dirigée, suivant la hiérarchie, par les gouverneurs, les chefs de différents districts et villages. Les gouverneurs, gérants du domaine royal, étaient nommés par le Roi parmi les descendants des chefs de clan relevant de sa juridiction, tandis que les chefs de district et de village étaient choisis par les gouverneurs. Toutes les autorités politico-administratives locales avaient pour fonction de recueillir les impôts, et leurs performances étaient sanctionnées par le Roi. En plus, elles assumaient des fonctions religieuses. L’équilibre de la vie sociopolitique du royaume était maintenu grâce, d’une part, à la tenue régulière des cérémonies religieuses auxquelles assistaient les devins et les prêtres et, d’autre part, à la pratique des palabres où les opinions étaient librement exprimées. Ainsi, les grandes questions socioéconomiques et politiques y étaient largement débattues, de sorte que les résolutions dans ces domaines rencontraient l’adhésion de toutes les couches de la population . Bien qu’ayant les apparences d’une autocratie, les royaumes ou empires africains se situaient au sommet de la pyramide des groupements communautaires jouissant de l’autonomie de gestion et assurant la participation de chaque membre à la vie de sa communauté. Cette participation se réalisait par le mécanisme de délégation du pouvoir représentatif aux élus des conseils, et par les dignitaires de la cour du Roi, soit par consultations populaires plus ou moins directes, où l’on tenait compte de l’avis de chaque membre, de chaque famille et de chaque village. Manifestation de la solidarité interethnique, les royaumes ou empires africains n’étaient pas à proprement parler des monarchies absolues. Le pouvoir du chef était tempéré par le rôle décisif des chefs de village, les associations mystiques, les groupes de classe d’âge, les confréries d’initiation ou les communautés fraternelles qui avaient, les uns, des fonctions consultatives, les autres, des rôles de conseiller ou de contrôleur général. A dire vrai, le Roi africain ne pouvait être un dictateur au sens où un chef d’Etat est souvent, de nos jours, le maître de la vie ou de la mort de ses concitoyens. Sur le plan juridique, le Roi avait la prérogative d’élaborer les lois en conformité à la coutume et ce, avec l’aide des conseils des dignitaires, des grands chefs et prêtres, tous, gardiens des traditions. Contrairement au droit occidental hérité de l’époque coloniale, et dont la maîtrise exige des études aussi laborieuses qu’approfondies, le droit africain se caractérisait par la simplicité des lois, des procédures judiciaires et de vulgarisation. En effet, dès l’âge de maturité, tout membre était initié au droit positif et pouvait véritablement y être assujetti. Les nouvelles lois étaient régulièrement proclamées sur les places publiques : marchés, arbres à palabres… C’était un système judiciaire parfaitement intégré dans la vie de la société, et non une doctrine ésotérique exceptionnellement utilisée dans le règlement des conflits sociaux et le maintien de l’ordre public. Les juges du tribunal du Roi et de ceux des gouverneurs avaient la charge de dire la loi en recourant à un code pénal sévère : la trahison était punie de mort, l’outrage au Roi exposait au bannissement perpétuel ou à l’esclavage. La mort et la honte publique sanctionnaient respectivement le meurtre et le vol. Cet arsenal était complété par les épreuves judiciaires mystiques dans la conduite des investigations. Toutefois, la distribution de la justice avait pour préoccupation de préserver l’harmonie sociale et non la confrontation multiforme des parties. Ainsi, dans les affaires civiles, le juge recherchait le compromis, c’est-à-dire un large terrain d’entente plutôt qu’une sentence tranchée. Tous les actes juridiques étaient entourés d’un formalisme et d’un rituel qui leur donnaient plus de force, en fondant la pression de la communauté sur les acteurs. La société tout entière prônait un puritanisme profond, à telle enseigne que ses membres ne pactisaient pas avec le vice mais le dénonçaient, comme la sagesse populaire recommandait de crier au secours dès l’apparition d’un fantôme. Ils ne démissionnaient pas, comme c’est le cas aujourd’hui, au profit du cercle fermé des procureurs, juges, magistrats, avocats, détectives… En conclusion, la responsabilité collective assurait l’efficacité de l’appareil judiciaire traditionnel africain. 2.2.1.2. Organisation socioéconomique L’organisation socioéconomique de l’Afrique ancienne visait la réalisation de la cohésion intégrale de la société en assurant les besoins matériels et l’épanouissement de chaque membre . Contrairement à l’opinion généralement répandue, les structures socioéconomiques précoloniales n’étaient pas rudimentaires. En effet, plusieurs royaumes prospères avaient tissé dans leurs territoires un système de marchés qui favorisait les échanges intérieurs . A. Organisation sociale L’Afrique précoloniale était marquée par une éternelle tradition de vie communautaire, de solidarité et d’entraide, sous l’empire d’un régime coutumier . L’organisation sociale du continent noir était, de longue date, fondée sur le clan ou le village, pivot du système socioéconomique et politique de la société traditionnelle. Celle-ci était, en fait, très paternaliste et hiérarchisée. Elle se subdivisait en groupes en fonction de l’âge, du sexe et de la catégorie sociale. On pouvait distinguer les anciens des jeunes, les hommes des femmes, les citoyens libres des esclaves. Dans chaque groupe, les membres étaient égaux et pouvaient accomplir des actes spécifiques. Mais les relations d’un groupe à l’autre, étaient hiérarchisées, les plus jeunes étant nettement subordonnés aux plus anciens, les femmes aux hommes, les esclaves aux hommes libres. Les individus ne pouvaient aller au-delà de leur propre cercle sans l’autorisation du père ou de quelque autre autorité . C’est à partir de cette organisation clanique qu’était aménagé un espace économique fonctionnel et viable assurant aux ménages les meilleures conditions de santé et de travail ainsi que tout leur épanouissement . Chaque individu jouissait du droit à la vie, du droit au travail, du droit de fonder une famille, de participer à la vie économique, culturelle et politique de sa communauté. En réalité, le droit de chaque membre à la vie impliquait son intégration à son groupe social, au sein duquel il bénéficiait de la solidarité des autres par la mise en commun des moyens de subsistance de tous, dans un environnement naturel où il aurait été difficile de perpétuer son existence isolément. De toute évidence, deux personnes avaient plus de chance de survivre qu’une seule dans le désert aride de Kalahari ou dans la forêt dense du Congo. « L’union fait la force »est donc la devise fondamentale de l’esprit communautaire Africain. Selon les études de nombre d’auteurs contemporains, l’attitude de l’Africain est empreinte de la recherche permanente d’un équilibre avec autrui et avec le surnaturel . C’est ainsi qu’il prend sur lui de préserver l’harmonie avec les mânes et les esprits auxquels il rendait un culte et offrait des sacrifices par l’entremise des devins, prêtres et autorités politico-administratives. De même, il accordait une importance primordiale aux relations interpersonnelles ou interclaniques, lesquelles étaient entretenues grâce aux activités socioculturelles (célébration des événements heureux ou malheureux), ainsi qu’aux pratiques consolidant la dynamique d’amour, d’unité et de justice (agapes, travaux collectifs, partage du gibier, de la moisson, …). La famille élargie d’abord, la tribu et l’ethnie, ensuite, étaient toujours présentes dans la vie de l’homme africain, et étaient, à tout moment, susceptibles de s’imposer. L’allégeance au clan, à la tribu ou à l’ethnie prévalait sur l’autonomie et l’intérêt personnel, de telle manière que la frontière entre les priorités collectives et individuelles demeurait floue, sinon inexistante. A tout prix, il fallait maintenir les équilibres sociaux et l’équité, plutôt que de favoriser la réussite économique individuelle. En effet, l’individu appartenait au clan et vivait par le clan, lequel encadrait ses besoins existentiels. « Tout ce qu’il possédait passait par le clan et ne lui appartenait pas en propre » . Tel est le credo qui sous-tendait le communautarisme africain comme nous l’élucidons dans la section suivante. B. Organisation de la production et la redistribution du revenu. Ainsi que nous venons de le souligner plus haut, les Africains avaient ressenti, depuis une époque immémoriale, la nécessité de mettre en commun leurs moyens pour faire face plus efficacement aux nombreuses difficultés du milieu naturel. Expérimenté avec succès dans la cellule familiale, le communautarisme s’imposa, par suite de l’évolution sociale, aux niveaux de clan, tribu et ethnie. Cette mutation fut aisée du fait qu’en remontant loin dans le passé, la cellule familiale donna naissance à des communautés villageoises homogènes, si bien que des nombreux villages ne furent constitués que des descendants d’un ancêtre commun . A travers l’histoire africaine précoloniale, le système de production communautaire suscita l’esprit grégaire en stimulant le processus d’élargissement de la famille, notamment l’intégration de plusieurs villages. Ces communautés villageoises devinrent rapidement la plaque tournante de la vie économique de l’Afrique et assura l’équilibre permanent dans le partage des ressources, de manière à doter chaque lignée de terres cultivables propres, de bois ou de brousses pour la chasse et la cueillette, de tronçons de rivières ou d’étangs pour la pêche… . Il va de soi que les liens de parenté entre les membres d’un même village ravivèrent l’entraide, la solidarité et l’élan de participation au travail de subsistance collective . Sur le plan de la doctrine économique, le système traditionnel permit la réalisation d’une économie autocentrée, laquelle fonctionna pour répondre aux besoins des agents internes. Seule, la production résiduelle fit l’objet du commerce local et extérieur. Par ailleurs, l’économie traditionnelle tendit toujours vers son équilibre naturel grâce à une évolution stable de la production, de prix, de l’emploi, de la monnaie… Du point de vue stratégique, la mise en commun des forces de production augmenta la dynamique du groupe, releva ainsi le rendement moyen et le stabilisa à un niveau suffisant même en cas de maladie ou de pénurie. Sur le plan psychologique, le système de production traditionnel suscita, dans le chef de chaque citoyen, la discipline, l’abnégation et l’amour de sa communauté parce qu’il se basa sur l’honneur et la fierté d’être utile aux autres membres. En outre, le communautarisme modela les structures sociales par une division de travail dynamique fondée sur les corporations ou les castes exerçant les activités économiques spécifiques. Néanmoins, la cohésion à l’intérieur et entre les groupes sociaux fut renforcée par certaines pratiques notamment : les agapes organisées par le chef de clan, les cases communes pour les jeunes d’un même âge et d’un même sexe… Loin d’inhiber les membres de la communauté, ce système distribua à chacun un rôle et un statut social précis, excitant sa conscience face à ses responsabilités, de manière à garantir sa motivation, sa créativité et sa participation à la vie socioéconomique et politique. Plusieurs techniques furent mises à contribution pour la prospérité de l’Afrique précoloniale. Il s’agit, entre autres, du travail agricole en groupe (défrichage, abattage des arbres, labour, récolte…) et de l’aménagement de l’habitat, sur fond d’une grande richesse culturelle, artisanale, médicale… En ce qui concerne la phase de redistribution du revenu, il convient de relever qu’elle répondit au souci de préserver les équilibres sociaux et l’équité. Aussi, la production individuelle et le revenu tiré de celle-ci subirent-ils une redistribution directe au profit de la famille élargie, d’abord, du clan, ensuite, et de l’autorité suprême (impôt royal) et de prêtres occultes, enfin . Toute velléité à l’égoïsme en vue d’une réussite personnelle fut punie d’ostracisme d’autant plus que la propriété individuelle ne fut assise que sur le résidu de cette longue redistribution. En tout état de cause, le communautarisme prôna la propriété collective : le sol appartint au clan, mais fut réparti équitablement entre les membres, dans le respect de l’équilibre social et environnemental, en vue de l’exploitation individuelle. Le système de production traditionnel ne peut donc pas être assimilé au mode de production capitaliste, ni à la collectivisation socialiste des moyens de production, ni au mode de production féodale (esclavage) . Des études archéologiques ont confirmé la réalité du système africain traditionnel : en Ethiopie et dans la boucle du Niger, il a été découvert des fossiles retraçant les activités agricoles et de l’élevage datant de 10.000 ans avant notre ère. Tandis qu’en Afrique méridionale, on a retrouvé les vestiges de l’exploitation minière, ‘’une civilisation de la mine’’. De même qu’au Zimbabwe, subsiste le reste des grandioses édifices publics construits entre le Ve et le XVIIIe siècles. A travers l’expérience de vie communautaire, l’Afrique noire bâtit des royaumes prospères et développa des relations commerciales avec les autres régions dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme nous l’explorons ci-après. C. Organisation du commerce Le développement du commerce en Afrique précoloniale fut lié à l’avènement des communautés villageoises, lesquelles constituèrent, à cette époque, la base de la structure socioéconomique et politique. Dans ce système collectiviste, la production du ménage fut soumise aux prélèvements des instances qui contribuèrent à sa réalisation (Roi, prêtres occultes, clan, famille élargie). Seule, la quotité résiduelle appartint au ménage en propre, et peut être mise sur le marché après rétention de la part de subsistance. En remontant loin dans le passé, on découvre les échanges courants entre les habitants d’un même village, d’une part, et entre eux et leurs voisins, d’autre part. Conçus sous forme de troc, ces échanges connurent, par la suite, l’utilisation de la monnaie : objets rares, barres de cuivre et lingots en forme de H dans les civilisations minières du Zimbabwe (au XVIIIe siècle) ; petites pièces de toile d’herbe, pièce d’étoffe, Nzimbu, coquilles ou cauris dans le Royaume Kongo (XVIe siècle) ; monnaie éthiopienne alignée sur les poids successifs des pièces d’or romaines (au IIIe siècle) . L’ampleur de ces activités commerciales fut telle qu’elles engendrèrent des marchés très bien structurés placés sous le contrôle des chefs de district qui les hébergea. Loin d’être une économie de subsistance, la société africaine précoloniale offrit les conditions économiques favorables au maintien d’une structure commerciale concurrentielle. En effet, la liberté d’accès au marché fut garantie. Une multitude d’agents économiques y opérèrent à la fois comme vendeurs et acheteurs. La distance et le moyen de transport de marchandises imposèrent une limite aux quantités offertes ou demandées par individu. De même, l’étroitesse du territoire commercial et les relations de parenté et d’amitié entre acteurs, assurèrent la transparence sur le marché. Cela atténua les abus de la spéculation au point que les négociations se firent au juste prix. D’où la stabilité des prix et des autres conditions de marché. Les excédents de production sur la consommation des collectivités locales alimentèrent le commerce extérieur avant notre ère. Depuis l’époque hellénistique (IIIe siècle avant Jésus-Christ), le Royaume KOUCH-Méroé, très prospère, développa des relations commerciales avec les Ptolémées (souverains d’Egypte) . A la suite du royaume précité, l’Ethiopie – Axoum s’assura le monopole du commerce du Sud et de la mer Rouge qui, jadis, fit la grandeur des seuls royaumes Sud-arabiques, producteurs d’encens et d’Aromates . Parallèlement, les ports de la côte orientale africaine prospérèrent grâce au commerce avec l’Asie, du Ier au XVe siècles après Jésus-Christ. Le fer, l’or et l’ivoire africains y furent échangés contre des cotonnades et des perles indiennes, et des porcelaines chinoises. Le Zimbabwe exporta des métaux vers l’orient jusqu’à l’interruption de ce commerce par les Portugais au XVe siècle. Il est donc erroné de croire que l’économie africaine précoloniale fut autarcique. Les faits historiques susévoqués prouvent que, sous l’empire du système communautaire, les africains sont restés assez motivés et créatifs pour fonder des royaumes puissants. De plus, les activités commerciales y accrurent régulièrement entre villages avant d’atteindre les autres continents. Au cours de cette longue période précoloniale, l’Afrique cultiva des valeurs morales et spirituelles qui constituent, sans conteste, l’humanisme africain. 2.2.2. Originalité de l’humanisme africain Il se dégage de l’analyse historique que nous avons menée précédemment que la société africaine traditionnelle se caractérise par une structure ‘’unioniste’’, combinant mécanisme mystique (spiritualisme), mécanisme socioéconomique (communautarisme) et co-responsabilité des palabres (participation politique et justice sociale). Elle présente une force remarquable d’intégration : les forces centripètes absorbent spontanément les forces centrifuges en vue d’imprimer à l’ensemble une grande stabilité institutionnelle. En dernière analyse, les valeurs qui constituent l’originalité de l’humanisme africain peuvent être résumées comme suit : 1. le caractère sacré de la vie humaine, chaque être humain étant tenu pour une part de divinité ; 2. la solidarité dont l’homme est entouré au sein du groupe et l’hospitalité en dehors de celui-ci ; 3. le sens de possession matérielle peu développé dans le chef de l’individu ; 4. la négation du profit individuel comme moteur de l’histoire ; 5. la voie de promotion collective ; chacun pour tous et tous pour chacun ; 6. l’homogénéité sociale assez grande et absence de classe vampire accumulant des richesses comme puissance ou tremplin pour la domination sociale ; 7. la grande identification entre superstructure et infrastructure, entre gouvernants et gouvernés ; 8. la primauté du spirituel sur le matériel : tout s’explique en fonction d’un système métaphysique préétabli . Si les valeurs humanistes africaines ont, selon toute vraisemblance, inspiré les premiers penseurs du socialisme et du coopératisme européens, leurs vertus progressistes peuvent favoriser, aujourd’hui encore, la formalisation du système coopératif africain . Cela est si vrai que ces valeurs influencent jusqu’à ce jour le comportement économique de l’Africain et l’imprègnent des réflexes économiques propres dont toute politique de développement, si elle tient à être efficace, devrait intégrer . Les chercheurs et stratèges politiques ne devraient jamais perdre de vue que l’africain est un être pleinement social, en ce sens qu’il aspire à l’union, à la communion et à la coopération avec ses semblables . Cependant, tout humaniste que fût l’organisation socioéconomique et politique traditionnelle, les faiblesses propres à son aristocratie firent de l’Afrique un terrain de prédilection pour l’esclavage et la colonisation. Pendant cinq siècles, les puissances étrangères détruisirent, avec acharnement, une importante partie des structures coutumières en battant en brèche les formations politiques précoloniales par le recours à un arsenal juridique qui maintint les Africains dans un état de subordination politique, économique et sociale, en dehors de toute possibilité de démarrage économique classique. C’est ainsi que fut lancée une gigantesque campagne d’expropriation et de travail forcé qui ouvra les voies du développement du système capitaliste extraverti, lequel constitue, à plusieurs titres, l’obstacle majeur au passage de l’économie de quasi-subsistance à une vraie économie d’échange. CHAPITRE III : LE SYSTEME CAPITALISTE EXTRAVERTI Les structures socioéconomiques et politiques actuelles de l’Afrique subsaharienne ne résultent pas de l’évolution normale de sa société traditionnelle mais constituent plutôt un syncrétisme hérité de l’histoire coloniale . Pour mieux comprendre le processus d’édification desdites structures et les raisons de leur pérennité, il convient de remonter loin dans l’histoire africaine notamment au XVIe siècle, au début de la traite des Noirs . Cette première intervention extérieure qui dura à peu de choses près, trois siècles et demi, du XVIe à la deuxième moitié du XIXe siècle, avait détruit littéralement la société africaine par d’innombrables ruines de ses razzias et ses ponctions humaines massives. En plus des dégâts humains, la traite provoqua ou attisa les guerres intestines qui arrêtèrent le progrès des grands empires africains. Sur le plan économique, l’Afrique devint, sous ce régime, un réservoir de main-d’œuvre bon marché pour les économies européennes et américaines. Plus tard, l’avènement de la révolution industrielle engendra un nouveau type de servitude pour ce continent déjà lourdement accablé par l’esclavage. S’étant, en fait, rendu compte qu’elles ne disposaient guère des ressources naturelles pour faire tourner le jeune appareil industriel naissant, les puissances occidentales décidèrent d’arrêter la traite pour organiser sur place en Afrique, avec la main d’œuvre africaine « stabilisée », la production des matières premières . Ces motivations mercantilistes justifièrent alors le passage de la traite à la colonisation . A son tour, la conquête coloniale infligea à l’Afrique un nouveau lot de souffrances en entraînant des pertes massives en vies humaines, des massacres et des ruines . En effet, les Nations nouvellement industrialisées se livrèrent à une concurrence âpre à seule fin de s’assurer les sources des matières premières et les débouchés pour leur production manufacturière. Ces rivalités ne s’estompèrent qu’après le partage de l’Afrique lors des assises de la conférence de Berlin en 1885. Profitant de la faible organisation, de l’isolement et de la négligeable capacité de réplique des formations villageoises africaines, les puissances impérialistes purent imposer par la ruse et la force une structure socioéconomique au service de leurs intérêts économiques et stratégiques . L’Afrique se mua alors en un véritable circuit de ramassage des produits agricoles, d’exploitation des minerais, de distribution d’articles importés et un réservoir de main-d’œuvre pour les capitalistes étrangers. A travers un système socioéconomique de domination, les groupes financiers occidentaux s’arrogèrent le droit de déterminer, en fonction de leurs besoins et de leurs exigences propres, la production africaine ainsi que les institutions économiques et sociales nécessaires. La conséquence forcée de cette politique, fut la spoliation des richesses de la colonie qui resta systématiquement pauvre et dépendante de l’économie occidentale à telle enseigne qu’il se développa dans ce continent des structures socioéconomiques et politiques extraverties. Celles-ci firent de l’Afrique un simple prolongement ou une ramification du système économique capitaliste de l’Europe et de l’Amérique du Nord, autrement dit, une région périphérique fournissant la production complémentaire et offrant des marchés marginaux pour l’excédent de production de l’économie occidentale . Néanmoins, l’implantation du système colonial se heurta à la structure unioniste africaine en ce qu’elle ne fut guère favorable à l’accumulation des richesses comme moyen d’émergence individuelle. Comme en plus, il n’y eut presque aucun terrain commun entre les colonisateurs et les colonisés, entre les deux systèmes culturels radicalement opposés, l’un collectiviste, l’autre individualiste, l’entreprise coloniale fut, de bout en bout, une brutale domination, inapte à déclencher des processus générateurs d’une association humaine supérieure (nation), et condamnée alors à être une société de juxtaposition, sans fusion . Ainsi, faute de structure d’accueil du capitalisme, la conquête coloniale prit donc la forme d’une assimilation brutale de l’Africain afin de faciliter l’exploitation économique. Les peuples d’Afrique ne devinrent que des instruments forcés d’un capitalisme parasitaire, tourné vers le développement des métropoles occidentales. Tout fut mis en œuvre pour empêcher la formation d’une véritable classe ouvrière. D’une part, la politique coloniale de l’emploi reposa sur l’instabilité des travailleurs, lesquels furent arrachés à leurs villages et leurs terres, pour exécuter des travaux forcés ou plutôt poussés par la nécessité (acquisition d’une dot, famine au village, paiement d’impôts, etc.) vers des emplois qu’ils abandonnèrent à la première occasion, volontairement, ou par licenciement, en cas de crise. D’autre part, ils furent pris en mains par des cadres européens de manière à les maintenir en état de soumission et à leur enlever toute capacité d’initiative politique et toute conscience de classe . A ce propos, le Professeur KAYEMBA NTAMBA MBILANJI constate « qu’un système aussi dissolvant, aussi écrasant et implacable pour l’autochtone, et qui devait en même temps reposer sur le même autochtone en tant que producteur ou main-d’œuvre, était évidemment un système frappé d’impuissances, à tout le moins potentiellement. » . Car l’homme africain ne pouvait certainement pas adhérer de bonne grâce à un système qui n’assurait pas son épanouissement conformément à son idéal . Pour vaincre ces impuissances, l’administration coloniale trancha dans le vif. Elle adopta la politique d’encadrement coercitif des populations noires sur les plans socioéconomique, culturel et politique. Ainsi, toutes les techniques oppressives furent appliquées sur les autochtones : déculturation, travail forcé, répression, réquisitions, culture obligatoire des produits d’exportation, strict contrôle des déplacements, expropriations massives des terres, substitution du salaire par la ration alimentaire, privation du droit à la citoyenneté et retribalisation afin de créer la zizanie, la juxtaposition des ethnies, la balkanisation des grands ensembles coloniaux… Toutes les structures sociales traditionnelles furent perverties et adaptées aux besoins de l’exploitation coloniale. La chefferie fut utilisée comme agent d’exécution. La responsabilité collective de la communauté traditionnelle se transforma en un moyen commode et économique de percevoir l’impôt, d’obtenir des travailleurs requis, des produits de culture forcée, etc. Cette oppression visa la décomposition de la société traditionnelle fondée sur la solidarité familiale sans jamais introduire à la place une structure sociale nouvelle. En conséquence, le dynamisme propre aux communautés villageoises s’émoussa entraînant la perte de l’initiative de l’Africain sur la marche des affaires du continent. La marginalisation de tout le peuple enclenchée par la traite négrière fut ainsi institutionnalisée. Une triple structure culturelle, socioéconomique et politique supprimant toutes libertés pour les autochtones (négation culturelle, négation économique et négation politique) s’implanta. Dès lors, le système colonial se pervertit en s’appuyant sur la violence, la sauvagerie, la corruption, la mystification, l’expropriation, l’injustice, la discrimination raciale, et en affirmant, de ce fait, le recours indispensable au régime totalitaire. C’est dire que la dégradation des structures traditionnelles, accompagnée de l’exploitation sauvage et de la misère généralisée créa un climat de désespoir traversé des violents sursauts de révolte ; mais dans le cadre des structures tribales traditionnelles, ces révoltes furent chaque fois isolées et réprimées . Malgré leur acharnement, les colonisateurs ne réussirent pas à abolir les groupements communautaires traditionnels ainsi que les valeurs culturelles africaines. Contre les influences coloniales qui ne suivirent pas sa « pente culturelle » et qui mirent en péril sa cohésion, l’Afrique profonde refusa d’adopter les changements lui imposés, tant et si bien que 60 ou 80 ans de colonisation ne suffirent pas à constituer des entités nationales susceptibles de transcender les ethnies et les mécanismes décisionnels traditionnels . Cette résistance amena la communauté villageoise africaine à raidir ses structures et à verser dans le conservatisme tout en manifestant son allergie au travail et une paresse cordiale dans l’édification de l’empire colonial. Il en résulta un dédoublement économique, social, culturel et technologique, à la fois dynamique (secteur capitaliste moderne) et statique (communauté villageoise) ; une dualité fonctionnelle qui provoqua la marginalisation de la communauté villageoise locale. Celle-ci devint, d’un point de vue strictement socioéconomique, une sous-structure organique de la nouvelle société. Ainsi naquit une société dualiste assurant des gros profits aux capitalistes étrangers et l’indigence aux autochtones : la société capitaliste périphérique ou extravertie . Un examen approfondi de cette société sui generis met en lumière la coexistence de deux systèmes culturels, ou plutôt deux civilisations radicalement opposées, l’une africaine, de prédominance communautaire utilisant des techniques de production traditionnelles, l’autre européenne, de prévalence individualiste dotée des techniques modernes. Sur le plan social, l’univers colonial fut divisé en deux mondes parallèles : d’un coté, le monde blanc jouissant ou prolongeant la prospérité et le confort métropolitains, de l’autre, le monde « indigène », celui de l’obscurité, privé de tous les avantages du progrès technique (infrastructures économique et sociale, instruction, revenu…). En tout état de cause, la politique coloniale s’opposa à tout brassage culturel qui eût secrété une culture supérieure, ouverte à la modernité économique, dans une nation normale où l’agriculture, l’industrie et le commerce eussent pu harmonieusement progresser. Par contre, un arsenal idéologique fut inventé en vue de justifier l’entreprise coloniale, considérée comme une œuvre civilisatrice aux fins de gagner à la faveur du colonialiste les populations métropolitaines et même les Africains dominés. Ainsi, la mainmise du capitalisme moderne sur l’Afrique noire fut accompagnée d’un maquillage culturel visant à occulter le déploiement des violences, la mise en dépendance durable, la destruction physique et morale des Africains et leur rejet du système colonial . Un véritable travail d’aliénation fut donc mis en œuvre au plan éducatif et intellectuel, au plan religieux et à travers le statut des personnes etc. Telles l’éducation au rabais, la sélection des coutumes selon leur contribution à l’exploitation coloniale, l’évangélisation au service de la colonisation . Au lieu de se limiter à présenter Jésus-Christ aux populations africaines en vue de leur élévation spirituelle dans le cadre d’un évangile de libération, l’Eglise exposa l’élite naissante à l’idolâtrie, développant ipso facto le déviationnisme qui aliéna davantage l’homme noir et provoqua plus ultérieurement la ruine de l’Afrique Postcoloniale. C’est cet arsenal idéologique qui permit au Congo Belge, non seulement de faire coexister, mais travailler main dans la main, dans une redoutable synergie, des forces aussi différentes que le Grand Capital, l’Etat colonial et l’Eglise au même titre qu’il maintint les congolais dans un état de subordination économique, sociale et politique . Sur le plan économique, le système colonial, par essence, extraverti, fonctionna pour les besoins de la métropole, sans égard au développement socioéconomique intérieur de la colonie. Le but essentiel de l’activité économique consista à produire des matières premières pour l’exportation. A cette fin, les colons, entreprirent, comme nous l’avons souligné ci- haut, de détruire toutes les structures socioéconomiques et politiques traditionnelles africaines, quitte à tolérer celles qui contribuèrent à l’exploitation coloniale. Schématiquement, la politique économique coloniale fut axée sur les actions que nous énumérons ci-après : L’exportation des matières premières à vil prix Ces exportations furent assurées par le secteur moderne (avec ses techniques avancées) qui trôna au dessus d’un secteur traditionnel désarmé. Les rapports entre les deux secteurs furent établis par l’injection dans le secteur traditionnel des biens manufacturés importés et des bas salaires en échange des impôts, de la production vivrière et de la main-d’œuvre que celui-ci fournissait à celui-là. Le système assura des gros profits malgré la faiblesse des prix du fait du bradage des facteurs de production : cessions et concessions par l’Etat des terres et des mines spoliées, travaux et cultures obligatoires, cueillette des produits naturels… La marginalisation des communautés villageoises africaines Celles-ci furent combattues, sur le plan économique, par la privation des ressources nécessaires à leur développement (manque d’institutions de crédit et de recherches agricoles pour les africains) et par l’anéantissement de leurs structures de production et de commercialisation. En effet, le système agraire et les réseaux commerciaux traditionnels furent détruits par la gigantesque expropriation, l’incendie des villages, la déportation des populations et leur soumission au travail forcé. Bien pire, les décrets pris par l’Etat colonial le 25 juillet et le 17 octobre 1889 lui réservèrent l’exclusivité de la collecte des produits naturels (pointes d’ivoire, lianes naturelles, caoutchouc…) et interdirent la chasse libre à l’éléphant sur toute l’étendue de la colonie. De ce fait, le monde rural désintégré ne put plus être entraîné par la croissance du secteur urbain, mais les deux secteurs évoluèrent parallèlement dans un système dualiste. L’adoption des lois sur le commerce à l’avantage substantiel de l’Etat colonial et des sociétés Métropolitaines Tout fut agencé pour exclure l’Africain de la sphère du profit colonial : restriction de la liberté d’entreprise, de la mobilité, des droits de propriété, de la formation et de l’information… A cet effet, les lois sur le commerce, particulièrement, découragèrent l’initiative autochtone en la matière. La législation coloniale protégea les activités commerciales les plus rentables en faveur de capitalistes étrangers. Ainsi, elle fit obstacle à la formation d’une bourgeoisie africaine rurale du fait de l’expropriation foncière massive et du travail forcé pour les Noirs, de l’affectation des meilleures terres et des cultures les plus rémunératrices au colonat européen tout en imposant aux populations locales des cultures mal payées dans le cadre des paysannats. De même qu’un système fiscal usurier fut appliqué aux fins d’assurer l’autofinancement de l’Etat oppresseur, ce dernier y trouva le moyen de réduire l’Africain à la pauvreté, d’endiguer toute sa velléité d’accumulation des richesses et de décourager son esprit d’entreprise. A la vérité, le capitalisme colonial ne fut pas fondé sur la libre concurrence mais sur les discriminations raciales, religieuses et sociales. Dans ce système, il fallut appartenir au sérail pour commercer et tirer son profit du jeu. La situation fut d’autant plus dramatique que le colonisé ignora l’arsenal juridique colonial qui l’exclut des affaires et même l’existence de l’Etat qui en fut l’auteur. Elaboration d’un système de sur-travail des populations africaines Avec la collaboration de l’Administration coloniale, les entreprises abusèrent de la main-d’œuvre indigène : soumission au travail forcé des millions d’hommes sans respect des conditions d’hygiène et de sécurité entraînant d’importantes pertes en vies humaines, privation de la liberté et usage des méthodes brutales (rafles, déportation, expropriation des terres…), obligation de vendre la production individuelle à la société commerciale monopoliste à des prix dérisoires . Ainsi, le système colonial de travail forcé fit du milieu rural et de l’agriculture un enfer pour les autochtones . Ces derniers vécurent dans un état de soumission totale leur enlevant toute capacité d’initiative, toute conscience de classe. Instauration d’un système de production dualiste et extraverti Alors que le secteur traditionnel s’évertua, avec une technologie ancestrale, à satisfaire les besoins existentiels des Africains, le secteur moderne exploita les ressources locales pour répondre aux besoins et aux exigences de l’économie occidentale à laquelle il fut, du reste, intégré. En conséquence, les institutions économiques et sociales, et surtout la structure de production du secteur moderne furent diamétralement extraverties, tant elles restèrent soumises aux directives, aux idées et à la domination des étrangers. Ce fut, en réalité, une économie d’enclave. La production, dans ces conditions, resta essentiellement primaire et concentrée sur un ou quelques produits, et le commerce extérieur, tout aussi étriqué en ce qui concerne les produits et les partenaires commerciaux, joua un rôle déterminant . La production manufacturière locale ne fut organisée que dans la mesure où elle participa à l’accroissement des exportations des produits primaires. Dans le secteur agricole, les paysans, dépouillés de leurs terres, furent astreints aux cultures d’exportation au détriment des cultures vivrières, en échange d’un salaire modique ou pour des prix insignifiants de rachat par les sociétés d’exportation . En outre, l’aménagement du territoire et des voies de communication fut guidé par des impératifs d’exportation des produits de base. A noter qu’en ce qui concerne ces travaux dits d’utilité publique, la loi organisa le recrutement obligatoire des indigènes, sans aucune rémunération. Si le manque d’intégration interne de la colonie empêcha le développement d’une industrie moderne, il permit cependant aux colons de mieux dominer les communautés villageoises africaines . En somme, le système de production colonial favorisa la surexploitation des ressources naturelles et humaines locales tout en générant des profits fabuleux aux Nations colonisatrices. Elaboration d’un système de transfert des profits coloniaux vers les Métropoles : Les métropoles tirèrent largement profit des colonies. En effet, l’exploitation coloniale rapporta des dividendes importants aux Etats métropolitains et contribua à créer des emplois pour leurs citoyens et à améliorer leur balance commerciale à la faveur des structures de l’échange inégal . Les sociétés installées dans les colonies réalisèrent aussi des grands profits dont le système financier et monétaire colonial autorisa simplement le rapatriement au détriment du développement socioéconomique de la colonie . Sur le plan social et politique, les Africains furent considérés, pour les besoins de l’exploitation coloniale, comme des hommes insuffisamment évolués dont les Etats coloniaux eurent l’obligation d’assurer graduellement l’émancipation . Ils ne prirent aucune part à l’élaboration des orientations générales concernant leurs terroirs. En effet, après la démolition des formations politiques précoloniales, les colons mirent en place des régimes politiques totalitaires destinés à empêcher tout regroupement ou tout contre-pouvoir africain capable d’influer sur la politique d’exploitation économique des colonies. Un arsenal juridique fut alors déployé pour établir la subordination politique et sociale des Africains et assurer la primauté blanche sur les Noirs . Cette situation fut assise sur les piliers suivants : l’institution d’un système centralisateur et autocratique où le pouvoir suprême de décision resta en définitive situé en métropole ; L’absence des droits politiques reconnus aux autochtones ; La restriction des droits de propriété et de mobilité ainsi que du droit syndical ; Le développement séparé et la hiérarchisation des personnes et des biens sur la base de la ségrégation raciale ; L’utilisation d’une armée des mercenaires, d’une administration tatillonne, d’une petite bourgeoisie noire et d’une autorité coutumière acculturée acquise à la cause de la métropole, pour briser toutes velléités de revendication politique ; La promotion de l’ethnicité pour diviser et régner sur les indigènes en les maintenant dans un total isolement, sans aucun contact avec l’étranger ou avec les autres ethnies. Ces mesures discriminatoires et ségrégationnistes débouchèrent sur un système sociopolitique dualiste. D’une part, l’Etat colonial toléra la coexistence d’un pouvoir traditionnel dominé mais résistant, c’est-à-dire la survivance des résidus de l’autorité traditionnelle dans les communautés villageoises, d’autre part, par souci de zizanie, les colons renièrent aux autochtones le droit à la citoyenneté du grand ensemble colonial en les abandonnant sous l’encadrement des chefs coutumiers locaux afin de décourager la coopération entre les tribus de la colonie. En vue de s’assurer le contrôle des communautés villageoises, l’administration coloniale remplaça subrepticement les chefs naturels par des faux chefs « coutumiers médaillés » rémunérés par elle en fonction de leur efficacité à faire exécuter les tâches et les injonctions du colonisateur . En outre, la délation, la méfiance, la terreur et le despotisme transformèrent, à terme, la famille, le clan, la tribu, l’église et l’Etat en des véritables centres d’anéantissement collectif pour les autochtones. L’extraversion du système sociopolitique et économique colonial, ne laissa aucune possibilité d’intégration entre les secteurs moderne et traditionnel. Ce système, bien que largement rentable pour les puissances colonisatrices, fut une source d’incohérences internes, de pauvreté des masses autochtones et donc finalement, une source d’instabilité et d’inefficacité économiques. En effet, l’antagonisme entre le système capitaliste et le système traditionnel africain engagea la société coloniale dans l’escalade résistance- répression qui n’empêcha pas la poursuite de l’implantation et de la mise en valeur de la colonie, mais suscita parallèlement un désordre qui la gangrena progressivement et irréversiblement . De ce point de vue, l’extraversion du système capitaliste colonial engendra des dysfonctionnements, des distorsions et des perversions graves qui le paralysèrent et rendirent incertaine son évolution . Non seulement annihila-t-elle le dynamisme des communautés africaines traditionnelles (de la famille nucléaire à la tribu), mais en plus, elle créa, à la longue, des dissensions dans le bloc hégémonique (l’Etat colonial, le grand capital et l’Eglise). Des tensions contenues pendant un demi-siècle finirent, en effet, par se manifester au grand jour. Les contradictions entre les intérêts à court terme des entrepreneurs coloniaux (destination des profits, surexploitation des populations noires, …) et les intérêts à long terme de l’ensemble du système colonial (paix et stabilité), la transposition à la colonie des conflits politiques de la métropole ainsi que l’incapacité du système de résorber ses dysfonctionnements, permirent à la petite bourgeoisie noire d’occuper progressivement la scène politique pour obtenir l’abolition officielle de la colonisation vers le début des années 60. Cependant, la période coloniale et celle de l’esclavage marquèrent profondément les peuples africains et affectent encore aujourd’hui leur organisation socioéconomique et politique . Cela ne fait pas l’ombre d’un doute que les diverses dominations et servitudes qui se sont implacablement abattues sur le continent noir depuis près de cinq cents ans, ont ravagé, violenté l’Africain de même que sa société et ont entraîné un ensemble des paralysies structurelles qui ont, à leur tour, stérilisé, « impuissancisé » les forces et les énergies internes de l’Afrique Noire postcoloniale. En effet, la conséquence logique de toute la politique coloniale est la désorientation « autopsychique » et « allopsychique » des populations qui, d’une part, gardent une perception floue et désordonnée du développement et, d’autre part, sont dirigées de l’extérieur et n’ont pas la possibilité de se prononcer sur ce qui est de leur intérêt, ballottées qu’elles sont par des conjonctures nationales et internationales . Cet état des choses s’explique par le fait que les colons ont su anticiper le courant libérateur qui s’annonçait à l’horizon africain à la fin des années 50 en protégeant le maximum de leurs privilèges. Ils ont réussi dans la plupart des cas à ne pas se faire arracher l’indépendance, mais à la négocier en position tellement confortable qu’ils ont pu obtenir la reconduction du système capitaliste perverti. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’Afrique postcoloniale a perpétué la négation des valeurs culturelles, économiques et politiques traditionnelles, la domination sociale et politique, la dépendance économique et la misère des masses. Après l’indépendance politique de l’Afrique, la perversion du système s’est aggravée faute d’innovation en matière économique et politique, notamment à cause de l’éclosion des libertés politiques, de travail et de mouvement qui ont battu en brèche l’un des piliers du système colonial, à savoir : « l’encadrement coercitif des autochtones » . Le système hérité de la colonisation s’est dès lors déréglé : des graves distorsions, ou plutôt des « impuissances » se sont nettement révélées et ont confirmé le sous-développement spécial de l’Afrique Noire. Du fait d’avoir été longtemps les sujets d’autres peuples, les Africains, instruits ou non, se sont montrés trop timorés pour engager les réformes socioéconomiques salutaires . Les « impuissances » susévoquées, exacerbées par le marasme économique du début des années 60, ainsi que l’anarchisme étatique, socioéconomique et religieux suscité par la révolution indépendantiste, ont eu sur le plan économique des conséquences graves telles que la détérioration de l’appareil de production, la régression des exportations, l’accroissement des importations, le déficit de la production vivrière, l’augmentation de la dépendance alimentaire et le cloisonnement des secteurs moderne et traditionnel . En outre, l’antagonisme est né dans les rapports entre, d’une part, les Etats créés artificiellement à la suite de la décolonisation et qui s’évertuent à contrôler et à assurer le développement en ignorant la réalité vivante des ethnies et, d’autre part, les communautés villageoises et la société civile qui devraient normalement servir de support aux actions de développement à la base . Par ailleurs, les dirigeants africains ont, en réaction aux attaques des pouvoirs métropolitains, prôné le « nationalisme économique » suscitant malencontreusement la fuite des capitaux privés et le boycott des investisseurs internationaux. L’Afrique postcoloniale s’est ainsi fourvoyée à la croisée des chemins d’un modernisme à l’occidentale et d’une dépravation des valeurs socioculturelles traditionnelles, entraînant l’instauration d’une société de type sauvage où la force, la ruse, la corruption, le népotisme, l’injustice, l’obscurantisme, l’immoralité le disputent à l’enrichissement facile et à la gabegie au détriment du travail productif, de l’honorabilité, de la responsabilité, de l’honnêteté, de la protection de la famille , du patriotisme et de toutes les valeurs républicaines . Le règne de la société sauvage est renforcé par le mysticisme en ce qu’il fait croire à l’individu l’acquisition des forces supérieures lui permettant une ascension en dehors de la communauté en écrasant impitoyablement ses semblables . Selon une opinion largement rependue, l’autorité étant au-dessus des hommes et de la loi, s’exerce sans morale rigoureuse, dans l’ignorance, fût-ce, de la justice immanente. A l’instar des régimes communistes de l’Europe de l’Est, certains pouvoirs africains se sont attaqué à l’Eglise dans le but inavoué d’ôter à l’homme son âme profonde et de lui priver du seul cadre de regroupement où pouvaient être cultivés la parole de vérité, l’amour de Dieu et du prochain aux fins de se libérer du mal et de l’oppression et, par voie de conséquence, de galvaniser l’engagement populaire pour l’édification d’une nation juste et prospère. De toute évidence, la négation des valeurs culturelles africaines ou l’abrutissement culturel a été à la base de l’échec de la politique de développement appliquée par les dirigeants d’après l’indépendance. Bien pire, elle a permis aux experts occidentaux de les subjuguer et de leur faire croire qu’ils pouvaient développer leurs pays en renforçant les structures socioéconomiques héritées de la colonisation, malgré les graves ambiguïtés qui les parasitaient de l’intérieur. S’inspirant d’une thèse qui faisait autorité dans les années 60 et 70, les décideurs africains ont opté, par mimétisme, pour le modèle industriel occidental, favorisant ainsi le développement de l’industrie au détriment de l’agriculture qui était alors réputée insensible aux encouragements économiques et imperméable au progrès technique . Et, à partir de 1985, ils se sont soumis aux experts de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International pour expérimenter des programmes d’ajustement macroéconomique et structurel sans réformer les structures socioéconomiques extraverties, au mépris du vœu fait par les Nations Unies, depuis l’entrée en application de la charte de San Francisco, le 24 octobre 1945, d’instaurer un régime de coopération économique et sociale internationale respectant le principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes . Ce faisant, ils ont malencontreusement exacerbé l’extraversion de l’économie africaine en poursuivant la politique d’abandon du secteur traditionnel rural, la concentration des ressources nationales ainsi que des efforts de développement dans les grands centres urbains , le pillage des ressources nationales et leur transfert vers les anciennes métropoles, l’obéissance servile aux impulsions socioéconomique et politique étrangères, l’ inadéquation du système éducatif par rapport aux besoins de l’économie, l’apathie face aux réformes que nécessitent la relance économique, la prééminence absurde des investissements directs étrangers sur les investissements nationaux, le bradage des droits d’exploitation des ressources naturelles et minières à des investisseurs étrangers, le recours trop facile au crédit international pour financer des investissements improductifs, l’affectation des maigres ressources nationales à des projets d’investissements conçus dans l’intérêt des pays développés, l’exploitation sordide de la main d’œuvre nationale, l’expropriation des paysans de leurs meilleures terres à l’avantage des sociétés étrangères et de l’oligarchie dominante, le découragement de la production vivrière nationale au profit des importations et la spécialisation de l’économie dans la production d’un petit nombre de matières premières dont les cours ne cessent de baisser . C’est précisément cette spécialisation qui a fait peu à peu la misère du continent noir, surtout celle de ses paysans. Ces derniers ont cessé de produire pour nourrir leur famille en se lançant, presque à leur corps défendant, dans la culture d’exportation. A tel point qu’aujourd’hui les ruraux africains n’arrivent plus à nourrir leurs voisins citadins et se nourrissent à peine eux-mêmes. Ils continuent d’émigrer vers les villes où se joue le plus grand drame de l’histoire : la mort lente ou chaotique des communautés villageoises, la déculturation des centaines de millions de gens agglutinés dans les bidonvilles, le chômage, l’insécurité, la défectuosité des conditions d’hygiène, bref, la misère des populations . Non seulement l’appareil économique, demeuré extraverti et rudimentaire, ne peut pas, en effet, absorber le surcroît d’éléments transfuges de la campagne, mais en plus, les maigres ressources produites, déjà lourdement grevées par les termes de l’échange défavorable et les multiples transferts vers les métropoles occidentales, ne permettent pas de subvenir aux besoins de la grande majorité désœuvrée, pas plus qu’elle n’encourage l’épargne aux fins de la constitution d’un capital autonome pour un développement autocentré. Dans le même ordre d’idées, Arthur Lewis affirme que dans la plupart des pays en développement, les activités les plus rentables (commerce de gros, banques, marine marchande, assurance, …) dépendent d’intérêts étrangers. Ce qui incontestablement nuit à la mobilisation de fonds et d’hommes d’entreprises, en vue d’implantations industrielles locales. Comme l’affirme à juste titre Albertini, c’est une règle de caractère historique : lorsqu’un pays est politiquement et économiquement plus fort, il choisit les investissements directs en vue d’une prise de contrôle de l’économie du pays tiers et de l’exploitation de ses ressources. En effet, les profits colossaux que draine ce réseau d’industriels, de grossistes, de banquiers, d’armateurs et d’assureurs sont en permanence expatriés, privant les pays hôtes d’une source majeure de fonds pour le réinvestissement. Par contre, l’immense majorité des populations autochtones vivent à la limite de la survie et tout à leur souci de trouver, jour après jour, de quoi subsister, ne pouvant guère faire des projets d’avenir et des investissements qui ne portent, en principe, leurs fruits qu’au bout d’un certain nombre d’années. Cet horizon temporel limité n’est pas un trait inné mais signe plutôt un échec de la politique économique, des institutions et de la société africaine contemporaine. En ce qui concerne particulièrement la politique agricole, celle-ci s’est caractérisée depuis 1960 par des incohérences qui ont bloqué les actions visant à réformer l’appareil de production coloniale, à améliorer les techniques traditionnelles, à diversifier la production en vue d’assurer la sécurité alimentaire, de fournir les matières premières à l’industrie locale et de créer des emplois agricoles et non agricoles aussi bien dans le secteur secondaire que dans le tertiaire, et, enfin, de doter les ruraux des revenus élevés. A plus d’un titre, la négation des valeurs culturelles africaines a été l’une des plus sévères tares du système légué par la colonisation . Outre les distorsions profondes qu’elle a provoquées dans le secteur économique et social, elle a abouti, après la décolonisation, au développement de la mentalité de dépendance contrastant avec le nationalisme officiel et à l’éclosion d’un individualisme sauvage qui, sur le plan politique, ont promu, à leur tour, une classe politique indélicate, alliée fidèle des puissances impérialistes . Celles-ci ont, pour maintenir leur domination sur l’Afrique postcoloniale, organisé dans ce continent des Etats totalitaires permettant le partage frauduleux des richesses locales entre les capitalistes étrangers et l’oligarchie nationale . Il suit de là que les lois d’ordre public sont continuellement bradées au profit des puissances occultes qui s’approprient les droits, prérogatives et privilèges régaliens dans une subtile stratégie de captation de l’Etat . Comme l’épouse d’Ulysse détissait la nuit la tapisserie brodée le jour, l’Occident accroché à outrance à ses intérêts économiques, décourage lui-même les efforts internes d’instauration de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique. Avec l’avènement de cette politique amphibologique, les dirigeants africains sont subtilement devenus le soubassement politique, le suppôt du système capitaliste perverti. De sorte qu’au lieu de s’engager dans l’entreprise du développement, ils opposent inconsciemment leur force d’inertie à toute tentative de réformes économiques ou sociales. Par ailleurs, l’urbanisation n’est rien moins qu’un aspect patent de l’échec de l’évolution de l’Afrique vers la modernité. En effet, le passage des bourgades coloniales aux mégapoles d’aujourd’hui, s’est accompagné d’un transfert des pouvoirs politique et économique en faveur des citadins, au détriment de ceux qui ont payé le plus lourd tribut au système colonial, à savoir les ruraux. De la même manière, il a bloqué le processus de constitution de véritables classes moyennes. Celles-ci font face à l’oligarchie d’évolués, héritière des colons, bénéficiant d’une rente de situation par l’occupation du centre des capitales et chefs-lieux, et influençant largement l’opinion politique, laissant à l’élite émergeante le choix de prendre le tournant ou de disparaître. Du reste, l’histoire récente jette plus de lumière sur la complicité tacite entre les gouvernants africains et les puissances métropolitaines. Les négociations ouvertes entre les deux protagonistes précités ont, en effet, abouti à la récupération du courant libérateur de la perestroïka en transformant le processus de démocratisation de l’Afrique en une démarche pour la recherche d’une nouvelle organisation politique, prétendument libérale, qui assurera la pérennité du système d’exploitation colonial. En dernière analyse, les structures socioéconomiques et politiques implantées, depuis bientôt cinq siècles, en Afrique subsaharienne expliquent sa dépendance envers les puissances occidentales et hypothèquent malencontreusement la relance économique de cette région. Par conséquent, le problème du développement, sous l’angle structurel, se résume en celui de la résorption de l’extraversion et du dualisme systémiques. La meilleure stratégie de développement serait, sans conteste, celle qui enclenchera l’intégration économique et sociale. Telle est l’idée la plus forte de la deuxième partie de notre étude. Mais auparavant, il sied de déterminer en quoi le système capitaliste dualiste entrave la relance économique de l’Afrique Subsaharienne. CHAPITRE IV : LES CONTRAINTES DE LA RELANCE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE Au chapitre précédent, nous avons relevé que le système capitaliste « extraverti » instauré en Afrique Subsaharienne par les colons oppose encore de nos jours sa force d’inertie à toutes les stratégies de développement socioéconomique. Soubassement de la domination étrangère, il entretient le dualisme économique et structurel, le despotisme et la mauvaise gestion des ressources nationales ainsi que la marginalisation de la société civile notamment les communautés rurales. Malgré leurs apparentes diversités sociologique, géographique, politique et économique, les pays d’Afrique subsaharienne sont confrontés à ces mêmes problèmes . Il est donc possible d’analyser globalement leur situation quitte à laisser aux spécialistes de chaque pays en question d’affiner cette analyse compte tenu de sa spécificité. Ainsi, nous pouvons résumer les facteurs qui brident la relance économique de l’Afrique Subsaharienne en neuf points ci-après : dualité systémique, dépendance extérieure et régime du commerce international défavorable, inefficacité de l’Etat, insuffisance d’infrastructures de base et mauvaise affectation du capital humain, faiblesse de l’épargne et réticence des investisseurs étrangers, déliquescence de la moralité publique, blocage de la mutation du secteur agricole, prévalence des conflits armés et, enfin, inadéquation entre l’idéologie libérale et la matrice de l’identité africaine : le communautarisme . Pour les besoins de la présente étude, nous approfondissons les trois derniers facteurs précités. 4.1. BLOCAGE DE LA MUTATION DU SECTEUR AGRICOLE A l’heure de la mondialisation, la sécurité alimentaire des populations reste encore une préoccupation majeure des autorités de la planète. En effet, une crise agricole se dessine de nouveau à l’horizon à l’échelle mondiale. Les gouvernements du monde entier sont confrontés à des choix lourds de conséquences : il faut trouver les moyens d’augmenter la production agricole de près de 50% au cours des vingt prochaines années, mais sans épuiser les ressources de la planète en sol et en eau, ressources qui seront nécessaires pour faire face à une demande future encore plus grande . Les perspectives sont pour les moins catastrophiques en ce qui concerne particulièrement les pays du tiers-monde. Selon le mémorandum de la Commission européenne sur la politique communautaire de développement, la dépendance alimentaire des pays en développement, globalement considérés, s’accroît en raison de l’augmentation de la demande des pays à revenu intermédiaire, de l’urbanisation accélérée et de la dégradation des conditions naturelles. Au pis aller, le déficit alimentaire dépassera largement les prévisions si les pays du tiers-monde importateurs de produits alimentaires ne développaient pas leur capacité de production. Car, parallèlement à l’amenuisement de leur revenu, le coût desdites importations va augmenter du fait de la hausse des cours des produits les plus protégés (blé, riz, viande, produits laitiers et sucre) à la suite de la réduction des subventions à l’exportation des produits agricoles prescrite par l’accord commercial multilatéral de l’Uruguay Round et reconduite récemment par les négociations du cycle de développement de Doha . C’est pourquoi, la plupart des pays du tiers-monde se sont résolument engagés dans la recherche des systèmes de production alimentaire durables et écologiquement acceptables. De fait, les rendements agricoles à l’hectare ont plus que doublé au cours des 30 dernières années dans le monde en développement. Il ressort des statistiques de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) que l’agriculture contribue pour plus d’un tiers aux recettes d’exportation de près de 50 pays en développement, dont une quarantaine doivent à ce secteur plus de la moitié de ces recettes . Seule l’Afrique subsaharienne demeure en reste. L’accroissement des rendements agricoles à l’hectare n’y a pas dépassé 30% au cours de la même période. Par ailleurs, les autres indicateurs sont tout autant dans le rouge. Le taux annuel moyen de croissance du secteur agricole qui se chiffrait à 1,1% entre 1975 et 1980, est tombé à -1,1% en 1987 ; la production vivrière est entre-temps passée de 1,3% à -2,0%, tandis que paradoxalement, la production agricole non alimentaire (d’exportation) a augmenté de -1,5% à 8,1% et que l’aide alimentaire a baissé de 13,4% à -18,1%. Les parts du marché d’exportation ont plus que baissé pour tous les pays africains. Cette tendance baissière s’accentuera à partir du 1er janvier 2008, lorsque le volet commercial des accords de partenariat économique signés en juin 2000 à Cotonou entre l’Union Européenne et les ACP entrera en vigueur en supprimant les préférences non réciproques suivant les exigences de l’OMC. Tableau 2. La part de l’Afrique Subsaharienne dans les exportations mondiales des produits agricoles de 1980 à 1998 Année 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Pourcentage 3,5 4,3 3,9 4,2 3,3 1,5 1,2 2,0 2,1 2,4 Source : Statistiques élaborées par l’auteur sur base des données tirées de l’article de Robert SHARER, « Commerce, investissement et intégration régionale » in Finances et Développement, Décembre 2001, p.15. Graphique 2. La part de l’Afrique Subsaharienne dans les exportations mondiales des produits agricoles de 1980 à 1998 Source : Idem Ces contre-performances ne sont pas toujours liées à la pénurie de terres, pas plus qu’à la surpopulation, mais au blocage de la mutation du secteur agricole et à l’insuffisance de sécurité publique. Dans cette région, les économies de quasi-subsistance n’ont pas pu, à dire vrai, se transformer en économie d’échange en raison des structures socioéconomiques dualistes et extraverties instaurées par la colonisation et entretenues actuellement par le système néo-colonialiste. En effet, la conquête coloniale déboucha sur une agriculture à double forme. A côté d’un secteur traditionnel décadent axé sur les produits de subsistance et utilisant des techniques ancestrales, se développa un secteur moderne portant exclusivement sur un certain nombre de cultures d’exportation ayant recours aux techniques de production moderne mais ne répondant qu’aux besoins et priorités déterminés par les métropoles . Toutes les cultures les plus rémunératrices furent réservées au colonat européen tandis que les cultures mal payées devinrent l’apanage des communautés villageoises empêchant la formation d’une petite bourgeoisie rurale des producteurs africains. Ce système généra, comme nous l’avons souligné plus haut, des paralysies, des impuissances dont la virulence fut suspendue pendant la période coloniale grâce aux mécanismes d’encadrement contraignant, de déportation, de prolétarisation et de fiscalisation des paysans . Après les indépendances, les paysanneries africaines ont réalisé l’étendue des dominations et exploitations que le système néo-colonialiste leur faisait subir sur les plans culturel, économique et politique. Leurs réactions des plus débridées ont dès lors engendré des distorsions socioéconomiques graves. D’une part, l’exode rural a gangrené l’appareil agricole hérité de la colonisation, d’autre part, la dégradation constante des revenus des agriculteurs, la détérioration des termes de l’échange de produits d’exportation, la désorganisation du marché, la dégradation des voies de communication et les difficultés d’évacuation de la production, la protection des marchés des pays industrialisés, le développement des produits de synthèse, la présence d’une multitude d’intermédiaires ou même des organismes publics spéculant à la baisse au niveau des producteurs et à la hausse au niveau des consommateurs, et la disparition du milieu rural des biens manufacturés naguère puissants stimulants, ont fini par décourager les producteurs . Cette détérioration de l’appareil de production a, à titre de conséquence, achevé le cloisonnement de deux secteurs moderne et traditionnel, ou plutôt, scellé la rupture entre villes et campagnes. Plus que jamais, les paysans sont de plus en plus isolés, déconsidérés par l’opinion publique et placés dans la situation d’émigrés intérieurs. Continuellement les milieux ruraux sont vidés de leur population des plus actives, n’y demeurant en majorité que des vieillards et des rejetons, incapables d’approvisionner en vivres les centres urbains, en intrants la manufacture locale et de fournir des débouchés pour celle-ci. Les paralysies du système agricole postcolonial se sont également révélées dans l’incapacité des gouvernements et des organismes internationaux de développement d’adapter les institutions et les techniques de gestion agricoles aux caractéristiques socioculturelles et géographiques propres à l’Afrique subsaharienne, aux fins de susciter l’engouement des agriculteurs. Au dire d’experts, des graves difficultés d’organisation et de gestion ont été observées lors de la réalisation des projets dans le secteur de l’agriculture peu mécanisée et du développement rural tant les approches adoptées étaient inappropriées. Celles-ci ne prenaient, en effet, pas suffisamment en considération les réactions et les intérêts des populations participantes du point de vue socioculturel et économique, ni les techniques agricoles autochtones. Il était alors difficile d’élaborer une politique agricole efficace, d’énoncer clairement les objectifs, de définir les méthodes et les moyens d’action notamment l’enveloppe technique compatible avec le sol et le climat ainsi que les démarches institutionnelle et « gestionnelle » susceptibles d’induire des changements dans le comportement des ruraux qui n’y trouvaient pas leur compte. Aussi, les politiques mises en œuvre ont-elles été entachées de beaucoup d’erreurs et de contradictions. L’on a cherché tout à la fois à assurer l’autonomie alimentaire, la stabilité des prix intérieurs, l’augmentation de l’emploi, du revenu et de la production agricoles tout en maintenant bas les prix à la consommation des produits alimentaires ainsi que les salaires agricoles, en taxant fortement la production agricole et en négligeant l’agriculture vivrière. Les faiblesses du système postcolonial se manifestent également à travers la carence du système éducatif. Ce dernier ne fournit pas suffisamment de cadres au secteur agricole. Alors que l’économie de la majorité des pays africains est à dominance rurale, l’agriculture n’attire pas les personnes qui ont été à l’école au-delà du niveau primaire. Ainsi, en Afrique, l’école est devenue paradoxalement le « fossoyeur » de l’agriculture. L’abandon de l’agriculture par l’élite africaine est la conséquence des politiques économiques adoptées par la plupart des pays du continent noir, lesquelles favorisaient le développement de l’industrie au détriment de l’agriculture conformément au courant de pensée dominant dans les années 60 et 70. Durant cette période, les interventions des pouvoirs publics sur les prix agricoles ont freiné l’expansion de l’agriculture beaucoup plus que l’on ne l’avait présumé. Des mesures sectorielles telles que le contrôle des prix, les taxes ou contingents à l’exportation ont fait baisser le rapport entre les prix agricoles et ceux des produits non agricoles (termes de l’échange intérieurs), tandis que la protection industrielle et l’appréciation du taux de change réel, ont fait de l’agriculture un secteur moins attrayant que les autres. Ces interventions directes et indirectes ont, qui pis est, entraîné pour le secteur agricole une ponction massive de revenu qui y a ralenti considérablement l’investissement privé ainsi que la croissance. Rien d’étonnant qu’aient échoué toutes les tentatives des gouvernements de stimuler, avec l’appui des divers donateurs, la croissance de revenu et de faire reculer la pauvreté rurale par la création des organismes de crédit publics accordant aux agriculteurs des prêts à faible taux (à des taux bonifiés) . Par contre, des fausses idéologies ont induit des politiques suicidaires dans les pays où l’agriculture fut jadis prospère, à l’exemple du Ghana qui a détruit tous ses centres de recherche agronomique sous prétexte qu’ils étaient l’incarnation de la colonisation. Il a ensuite remplacé les petites fermes traditionnelles par des exploitations géantes inspirées du modèle soviétique. Le Nigeria a sacrifié son agriculture à l’exploitation du pétrole. La Tanzanie, fascinée par le maoïsme, s’est affamée toute seule en regroupant de force les paysans dans des villages collectifs . Tandis que la généralisation de la politique de dons alimentaires a désorganisé les marchés agricoles dans les pays d’accueil, en y faisant chuter les prix. Ce qui ruina la paysannerie locale et baissa la production vivrière. Il en est résulté la crise du secteur agricole qui a hypothéqué, à son tour, la croissance économique des pays africains et la sécurité alimentaire de leurs populations . Et pourtant, il ne fait aucun doute que l’Afrique possède de grandes potentialités agricoles qu’il importe, au premier chef, d’exploiter en accroissant et en diversifiant l’effort agricole afin de permettre aux Africains de se suffire à eux-mêmes dans le domaine alimentaire, sans pour autant réduire la production des matières premières destinées à l’exportation. Le développement socioéconomique de cette partie du continent dépend de celui de l’agriculture. De manière classique, l’expansion de l’industrie implique une mutation agricole préalable ou concomitante. En effet, au cours de la période qui précède le démarrage, le secteur agricole doit jouer les rôles suivants : 1. Accroître la production des denrées alimentaires de manière à faire face à l’augmentation probable de la population, surtout urbaine, afin d’éviter soit la sous-alimentation, soit le gaspillage de devises étrangères lié à l’accroissement des importations alimentaires ; 2. Dégager un surplus (excédents) à échanger avec le secteur industriel sous forme de matières premières, ou avec l’extérieur pour gagner les devises étrangères, nécessaires au développement de ses investissements ; 3. Stimuler la création des nouvelles industries indispensables au démarrage en augmentant la demande des biens d’équipement et de fournitures essentiels à sa propre expansion; 4. Offrir ainsi des débouchés pour soutenir la croissance rapide de la production intérieure lorsque le secteur public n’est pas assez important pour le faire ; 5. Améliorer sa productivité en vue d’élever le niveau des revenus réels agricoles et transférer ses revenus excédentaires à l’industrie par le biais de réinvestissements ou de l’augmentation de la demande des agriculteurs, de l’épargne ou de la fiscalité ; 6. Contribuer à l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat sans occasionner la sous-alimentation des populations rurales, ni provoquer l’inflation dans le milieu urbain… . En ce qui concerne particulièrement le continent africain, le développement social et économique passe absolument par la révolution du secteur agricole, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, ce dernier constitue le secteur économique le plus important, représentant approximativement 35% du PIB, 40% des exportations et fournissant environ 75% des emplois . C’est inévitablement de ce secteur que devrait partir toute action de développement efficace. Mais, c’est aussi malencontreusement le secteur qui est le plus frappé par les impuissances et les paralysies nées pendant la colonisation. Non seulement, l’agriculture africaine ne peut compter sur une industrie extravertie n’exerçant sur elle que des effets pervers tels que l’exode rural, l’exode des capitaux, la détérioration des conditions d’échange, mais, pour comble, les communautés villageoises, devant prendre une part active dans l’expansion de l’agriculture sont pratiquement abandonnées, dominées et marginalisées. Par ailleurs, la spécialisation dans un nombre réduit de cultures d’exportation, l’absence de moyens de communication et le manque de volonté politique achèvent de paralyser le secteur agricole africain. Les perspectives s’annoncent encore plus difficiles pour ce qui est de la production vivrière. Délaissée depuis l’époque coloniale, elle est restée l’apanage des paysans travaillant dans le secteur traditionnel sans institutions d’encadrement ou de financement. Il se révèle que depuis 1975, le taux annuel moyen de croissance de la production alimentaire ne cesse de baisser en Afrique Subsaharienne : de -1,4%, il est tombé à -5,4% en 1987 . L’inélasticité de la production alimentaire locale est à la base d’un gap inflationniste et ouvre la voie à des importations qui grèvent la balance des paiements des Etats d’Afrique. D’où la nécessité impérieuse d’ouvrir la recherche afin d’adapter les institutions et les techniques de gestion du secteur agricole aux caractéristiques culturelles propres dans le cadre de l’édification des systèmes de production alimentaire durables et écologiquement viables. Il en va de la survie de toutes les populations africaines, car celles-ci ne peuvent s’arracher aux déterminismes inférieurs qu’en améliorant la productivité dans le secteur de la production vivrière. Arthur Lewis ne renchérit-il pas en disant que les pays de la zone tropicale ne peuvent amorcer efficacement leur industrialisation qu’en élevant les rendements de leur production agricole destinée au marché national. C’est, d’après lui, le seul moyen de créer le surplus agricole et d’offrir les débouchés nécessaires à la naissance et à la poursuite de l’industrialisation. C’est aussi, à un autre degré, la seule ressource pour améliorer, sur le marché d’exportation, les termes de l’échange de leurs exportations grâce à la diversification de la production, à la réduction de la dépendance extérieure, à l’élévation du niveau de revenus des agriculteurs… . Dans cette perspective, il faudrait engager la réforme des politiques macroéconomiques en faveur du développement rural et combler les carences de la législation financière et foncière en vue de susciter les organismes de financement ruraux capables d’atteindre des larges populations et à survivre, voire prospérer, sans aide publique . En effet, la révolution verte ne peut réussir que si l’on accorde aux agriculteurs des conditions politiques et économiques leur permettant une juste rémunération de leurs efforts, tenant compte de prix relatifs d’intrants et « extrants » agricoles par rapport à ceux de l’industrie. Pour notre part, le système coopératif pourrait apporter un contingent important dans la réalisation de toutes les mutations en vue d’endiguer la décadence agricole de l’Afrique subsaharienne comme nous le démontrons au septième chapitre de cette étude. 4.2. PREVALENCE DES CONFLITS ARMES ET DE L’INSTABILITE POLITIQUE Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, la paix est une condition préalable à tout progrès dans le domaine économique. Selon le rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le monde pour l’exercice 1991, la quasi-totalité des pays qui ont essuyé des échecs économiques au cours des 30 dernières années dans le monde en développement étaient engagés dans des conflits militaires majeurs . De toute évidence, la guerre arrête le développement en ce qu’elle perturbe les activités socioéconomiques essentielles de la Nation. Non seulement elle fait de victimes parmi les populations, occasionne la fuite des cerveaux et détruit les infrastructures de base, mais, qui pis est, elle absorbe des rares ressources disponibles dans une économie. En effet, la menace permanente de la guerre en Afrique, malgré la fin de la guerre froide, amène plus d’un gouvernement à consacrer des ressources importantes aux dépenses d’une armée souvent pléthorique au lieu de financer les investissements dans les secteurs de la santé ou de l’éducation . Bien souvent, la guerre constitue un prétexte pour les gouvernements d’instaurer un régime d’exception confisquant les libertés publiques et faisant main basse sur les ressources de l’Etat. Cette machination voile la kleptocratie et le népotisme qui empêchent l’édification en Afrique des Etats républicains et démocratiques susceptibles de garantir les intérêts de tous les groupes sociaux et de sécuriser tous les citoyens. Au cours de quatre dernières décennies, les mêmes scènes se répètent, jouées par les mêmes acteurs : les dirigeants et leur clientèle en viennent à recourir aux méthodes coloniales, avec la triple négation politique, économique et sociale pour les masses, aux fins d’imposer leur règne sans se soucier de fonder des Nations véritables en Afrique. Cela grossit le nombre d’exclus dans la société et engendre bien de frustrations qui, pour comble, suscitent des psychodrames, des guerres civiles et des razzias . En réalité, l’Afrique postcoloniale n’a pas pu institutionnaliser l’arbre à palabre afin de perpétuer le cadre ancestral de concertation, de dialogue et de règlement de conflits. D’où, la carence de débats démocratiques à tous les niveaux d’organisation sociale et le règne du totalitarisme, de la violence, de l’obscurantisme, etc. Du fait de la contrainte tyrannique, les populations, et notamment les élites, sont contaminées par la pensée unique ou la contagion de l’imitation mutuelle, c’est-à-dire la soumission servile aux idéologies et comportements dictés par le sérail. « Silence, on gouverne » semble être le credo des régimes démocratiques musclés et traduit l’atmosphère belliqueuse qui règne en Afrique, tant le refus de la contradiction et le blocage sous-jacent de l’alternance politique amène nombre des gouvernants à recourir à des moyens biaisés, innommables et, le plus souvent, violents . A la lueur des conflits qui ont éclaté dans notre continent, il se révèle une inadaptation des plates-formes traditionnelles de concertation et de coopération aux impératifs de la modernité socioéconomique. Cette situation serait à la base de la confusion persistante entre la propriété privée et collective et, qui pis est, d’un climat d’incompréhension mutuelle tant dans la famille nucléaire, le clan, la tribu, l’ethnie que dans le pays tout entier . Au bout du compte, l’incapacité de résorber les rivalités d’intérêts entretient la misère des masses qui, à son tour, alimente le langage des sourds ainsi que les forces centrifuges dans un sociodrame digne d’une tour de Babel. Paradoxalement, il s’y est développé une solidarité délétère sous-tendue par une perversion de la culture africaine qui détériore toutes les institutions de base de la paix et du progrès (famille, école, église, Etat, syndicat, parti politique…). En effet, dans la plupart des cas, l’accès et le maintien au pouvoir se réalisent en suscitant parmi les peuples haine et divisions par l’instrumentalisation de leurs ethnies, tribus ou clans. Au fil des ans, les gouvernants africains ont, par ce faire, galvaudé le sens de l’autorité publique, tant et si bien que les populations ne se reconnaissent plus en elle, plongeant des pays entiers dans une anarchie larvée . Par ailleurs, l’absence de programme socioéconomique cohérent soutenu par les politiques macroéconomiques saines, pouvant mobiliser toute la population dans l’entreprise du développement national, disperse les ressources tant humaines que matérielles au profit des politiques véreux, lesquels agitent les `sensibilités ethniques ou tribales faute de discours accrocheur, engageant malencontreusement des guerres d’autodestruction . De fait, la discrimination tribale induit une affectation irrationnelle du capital humain, empêchant l’émergence des cadres assez compétents pour l’éveil de tous les secteurs de la vie socioéconomique et politique. Par-delà cette discrimination, dans la plupart des Etats africains, la mauvaise gouvernance et la représentation déséquilibrée des populations, surtout du monde rural, dans les institutions publiques expliquent les carences de ces dernières dans les domaines de la réglementation, de la gestion d’infrastructures, de prestations sociales ainsi qu’en matière de maintien de la paix et de la sécurité . D’une manière déplorable, les acteurs institutionnels, les partenaires extérieurs et les forces de la société civile développent des stratégies parcellaires et spécifiques qui ne peuvent pas être coordonnées à l’effet d’atteindre des objectifs opérationnels réalistes notamment sur le plan macroéconomique. Force est de reconnaître que les inégalités initiales de richesses et d’éducation ainsi que l’extraversion des institutions suscitent des groupes d’intérêts antagonistes, lesquels ne perçoivent dans les politiques gouvernementales que les pertes à subir et se comportent finalement comme des crabes qui s’empêchent les uns les autres de sortir du panier. Ne vous y trompez pas, on récolte toujours ce que l’on a semé. La pauvreté des masses et les guerres civiles sont inversement proportionnelles à la culture des vertus, de la science et des valeurs spirituelles . C’est donc que l’obscurantisme ambiant prolonge les jours de malheur dans notre continent. Si seulement les Africains avaient compris de quoi dépendait leur paix ! A tout prendre, les faiblesses institutionnelles et la fracture sociale ont entraîné en Afrique postcoloniale l’instabilité politique avec, comme corollaire, la médiocrité des taux d’investissement et de la croissance économique. Depuis 1990, un nombre relativement élevé de pays de la région ont souffert des conflits civils qui, sous leur forme la plus aiguë (Libéria, Rwanda, Somalie, Soudan et République Démocratique du Congo), ont occasionné le tarissement de l’Investissement (en particulier l’Investissement direct étranger) . Sur le plan international, les risques de guerre sont inhérents à certains systèmes économiques comme le capitalisme, lequel fut le principal moteur de l’impérialisme colonial ou économique, de la compétition internationale et d’âpres rivalités allant jusqu’à la dernière guerre mondiale qui ruina l’Europe. Il s’est avéré que dans ce système, la paix ne tient qu’à la capacité de la puissance dominante à ouvrir la porte aux pays émergents afin d’éviter qu’ils se résolvent à l’enfoncer. Ainsi, à l’heure de la mondialisation, les Etats-Unis d’Amérique se doivent d’intégrer les nouveaux pôles de puissance (Chine, Inde et Brésil) au risque d’affrontement . D’un point de vue strictement moral, la paix dépend de la conception que les citoyens se font des libertés publiques, de la manière dont ils les traduisent dans les lois et, par-dessus tout, de leurs responsabilités dans leur mise en œuvre . Faute d’assimilation des exigences éthiques, la conquête des libertés en Occident déboucha jadis sur des régimes totalitaires, occasionnant deux guerres mondiales. C’est qu’en niant ou en tentant de nier Dieu, son principe et sa fin, l’homme altère profondément son ordre et son équilibre intérieur, ceux de la société et même de la création visible. Porté par l’idolâtrie, le monde entier est donc aux prises à des pires aberrations, aux passions et conflits qui agitent toutes les nations . En Afrique, particulièrement, une véritable machine à répression occidentale écrase impitoyablement tout régime culotté de se mettre en travers du chemin de l’impérialisme. Il est d’un phénomène récurent que les grandes puissances arment des forces politico-militaires d’opposition, si elles ne se livrent pas elles-mêmes la guerre, par les mouvements de libération interposés comme ce fut le cas en Angola . La guerre est, selon SWAMINATHAN, le Père de la révolution verte en Inde, la principale cause de la famine dans le tiers-monde. Elle laisse des séquelles graves sur la société tout entière et sur les institutions de l’Etat, d’autant plus qu’en s’engageant dans la guerre, les élites détournent les ressources nationales vers la destruction durable des valeurs et structures fondamentales et, par contre coup, elles perdent la direction des affaires publiques au profit de ceux qui sont les plus habiles dans le maniement des armes. Si cette situation persiste, l’anarchie gagne la politique, l’administration, la gestion macroéconomique, l’éducation, les mœurs… Toutes les contrées qui ont vécu des années de conflits depuis l’indépendance ont rapporté de graves distorsions et spoliations dans les secteurs économique et financier, compromettant durablement la relance économique. Autant dire que la guerre et l’instabilité politique freinent le développement des institutions publiques et perturbe les mécanismes de gestion des finances de l’Etat. Car, il n’y a pas de finances sans l’ordre public et pas d’ordre public sans finances . 4.3. INADAPTATION DE L’IDEOLOGIE LIBERALE AUX REALITES PROFONDES DE L’AFRIQUE Dans l’optique libérale, les politiques de développement accordent la prééminence aux forces du marché qui sont censées régler les activités de production et de distribution en déterminant efficacement l’allocation des facteurs de production entre les différents secteurs et en assurant la répartition des revenus entre les agents économiques. Au même titre, la recherche de la stabilité économique se réalise en laissant les prix refléter les raretés relatives des ressources nationales . Mais sur le plan théorique, les vertus économiques des forces du marché dans le stade du démarrage sont pour le moins discutables, surtout dans le contexte africain où l’Etat contrôle la grande majorité des entreprises en dehors de tout souci d’efficacité . En effet, l’économie du marché, en tant que mécanisme d’allocation optimale des ressources, ne fonctionne que si un degré élevé de concurrence existe . Les monopoles et les cartels publics ou privés limitent le niveau de concurrence non seulement sur le marché des biens et services, mais également sur le marché des facteurs de production . En outre, ce système ne permet pas une redistribution équitable du revenu national. En effet, il est actuellement difficile de reproduire en Afrique Subsaharienne les conditions idéales de la libre concurrence à cause des facteurs suivants : l’insuffisance d’offreurs constitués essentiellement en cartel des filiales des sociétés multinationales, la prééminence d’un grand demandeur en l’occurrence l’Etat, le manque d’homogénéité des produits (distinction entre la production locale et les importations, la production manufacturée et artisanale…), la médiocrité d’infrastructures économiques et institutionnelles ainsi que les contraintes comportementales empêchant l’affectation rationnelle des ressources, les violations massives des droits et libertés individuels notamment le droit de propriété. En outre, les économies d’échelle et les effets indirects y sont importants, tandis que la hauteur des frais de transport et les défaillances de moyens de communication ne permettent pas d’obtenir des prix reflétant fidèlement les coûts économiques . A vrai dire, le système socioéconomique et politique en vigueur dans cette région pervertit l’esprit et les méthodes compétitives propres au libéralisme. Bien souvent, les pratiques corrompues et illicites président aux opérations de production des biens et services ainsi qu’à celles de redistribution de revenu, à telle enseigne que les secteurs les plus productifs, les marchés publics et les meilleurs emplois, sont protégés et réservés aux gouvernants et à leur clientèle nationale ou étrangère. Cette donne échoit à la grande majorité de la population le lot d’exercer des activités de survie dans un secteur informel évoluant en marge de la rationalité . Par ailleurs, la dépravation des mœurs dans une société décadente occulte les valeurs morales, spirituelles et scientifiques propres à la consolidation des libertés individuelles et collectives. Aussi, les Africains sont-ils devenus, à leur corps défendant, des sujets faciles de la tyrannie des minorités dirigeantes. Il est donc évident que les politiques libérales ont peu de chances de réussir dans les économies africaines en mal d’intégration et d’adaptation de la technologie moderne ainsi qu’en l’absence d’un système politique véritablement démocratique. Sur le plan pratique, l’expérience de trois décennies consacrées au développement a contribué à établir la primauté de la lutte contre la pauvreté des populations sur toutes les considérations théoriques libérales. De plus en plus, l’objectif de croissance économique s’est élargi pour se pencher sur les problèmes de répartition des revenus et de la satisfaction des besoins essentiels de l’être humain. Tout en faisant l’apologie des forces du marché dans l’affectation des rares ressources disponibles, la plupart d’économistes en sont venus à croire que les causes de la pauvreté et la solution du problème débordent le cadre de la macroéconomie et de la détermination économique des prix. L’analyse des problèmes du développement devrait, par conséquent, incorporer les comportements qui font que la pauvreté persiste dans une situation donnée. A cette fin, il est primordial de comprendre les motivations et les contraintes des pauvres, hommes et femmes, et de ceux qui interagissent avec eux, tels que leurs voisins plus nantis, leurs employeurs potentiels, les pourvoyeurs de crédit et les propriétaires fonciers. De notre point de vue, les populations d’Afrique sont maintenues dans une situation d’indigence par le système socioéconomique d’exploitation hérité de l’époque coloniale. Jadis dominés, exploités, grugés dans la répartition des revenus créés, exclus dans leur immense majorité du système de production moderne, ignorant les tenants et les aboutissants dudit système, les Africains ne pouvaient pas devenir des capitalistes entreprenants en vue de participer à l’édification du système colonial, pas plus qu’ils ne peuvent aujourd’hui prendre une part active dans le maintien du système néo-colonialiste. C’est à juste titre qu’un proverbe congolais dit : « les perroquets sauvages ne se reproduisent jamais en captivité ». De même, les incitations par le prix et le profit ne pourront jamais mobiliser les peuples d’Afrique dans une économie de type libéral aussi longtemps que ceux-ci seront sous l’emprise de la double domination interne et externe propre au système capitaliste extraverti. Force est de reconnaître que près de cinq cents ans de domination et de servitude ont engendré un ensemble de paralysies structurelles qui ont malencontreusement stérilisé, « impuissancisé » les forces et les énergies internes de l’Afrique Noire. Dès lors, le travail productif y a perdu son utilité socioéconomique. Il n’est plus qu’un alibi pour échapper aux obligations sociales et patriotiques au lieu d’être une mise à contribution des talents ou de l’expertise individuelle en vue de l’édification de la Nation, ou mieux, un moyen d’expression de la solidarité envers les autres membres de la société, une voie obligée d’épanouissement individuel et collectif. Bien pire, l’emploi est soumis à la politique de bas salaires, une nouvelle forme d’esclavage qui prive l’économie africaine d’un marché potentiellement porteur, tant les masses vivant en dessous du seuil de pauvreté sont abandonnées à leur triste sort. Cependant, l’obstacle majeur au libéralisme en Afrique reste indubitablement d’ordre culturel. Comme nous l’avons dit précédemment, le continent africain est traditionnellement communautaire. Sa culture s’oppose aux valeurs occidentales de sécurité matérielle, d’intérêt personnel et de recherche du profit. Dans la société africaine, l’allégeance au groupe ou à l’ethnie prévaut sur l’autonomie et l’enrichissement personnel. Pas de place y est laissée à l’individualisme car les seules richesses sont celles qui sont partagées avec la communauté et qui sont socialement visibles. Les valeurs occidentales ne correspondent donc pas aux motivations et aux modes de comportement traditionnels en Afrique . En effet, le modèle capitaliste industriel, conjuguant le libéralisme et le machinisme, ne se réalise qu’en créant un clivage de la société en deux classes antagonistes : celle des employeurs ou classe capitaliste et celle des salariés ou classe prolétarienne. Dans ce contexte, la bourgeoisie capitaliste est le pivot de toute l’activité économique, de tout le mécanisme de production et de répartition des richesses. Il se forme inévitablement une caste d’entrepreneurs, fermée et jalouse de ses privilèges, qui recourt à des pratiques discriminatoires afin d’éliminer tous les resquilleurs, si tant est que le système capitaliste est vraiment libéral. Cependant, le schéma d’un développement propulsé par une seule classe est contraire au processus de promotion sociale traditionnelle africaine selon lequel toute réussite en dehors du cadre communautaire est bannie. D’après la théorie libérale, l’Homo oeconomicus portraituré par John Stuart Mill, qui est mû uniquement par son intérêt personnel et agit dans un monde de concurrence parfaite, selon le principe hédoniste, en maximisant sa satisfaction avec le minimum d’effort, demeure respectueux de l’intérêt général et artisan du progrès. Cependant, à la vérité, c’est le portrait de l’homme honni par la société africaine traditionnelle, un misanthrope, selon elle. Paradoxalement, l’esprit d’entreprise et le travail productif, dans un contexte marqué par la politique de bas salaires, sont perçus comme un asservissement au lieu d’être une voie obligée d’ascension sociale. Plus d’un siècle de système capitaliste extraverti n’a réussi à lever cette hypothèque qui pèse sur le libéralisme. Il a, par contre, contraint les sociétés traditionnelles africaines à s’enfermer dans leurs structures traditionnelles en dehors de l’esprit et des institutions du capital. Ainsi marginalisée, la majorité des Africains ne peuvent que témoigner sinon une apathie face au profit, du moins un manque de pragmatisme. Par-delà les obstacles culturels, les régimes africains postcoloniaux ont institué un système de corruption au sein duquel les agents économiques (ménages et entreprises) vivent principalement des revenus occultes ou aléatoires entraînant un comportement irrationnel et des habitudes de consommation qui détruisent les richesses et entravent l’édification d’une économie libérale. Dans ces conditions, l’introduction simple de la notion de profit ne conduit pas forcément à des transformations sociales permettant le passage de cette économie maffieuse à une économie industrialisée. Il paraît donc illusoire de fonder la stratégie de développement sur un réflexe de conscience mercantile dans le chef des producteurs de notre continent. La motivation étroitement économique, comme la liaison des revenus à la productivité individuelle est loin d’avoir l’effet de catalyseur principal des changements socioéconomiques profonds. Elle est largement pour longtemps et peut-être à jamais insuffisante. C’est pourquoi, sont voués à l’échec, tout projet de développement basé uniquement sur les principes libéraux, tous les efforts de redressement de l’économie axés sur le secteur de production moderne ainsi que tout système socioéconomique méprisant les valeurs culturelles africaines. Nous sommes éminemment convaincu que l’Afrique ne peut se développer en faisant fond sur le système libéral. Sans pour autant méconnaître ses vertus, nous devons constater l’incompatibilité entre les valeurs capitalistes et les valeurs africaines. Le recours aux forces du marché pour le développement ne devrait pas donner lieu, comme c’est le cas aujourd’hui, à un individualisme sauvage, mais plutôt renforcer l’initiative des communautés de base organisées notamment sous forme de sociétés coopératives. En tout état de cause, l’idéologie libérale n’est plus de nos jours aux postes de commandement. Même les pays libéraux par excellence ne laissent plus les forces de marché les mener à la meilleure forme de développement. Le Japon, la Corée du Sud, le Taiwan ne sont guère des pays socialistes mais tiennent leur vigueur d’une incontestable intervention de l’Etat ; les Etats-Unis ne sont pas en reste . Le poids et la diversité étonnante des interventions du gouvernement fédéral ont inspiré à Henri Guillaume le néologisme « Interventionnisme libéral » . Cela démontre à l’évidence que l’action gouvernementale est essentielle pour mettre les marchés au service de la croissance et de la redistribution des revenus. Dans tous les cas de réussite de la mutation de la société traditionnelle vers une économie libérale développée et de boom économique comme celui des Etats-Unis à partir de 1945, on observe toujours une fraction non négligeable de la population (quart-monde) qui n’arrive pas à se reconvertir au système du marché aux fins de saisir et exploiter les opportunités de gain, les réduisant à vivre en deçà du seuil de pauvreté. En effet, le système libéral, faut-il le rappeler, ne permet pas une redistribution équitable du revenu national. Etant basé sur le mécanisme de flexibilité des prix, il ne met pas l’accent sur la répartition du produit de la production. Contrairement aux coopérateurs qui s’obligent à fédérer les masses pour la satisfaction de leurs besoins existentiels, les entrepreneurs capitalistes poursuivent les individus solvables par un processus d’écrémage de la société, négligeant ses potentialités économiques et orientant, par-dessus le marché, les subventions publiques vers les secteurs et agents économiques déjà bien lotis. C’est pour ces différentes raisons que la gestion des secteurs vitaux tels que la sécurité sociale et les assurances n’obéit pas à la logique capitaliste, mais plutôt aux principes mutualistes. Du reste, le défi économique n’est plus de promouvoir à tout prix le libre jeu de l’entreprise dans le droit fil de la doctrine du « laisser faire » et du « laisser passer », mais de réguler le système au mieux des intérêts de la collectivité . Ainsi, tous les pays, particulièrement ceux du tiers-monde, ont à faire face au problème économique fondamental que pose l’affectation des ressources nationales (main-d’œuvre, capitaux, terre et ressources naturelles, devises étrangères) à un grand nombre d’utilisations (production de biens de consommation et des services sociaux, investissement dans l’infrastructure, l’agriculture, l’éducation …) en vue d’atteindre les objectifs globaux tels que la croissance du revenu national et sa redistribution équitable, la création d’emplois, la maîtrise de l’inflation, l’équilibre de la balance des paiements, la protection de l’environnement… . Dans cette optique, les pouvoirs publics sont amenés à soumettre tout grand projet d’investissement public ou privé à une analyse économique afin de déterminer le bénéfice que la collectivité pourrait en tirer, c’est-à-dire, son impact sur la réalisation des objectifs primordiaux de l’économie entière en fonction des contraintes affectant les ressources ou les facteurs de production disponibles. Passant outre à la doctrine libérale, l’analyse financière microéconomique ou l’évaluation du profit du promoteur du projet ne sert que de point de départ d’une analyse économique des avantages et coûts relativement aux intrants consommés et aux extrants à produire par ledit projet ou à ses effets sur l’économie nationale (incidences sur le PIB, sur la réduction de la pauvreté, sur la création de l’emploi, gains en devises, effets d’entraînement sur d’autres entreprises, sur la dépendance économique, sur l’environnement…) . La liberté d’entreprendre ainsi que la rationalité de l’investisseur et donc son appréciation de la rentabilité du projet ne se limitent plus au bénéfice individuel à réaliser, mais intègrent inexorablement les répercussions macroéconomiques de sa décision d’investir. Au fond, l’économie libérale occidentale, avec le système industriel qui la sous-tend, est entrée depuis la fin des années 1960 dans une récession sévère dont elle ne semble pas se relever jusqu’aujourd’hui. Le besoin d’équipements de plus en plus coûteux nécessitant une augmentation accélérée des investissements alors que l’efficacité du travail, la production et les recettes d’exploitation ralentissent, a mis à nu les limites physiques du système. Celui-ci est sujet à une « contre - productivité » croissante que la 3ème révolution industrielle issue de deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 n’a pas pu résorber . Depuis les années 80, il apparaît donc que « l’heure du marché » est bel et bien passée. L’échec du libéralisme reaganien aux Etats-Unis, atteste que l’aube du XXIe siècle est agitée par le dernier soubresaut du libéralisme . Cela est d’autant vrai que même le modèle capitaliste japonais est en proie à des nouvelles fractures sociales dans un pays à deux vitesses : « riches âgés » et « jeunes pauvres et désespérés » . Tandis qu’en Europe, la politique agricole commune dispense des subventions plantureuses aux agriculteurs en vue de leur permettre de vendre leurs produits en dessous du prix de revient et de faire face à la concurrence du tiers-monde. Ironie de l’histoire, l’Union Européenne se découvre offrant un radeau administratif à un secteur en naufrage, déterminée à le maintenir artificiellement en vie au mépris de la doctrine libérale dont elle se fait le héraut. Cela constitue non moins une reculade et une négation manifeste de l’esprit d’entreprise et de l’économie de marché. En 1995, la signature des accords multilatéraux, après 7 ans de négociations tortueuses, de tractations et de marchandage, a consacré l’avènement du « libéralisme contrôlé » dans le commerce mondial. La sempiternelle menace de guerre commerciale entre, d’une part, l’Europe et l’Amérique, et d’autre part, cette dernière et le Japon, ainsi que les incidents qui ont émaillé le processus de cette convention commerciale, certifient, s’il en était besoin, que le libéralisme n’est plus au rendez-vous des échanges internationaux. Le libre échange a longtemps cédé sa place à la guerre commerciale avec des armes protectionnistes . Malgré tous les accords intervenus antérieurement, les négociations du cycle de développement de Doha, engagées depuis l’année 2001, ont révélé la persistance des subventions agricoles d’ordre de 235 milliards de dollars dans les pays industrialisés, des barrières à l’importation des produits agricoles, des restrictions à l’importation des produits manufacturés du tiers-monde, des contingents tarifaires, des subventions explicites et implicites à l’exportation (crédits subventionnés à l’exportation, achats des stocks par les entreprises commerciales d’Etat et aide alimentaire comme moyen d’écouler les excédents de récoltes…) . Face à cette crise de l’idéologie libérale, surtout en Afrique, l’élite africaine se doit d’ouvrir la recherche en vue d’élaborer pour son continent une nouvelle théorie de développement, prenant en compte les spécificités de ses structures politiques et socioculturelles. Dans cet accouchement douloureux de la modernité, il importe que les pays en développement, en général, et ceux d’Afrique, en particulier, intègrent dans leur stratégie de développement l’existence de toutes les barrières commerciales érigées par l’OCDE au lieu de s’engager dans des réformes économiques béatement libérales . En conclusion, l’expérience de trente dernières années a fait justice de l’efficacité du libéralisme en tant que voie de sortie de crise et fondement politique de relance économique. L’Afrique est donc contrainte de rechercher une philosophie propre, culturellement compatible qui devrait guider toutes ses stratégies de développement. CHAPITRE V : RECHERCHE D’UNE PHILOSOPHIE AUTHENTIQUE DU DEVELOPPEMENT En accédant à l’indépendance, l’Afrique nourrissait de grands espoirs de croissance. Tout portait à croire qu’on allait rapidement assister à une augmentation des revenus et à une amélioration du bien-être de la population. Après quatre décennies consacrées au développement avec le concours de la Banque Mondiale et d’autres organismes internationaux, les résultats réalisés dans l’ensemble de l’Afrique Subsaharienne sont des plus médiocres. Il y a été observé non seulement une accentuation de l’extraversion de l’économie mais, en outre, des distorsions telles que l’aggravation de la crise de l’endettement, la détérioration de l’infrastructure socioéconomique, la baisse du taux de croissance, la diminution du revenu par habitant, la chute des exportations et la détérioration des termes de l’échange, le déséquilibre de la balance des paiements, l’exacerbation du chômage et l’accroissement du déficit alimentaire et de la misère des masses . Après une croissance rapide à la fin des années 60, le déclin économique de l’Afrique s’est amorcé dès le milieu des années 70. Le PIB par habitant a baissé de 15% entre 1977 et 1985 ; les exportations se sont effondrées, passant d’une croissance de près de 10% par an au début des années 70 à un léger ralentissement au début des années 80. Au cours de la période 1985-1992, l’Afrique Subsaharienne a enregistré l’une des plus fortes détériorations des termes de l’échange qu’elle ait connues, avec un recul de quelque 40%. Le déficit moyen du compte courant, hors transferts du secteur public, est passé, pendant ce temps, de 7% environ du PIB en 1984 à 12% en 1992. La croissance économique est tombée à un niveau moyen annuel de 1% environ entre 1990 et 1992. Rapportée au nombre d’habitants, la croissance réelle du PIB a été, durant la période 1986-1993 de -2,8% et -0,3% respectivement dans les pays de la Zone CFA et dans les autres pays d’Afrique Subsaharienne (Afrique du Sud et Nigeria compris). De 1990 à 1995, le PIB a augmenté en moyenne de 1,4% en Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) contre 5,1% pour l’ensemble des autres pays en développement à l’exception de l’ex-URSS. En considérant l’évolution des marchés internationaux au cours de quarante dernières années, il s’avère que l’importance de l’Afrique subsaharienne dans le commerce mondial a diminué . Du reste, elle n’attire plus qu’une infime partie d’investissements directs étrangers. Graphique 3. Répartition de l’investissement direct étranger vers les pays en développement de 1990 à 1994. Source : JOEL BERGSMAN et XIAOFANG SHEN, « L’investissement direct étranger dans les pays en développement : progrès et obstacles », in Finances et Développement, Décembre 1995. p. 7. Les exportations de l’Afrique, qui constituaient 3,1% du total mondial en 1955, n’en représentaient plus que 1,2% en 1990, soit une perte annuelle de 65 milliards de dollars aux prix courants. Ce résultat tient en partie au fléchissement de la demande mondiale des principaux produits d’exportation, mais aussi à l’érosion très nette des parts de marché de cette région. Au total, la part de marché moyenne de l’Afrique Subsaharienne sur ses 30 principales exportations non pétrolières est passée de 20,8% à 9,7%, soit une perte annuelle de l’ordre de 11 milliards de dollars sur la période . Comparativement aux pays de l’Asie de l’Est qui ont vu leurs revenus doublés à deux reprises au cours des 25 dernières années, 19 pays en Afrique Subsaharienne sont aujourd’hui plus pauvres . En 1965, la Thaïlande était plus démunie que le Ghana, l’Ouganda, le Niger, et, jusqu’à la fin des années 70, elle était davantage tributaire des exportations de matières que le Kenya ou la Côte –d’Ivoire. Et pourtant, la Thaïlande se présente de nos jours comme un pays nouvellement industrialisé dont la production manufacturière représente plus de la moitié de ses exportations. En 1970, les exportations de produits manufacturés de l’Indonésie étaient inférieures à celles du Nigeria ; elles sont aujourd’hui 36 fois plus importantes que ces dernières. Celles de la Malaisie qui, à l’époque, correspondaient à 3,5 fois celles du Kenya sont maintenant 52 fois plus élevées . En conséquence, six pays d’Afrique, à savoir le Ghana, la Guinée Equatoriale, le Libéria, le Nigeria, Sâo-Tomé et Principe et la Zambie, ont été rétrogradés du groupe des pays à revenu intermédiaire à celui des pays à faible revenu au cours de la décennie écoulée. Dans toute la région africaine la production reste insuffisante. A titre d’illustration, en 1987, l’Afrique Subsaharienne, qui comptait 450 millions d’habitants, soit plus du double de sa population au moment de l’indépendance, avait un produit intérieur brut (PIB) approchant les 130 milliards de dollars, ce qui était plus ou moins l’équivalent du PIB de la Belgique qui n’avait que 10 millions d’habitants . Ces contre-performances traduisent l’inefficacité des politiques socio- économiques, des institutions et des structures propres à la société capitaliste extravertie. Elles dénotent particulièrement une lacune fondamentale des politiques menées, dont aucune n’a appréhendé le monde rural dans la complexité de ses relations avec le monde urbain . L’Afrique, qui a une vocation essentiellement agricole, est devenue une terre où ses habitants meurent de faim tout en produisant suffisamment de Café, de Cacao, d’arachides, du bois, du cuivre, du diamant, du pétrole, … pour le bonheur des pays développés . Faute de progrès sur le plan de la gouvernance et des réformes institutionnelles, les perspectives économiques de l’Afrique ne sont guère prometteuses. Selon le rapport sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) publié par la Banque Mondiale et le FMI, l’objectif de réduction de la pauvreté sera probablement atteint en 2015 au niveau mondial, grâce à la forte croissance de l’Asie surtout de la Chine et de l’Inde, les deux pays les plus peuplés du monde. Mais en Afrique Subsaharienne, huit pays seulement, représentant environ 15% de la population régionale, ont des chances d’y arriver. Le tableau est bien plus sombre pour les objectifs de développement humain (mortalité infantile et maternelle, VIH/Sida et accès à l’eau salubre et à des services d’assainissement). Tableau 3. Tendance actuelle et prévue de réduction de la pauvreté à travers le monde d’ici 2015 Régions Pourcentage du total de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour Année 1990 Année 2000 Prévision 2015 Afrique Subsaharienne 44,6 46,5 42,3 Asie du Sud 41,3 31,1 16,4 Amérique Latine 11,3 9,5 7,6 Asie de l'Est et Pacifique 29,6 15,6 2,3 Moyen Orient et Afrique du Nord 2,3 2,4 1,2 Source : BOUGTHON, J.M. et QURESHI, Z., « Revitaliser les objectifs de développement pour le millénaire » in Finances et Développement, septembre 2004, p. 42. Graphique 4. Tendance de réduction de la pauvreté à travers le monde. Source : Idem. C’est donc que les idéologies, les théories scientifiques, la philosophie du développement adoptées par l’Afrique n’ont pu qu’isoler le monde rural et perpétuer le système capitaliste extraverti érigé pendant la colonisation. Tout est parti du lendemain des indépendances, il y a plus ou moins 46 ans. Les nouveaux responsables politiques africains, grisés par la liberté politique fraîchement conquise, désorientés par l’acharnement démagogique néo-colonialiste, furent amenés à croire que leurs pays étaient sous-développés et choisirent de construire la société et la vie africaines sur le modèle des pays avancés d’Occident, pour les uns, selon le schéma marxiste, pour les autres. En réalité, les anciennes puissances colonisatrices, sachant qu’elles ne pouvaient pas se passer des ressources qu’elles tiraient de la colonisation, offrirent habilement, par des accords de protection et de coopération, leurs services « pour aider les jeunes nations à arriver au même niveau de développement qu’elles ». Ainsi subjugués par les experts classiques, les dirigeants africains adoptèrent-ils une politique de mimétisme et de prestige, profondément extravertie, jouant aux supplétifs d’intérêts étrangers en sacrifiant les besoins essentiels de leurs populations que sont notamment l’alimentation, la santé, l’habitat, le transport, l’éducation et la culture. Exprimée sommairement, cette politique consistait à se spécialiser dans quelques produits d’exportation en vue de tirer les ressources en devises qui, ajoutées à l’aide financière accordée par voie de coopération internationale, permettraient à l’Africain de vivre comme dans les grandes métropoles occidentales. Dans cette optique, certains dirigeants optèrent pour leur pays un développement de type socialiste, d’autres parièrent sur un développement de type capitaliste ; certains privilégièrent des agricultures de pointe et d’autres cherchèrent la promotion des masses rurales ; ici, on choisit de très grands ouvrages, là des microréalisations. Bien des Nations à la recherche de l’indépendance économique, ont organisé elles-mêmes des politiques macroéconomiques suicidaires. Au point que durant la période 1973-1979, les dirigeants africains, profitant de l’amélioration notable des termes de l’échange de leurs exportations, augmentèrent fortement leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement et contractèrent des emprunts importants sur le marché intérieur et sur le marché international. Parallèlement, ils adoptèrent des politiques financières expansionnistes afin de promouvoir le crédit dans le secteur privé, tandis que la réglementation du taux d’intérêt le plaça à un faible niveau, décourageant l’épargne et favorisant une mauvaise allocation des ressources. Ils élargirent malencontreusement le champ d’application des contrôles des prix et des subventions, et, avec des taux de change de plus en plus surévalués, renforcèrent les restrictions de change et les contingents commerciaux qui firent naître un peu partout des marchés parallèles de marchandises et de devises. Les conséquences de ces politiques furent aggravées par des mesures structurelles inadéquates. La plupart des pays africains créèrent un grand nombre d’entreprises publiques improductives . Trop d’infrastructures, trop de bétons, trop de grands barrages sous-employés, trop d’usines musées, trop de gratte-ciel, trop d’hôtels furent réalisés à la place d’écoles, de sociétés coopératives, de structures de production agricole, d’infrastructures sociales rurale et urbaine,… . Cette période euphorique s’acheva avec l’apparition des contraintes de remboursement de la dette extérieure du secteur public dont le poids s’était alourdi au début des années 80 à cause de la montée des taux d’intérêt internationaux. De plus, le deuxième choc pétrolier en 1979-80 et la récession dans les pays industrialisés entraînèrent une dégradation de 12% des termes de l’échange de l’Afrique Subsaharienne entre 1980 et 1982. Cette situation fut aggravée par la pire sécheresse qui frappa de vastes régions africaines entre 1982 et 1984. Ce revers de fortune vint, pour comble, faire sombrer presque toute l’Afrique Subsaharienne dans une grave crise économique et financière. En somme, le bilan global de quatre premières décennies d’indépendance est, pour ainsi dire, décevant. Sans nul doute, la politique de mimétisme et de prestige a détruit peu à peu l’Afrique et l’a rendu à nouveau esclave des puissances impérialistes et des anciennes métropoles colonisatrices. Celles-ci soumettaient, dès 1985, le continent noir à des programmes drastiques d’ajustement macroéconomique et structurel sous l’encadrement de la Banque Mondiale et du FMI. Mais ces mesures conçues en dehors de l’Afrique par des experts étrangers, n’avaient pas réussi à réprimer la stagnation et la contraction de l’économie africaine, entraînant des coûts économiques et sociaux énormes. En effet, la forte compression des dépenses prioritaires et en capital dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’infrastructure avait compromis le fondement nécessaire à une croissance durable. En fait, ces programmes d’ajustement structurel ne pouvaient pas susciter la croissance économique parce qu’ils faisaient fond sur les structures socioéconomiques extraverties héritées de la période coloniale, pas plus qu’ils ne s’attaquaient au népotisme et à la corruption. La forte dépendance à l’égard des exportations en destination des pays développés et des importations en provenance de ceux-ci avait annihilé tous les efforts des pays africains dans leur tentative de pallier les goulots d’étranglement structurels et les déséquilibres financiers qui entravaient leur croissance. Si bien qu’aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation du commerce dans le cadre de l’OMC, l’Afrique Subsaharienne n’est pas à même de retirer sa part du bénéfice attendu des réformes du commerce international. Au pis aller, le PIB baisserait de 0,2% par an dans cette région. Globalement, si les projections de la Banque Mondiale s’avèrent exactes, il y aura 800 millions de pauvres dans le monde dont 400 millions, soit la moitié du total mondial, en Afrique Subsaharienne. Graphique 5. Prévision du nombre de pauvres pour 2015. SOURCE : PRAKASH LOUNGANI, « Qui gagne la guerre mondiale contre la pauvreté ? » in Finances et Développement, Décembre 2003, p.38. On constate, avec le recul, que les gouvernements africains ont été, sous la pression des crises financières répétées des années 80, obligés de concentrer leurs efforts sur le règlement des problèmes immédiats et urgents. La priorité alors donnée à l’exécution de programmes d’ajustement économique et à la stabilisation financière à court terme, a détourné leur attention des ambitieux objectifs de développement, dont la plupart ont été abandonnés. Toutefois, il a fallu attendre la fin de la décennie 80 pour voir les dirigeants africains prendre conscience du fait que l’attention excessive accordée aux problèmes courants les avait amenés à négliger les mesures indispensables pour améliorer durablement le bien-être national . Au-delà des faits et des chiffres, les vicissitudes de l’histoire de l’Afrique postcoloniale attestent que le continent et ses dirigeants ont été victimes d’une aliénation sous-tendue par les idéologies qui leur ont été indiquées au nom de la « science » par des « spécialistes » occidentaux. Ces derniers se sont évertués à appliquer à l’Afrique le modèle industriel occidental sans avoir égard aux valeurs socioculturelles africaines. En effet, les approches classiques du développement reposent sur trois postulats majeurs : Une conception mécaniste et linéaire de l’histoire et du développement selon laquelle chaque société passe nécessairement par les mêmes stades avant de décoller . Selon Rostow, toute société embrasse les étapes suivantes dans sa marche vers le développement : la société traditionnelle, la transition vers le démarrage, le démarrage, la maturité et l’ère de la consommation de masse ; Une approche technologique de la gestion et du développement institutionnels, qui part de l’idée que la modernisation passe obligatoirement par l’assimilation des méthodes et techniques de gestion occidentales ; Et, une approche ethnocentrique de la culture fondée sur l’idée que toute société tend, en dernière instance, à épouser les mêmes valeurs que les pays dits développés ; les pays ne partageant pas ces valeurs étant considérés comme primitifs et sous-développés. Ceci a comme corollaire que le développement de l’Afrique doit être stimulé de l’extérieur, il suppose de la part des pays occidentaux industrialisés un transfert de culture, de méthodes, et de technologies . Cependant, il y a tout lieu de mettre en doute aujourd’hui chacun de ces postulats. 5.1. CONCEPTION MÉCANISTE ET LINÉAIRE DE L’HISTOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT Il est erroné de croire que toute société est appelée à vivre la même expérience que l’Occident avant d’accéder au développement. A vrai dire, chaque peuple cherche la meilleure voie du progrès selon ses ressources naturelles, humaines et financières, selon son capital culturel et scientifique ainsi qu’en fonction des obstacles naturel, politique, social et économique auxquels il est confronté. En ce qui concerne particulièrement l’Afrique, le système capitaliste extraverti échappe aux étapes classiques de la croissance économique en ce qu’il n’est pas une transition vers le capitalisme de développement, mais plutôt, un système de pillage qui ne peut, dans la meilleure hypothèse, que déboucher sur une croissance sectorielle sans développement véritable de toute l’économie. En restant même dans le cheminement de la croissance économique tel que développé par W. W. ROSTOW, on remarque que la filiation des étapes n’a pas été la même pour tous les pays d’Europe Occidentale. Seule la Grande Bretagne, favorisée par sa situation géographique, ses ressources naturelles, ses possibilités de négoce, sa structure sociale et politique, a été le premier pays à réunir toutes les conditions nécessaires au démarrage économique entre 1783 et 1802. D’autres pays occidentaux n’ont démarré qu’à la suite des pressions des puissances étrangères . Le Canada a paradoxalement connu l’étape de consommation de masse en 1925, avant de connaître la maturité économique en 1950. Tandis que l’URSS a atteint la maturité en 1955 sans jamais connaître l’ère de consommation de masse par la suite . Par ailleurs, cette formalisation de l’histoire de l’Occident ne peut être exhaustive, l’avenir n’étant pas connu. W. W. ROSTOW se pose la question de savoir ce qui adviendrait après les cinq étapes de la croissance énumérées ci-dessus. Il se demande s’il ne s’en suivra pas une période de stagnation spirituelle de longue durée. Ceci démontre la faiblesse de l’approche mécaniste et linéaire de l’histoire et du développement. Il est, dès lors, hasardeux de faire de l’expérience historique de l’Occident un modèle applicable rigoureusement à toutes les sociétés. 5.2. APPROCHE TECHNOLOGIQUE DE LA GESTION ET DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNELS C’est une tentative d’imposition du modèle industriel occidental à toutes les sociétés . Mais les échecs de cette approche sur le terrain africain montrent les limites de la conception technologique. Pendant longtemps, les experts occidentaux ont eu tort de penser que pour l’Afrique, à l’instar de l’Europe, le développement impliquait « la croissance », « l’industrialisation », et « les forces du marché libre». En effet, les projets de développement classiques réalisés en Afrique ont, entre autres griefs, péché par le fait qu’ils ont accordé une importance disproportionnée aux prescriptions techniques et n’ont pas pris en compte la nécessité de s’adapter au milieu culturel local et de prendre en compte les techniques de gestion autochtones. Cette tentative de transfert de savoir-faire n’a pas pu amorcer le démarrage économique du continent africain. D’ailleurs, le modèle est mis en mal ou en pièces par la mondialisation dans les vieux pays industrialisés, lesquels souffrent du chômage et de la délocalisation. . Nous sommes fondé à penser que dans chaque pays africain, la réalisation d’un consensus national sur les réformes systémiques demeure la meilleure voie de sortie de crise. En tout cas, il est essentiel que toute la nation, c’est-à-dire, les responsables politiques, les fonctionnaires et la population en général, s’identifient pleinement aux programmes et projets de développement afin de les intégrer, de se les approprier. Tant il est vrai que la vitalité des micro entreprises du secteur informel, pourtant aux prises avec un environnement hostile, et privées de toute aide de l’Etat, s’explique avant tout par leur aptitude à concilier les valeurs socioculturelles africaines avec l’impérieuse efficacité économique. L’essor de l’Afrique dépend des efforts qui seront déployés dans la sélection des techniques de gestion occidentales, du reste, patrimoine de l’humanité, et leur adaptation aux spécificités socioculturelles africaines, d’une part, et dans la réhabilitation des techniques de gestion autochtones efficaces, d’autre part. Il s’agit de procéder à un arbitrage entre les valeurs traditionnelles et celles qui procèdent de l’étranger, en évitant tant le maintien aveugle du passé ancestral que la copie servile des valeurs étrangères, mais en facilitant la fécondation de ces dernières avec les valeurs africaines, faisant en sorte que ce résultat soit lui-même l’expression du passé ancestral . 5.3. APPROCHE ETHNOCENTRIQUE Cette approche tente vainement d’uniformiser un monde qui est jusqu’ici d’une prodigieuse diversité. Il est cependant faux de croire que toute société épouse, au stade ultime, les valeurs occidentales telles que la recherche du profit, l’esprit d’entreprise, la sécurité matérielle, l’intérêt personnel et le modèle industriel basé sur une conception étroitement productiviste et quantitativiste négligeant les facteurs sociaux. En effet, chaque société opère ses changements suivant sa pente culturelle et non pas nécessairement en s’acculturant. La théorie selon laquelle, l’acculturation est une condition préalable au développement est insoutenable. Certaines sociétés ont réussi à se moderniser sans rien sacrifier de leurs coutumes, de leur culture ou de leurs valeurs traditionnelles. Le Japon, la Corée du Sud, et le Taiwan offrent l’exemple de pays qui ont atteint des niveaux élevés de production et un niveau technologique avancé tout en préservant leur identité nationale . En Afrique, la tendance des dirigeants à confiner le paysan, selon la logique de l’approche ethnocentrique, au seul rôle de producteur individuel, dépouillé de sa personnalité socioculturelle et de son statut social, est la source de réticences, de l’apathie et de la non adhésion des masses aux programmes de développement . Le développement de l’Afrique ne peut donc passer par l’adoption des valeurs occidentales parce que celles-ci ne correspondent pas aux motivations et aux modes de comportement traditionnels des Africains. Ces derniers, comme nous avons eu à le développer plus haut, vouent au groupe ou à l’ethnie une allégeance qui prévaut généralement sur l’autonomie et l’intérêt personnel. Leur souci est, à toute circonstance, de préserver les équilibres sociaux et une certaine équité plutôt que de favoriser la réussite individuelle. D’autant que les intérêts des communautés villageoises et ethniques prennent le pas aussi bien sur ceux de l’individu que sur les objectifs nationaux fixés par l’Etat. A tout prendre, les approches classiques du développement prérappelées ne tiennent pas compte des dimensions socioculturelles des problèmes économiques en Afrique. C’est pour cette raison qu’elles ont précipité la ruine de ce continent. Sans doute, les Africains ont été victimes d’une duperie en acceptant passivement des notions, des formalisations et des stratégies scientifiques qui non seulement n’ont pas été élaborées à partir de leur expérience propre, mais leur ont été proposées et imposées pour le service des seules forces capitalistes étrangères. La faillite des approches classiques du développement met en lumière la nécessité d’élargir le concept de développement en y intégrant l’approche des sociologues, des écologistes et des économistes. L’élite africaine doit, par conséquent, collaborer avec l’autorité coutumière en place dans les communautés rurales en vue d’élaborer une nouvelle philosophie du développement du continent. Celle-ci devra concilier les valeurs sociales et culturelles africaines, à savoir : la solidarité, l’entraide et la participation populaire, avec les impératifs d’efficacité et d’accumulation économiques. A ce titre, elle sera fondée sur l’idée d’un développement global, intégré, endogène et écologiquement viable. 5.4. DÉVELOPPEMENT GLOBAL L’idée d’un développement global renvoie à celle d’une stratégie de transformation de la nation tout entière en vue de l’épanouissement matériel, social et culturel de la grande majorité de ses citoyens dans le cadre d’une solidarité interethnique ou intertribale. C’est, en d’autres termes, la dynamisation de tous les secteurs de la vie de la Nation animée par un sentiment nationaliste en vue de réaliser, au-delà du progrès économique, la promotion sociale, culturelle et politique de toutes les couches de la population . De ce point de vue, le développement appelle des stratégies qui concourent à encourager les entreprises privées dynamiques, les communautés de base autonomes et productives et les services publics efficaces, de manière que tous les partenaires sociaux puissent œuvrer dans la réalisation des objectifs nationaux de développement . Pour l’Afrique, il s’agit d’une mutation radicale des structures de la société postcoloniale extravertie afin de créer un système social et économique autocentré. Cela implique l’abolition de la dichotomie classique entre le « moderne » et le « traditionnel », ou le système « de production capitaliste à économie basée sur l’entreprise » et celui de « production paysanne » fondé sur l’organisation familiale et l’autoconsommation courante, et ce, en vue de la création d’un système socioéconomique assurant le progrès national. En l’occurrence, il importe de mettre fin à la politique de marginalisation des communautés villageoises en les réhabilitant et les intégrant dans un nouvel ensemble culturellement homogène. Dans cette perspective, la technologie moderne et les ressources financières extérieures pourront être rationnellement sélectionnées aux fins de l’émancipation nationale en évitant, par-dessus tout, de sombrer dans le syncrétisme. Le développement global ne va donc pas sans la réalisation de l’intégration originale des deux modes de production du système dualiste postcolonial à l’effet de supprimer le rapport de domination du « secteur moderne » sur le secteur « traditionnel » due à la différence primitive de rendement et de dynamisme, laquelle différence entretient malencontreusement le système néo-colonialiste . Au bout du compte, le développement est la recherche d’une alternative globale, d’une stratégie de transformation profonde de la société afin d’intégrer véritablement toutes ses structures . 5.5. DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ En tant qu’idéal, le développement intégré constitue un cheminement vers la symbiose des structures d’un ensemble économique en vue d’une efficacité optimale. C’est en fait une mutation de l’environnement socioéconomique à la faveur d’un processus embrassant à la fois plusieurs activités et secteurs notamment l’agriculture, l’industrie, l’infrastructure économique et sociale, les services ou programmes de bien-être social… Considéré dans cette optique, le développement exige l’établissement d’une cohérence, d’une part, entre les objectifs, les actions et les ressources disponibles pour l’exécution du programme économique, et, d’autre part, entre les objectifs économiques et les autres activités qui concourent à la promotion et au bien-être de la communauté nationale. Ainsi, les objectifs tels que la production, l’emploi, le revenu, la monnaie, les finances publiques, l’équilibre de la balance des paiements, l’éducation, la santé, la science, la culture, la nutrition et la participation politique deviennent relativement prioritaires. Car le but ultime du développement est l’amélioration intégrale de la qualité de la vie des populations, c’est-à-dire, l’épanouissement de l’homme dans toute son intégralité. Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’une adjonction d’unités ou de secteurs économiques inefficaces, mais plutôt un rapprochement rationnel qui vise un niveau de productivité tellement élevé que, l’emportant sur les politiques protectionnistes, il saisit toutes les opportunités qu’offre le reste du monde. De ce fait, l’intégration déborde les frontières nationales et s’inscrit dans l’espace économique africain impliquant, de la part de tous les gouvernements, des efforts concertés pour assainir les politiques budgétaire, monétaire, financière et commerciale aux fins d’améliorer la compétitivité des entreprises nationales et d’optimiser l’apport des services, capitaux et l’accès aux marchés extérieurs. 5.6. DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE Ce concept ramène à un processus de mutation et de changement continu, allant dans le sens du progrès social, économique et politique, avec la participation de la majorité des individus concernés à la base et à leur profit. Fondé sur la population, le développement est envisagé ici comme une véritable aventure dans laquelle une nation s’engage, faisant appel à toutes ses capacités d’autocréation, à toutes les disciplines de la science ajustées aux réalités, aux aspirations et aux potentialités de la nation concernée . Cette approche néo-structuraliste préconise l’adoption des politiques de substitution des importations dans les secteurs où les conditions et les ressources locales permettent d’envisager une vitalité économique soutenue et la diversification de l’économie nationale. Il ne s’agit pas tant de proclamer l’indépendance économique souvent enracinée dans la rhétorique et la doctrine politiciennes, mais de démocratiser réellement l’économie en créant des noyaux de développement à la base, regroupant les institutions publiques, les élites, les entreprises et les populations historiquement marginalisées, et ce, dans le respect des différentes identités et cultures présentes dans le pays . Cela suppose une harmonisation entre les objectifs nationaux ainsi qu’une coordination efficace, mais souple, aux niveaux central et local. A cette fin, il importe d’élaborer une stratégie de dialogue entre les divers intervenants qui doivent se considérer comme partenaires et coresponsables du développement ; une concertation permanente entre tous les acteurs de développement précités et la société civile dans laquelle doivent rayonner les regroupements des paysans qui constituent, du reste, la majorité de la population nationale . En fait, le développement, sous cet angle, se fonde sur une redynamisation des masses au niveau de la base et prône leur auto organisation en vue de leur promotion . Dans une perspective africaine, le développement endogène rime avec le développement du monde rural à cause de sa supériorité numérique et surtout en raison de la personnalité socioculturelle africaine qu’il conserve . Plus que jamais, le développement devrait aujourd’hui prendre en compte les besoins et la culture du peuple bénéficiaire de ses effets . Son mode d’organisation sociale doit être mis en exergue afin de mobiliser suffisamment les dynamismes locaux. En aucun cas, le développement ne pourrait être conçu comme un don, ni le résultat d’une évolution spontanée, moins encore l’aboutissement des efforts de coopération internationale, ni de l’assistance des nations plus nanties. Il ne pourrait tout autant se réduire à la réalisation de modèles conçus par les experts. L’ascension économique est plutôt le fruit d’une entreprise résolue, une mise en œuvre de toutes les ressources intérieures de la nation (ressources humaines, naturelles et financières), en tenant compte de ses valeurs culturelles tout en assurant la participation populaire, d’autant que le développement ne se fait pas contre les populations, pas plus qu’il ne peut consister en une mystification légitimant la privatisation des services publics en contrepartie des promesses contestables . Par contre, le développement est réalisation, épanouissement et libération de tout un peuple. Il doit viser l’attribution aux gens du peuple des capacités d’action afin d’assurer leur participation dans le processus de développement et leur promotion sociale dans le respect de leur identité culturelle et de la cohésion de leur société . Dans cette optique, les institutions politiques et les communautés de base se doivent de donner à tous les citoyens, sans exclusive, voix au chapitre afin de leur permettre de rechercher la justice, la protection des droits civiques et de ranimer la morale publique. Ils pourront ainsi contribuer à l’avènement en Afrique d’une nouvelle ère d’intégrité dans la gestion des affaires publiques et, qui mieux est, à l’édification des Etats qui feront droit aussi bien aux élites qu’aux pauvres, aux opprimés, aux étrangers… Qu’on ne s’y méprenne pas, c’est dans la solidarité, le travail, la justice, l’intégrité et la science que se trouve le développement durable . 5.7. DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUEMENT VIABLE De nos jours, le monde menace de crouler sous les problèmes de pollution de l’environnement lorsqu’on considère les effets que pourrait avoir l’accroissement attendu de la population mondiale, de la production industrielle, de la consommation d’énergie et de la demande alimentaire. Si les pratiques actuelles étaient maintenues, il pourrait en résulter une épouvantable dégradation du cadre de vie aussi bien dans les villes que dans les campagnes . Pour prévenir cette catastrophe, les pays industriels ainsi que ceux du Tiers-monde devraient opter pour un développement humain et économique respectueux de l’environnement. Sans bonne protection de l’environnement, pas de développement durable, ou inversement, sans développement, pas de ressources suffisantes pour faire les investissements qui s’imposent pour la protection de l’environnement. Dans cette optique, la nouvelle philosophie de développement prône la synergie entre efficacité économique, croissance des revenus et protection de l’environnement et réfute les antinomies entre l’activité économique et l’environnement. Car le développement ne peut être durable que si les efforts de grande envergure sont déployés pour protéger et non pas détruire l’environnement. En conséquence, les objectifs écologiques tels que l’intégrité de l’écosystème, la capacité biologique et la biodiversité sont devenus indissociables aux objectifs économiques du développement . Plus qu’à toute époque de récente mémoire, la croissance devrait désormais être réalisée avec un moindre coût pour l’environnement. Cette nouvelle approche vise un meilleur environnement, un air et une eau plus salubres, et la disparition pour ainsi dire totale de la misère tant pour les générations présentes que pour les générations futures. Elle poursuit l’amélioration de la situation des centaines de millions de ruraux dont le sort dépend de la gestion de leurs terres. La nouvelle voie implique la mise à la disposition des populations rurales des moyens et de l’instruction ainsi que leur préparation psychologique à la prise des décisions et à la réalisation des investissements conformes à leurs intérêts à court, à moyen et à long terme. En dernière analyse, le développement n’est pas une marche allègre vers le paradis de consommation. Il est un processus d’organisation rationnelle des forces sociales et économiques nationales dans un cadre culturellement homogène grâce à une intervention équilibrée des pouvoirs publics, combinée avec un apport judicieux de la technologie et des capitaux extérieurs en vue d’atteindre un niveau d’activités économiques, une taille et un rendement de l’appareil productif, un volume d’emploi intérieur et d’épargne (publique et privée) suffisants pour enclencher une dynamique de progrès garantissant l’harmonie, sur le plan national, et la paix sur le plan international . Pour les pays d’Afrique, cela revient à défier les puissances impérialistes et les anciennes métropoles en battant en brèche le système économique extraverti hérité de la colonisation afin d’ériger dans ce continent une véritable structure de développement . C’est un pari d’autant plus difficile à tenir que le dépassement du système économique que nous avons anathématisé plus haut n’est pas d’une certitude objective dans un horizon temporel prévisible. L’histoire a démontré en effet que la société capitaliste extravertie était capable de muer pour éviter, ou tout au moins retarder, une mutation. Qu’elle savait se réformer au seuil de rupture et qu’à certains tournants historiques, elle était à même de reconquérir, sous des formes inédites, certains terrains perdus . Le cas de la République Démocratique du Congo illustre bien la pérennité de ce système. De l’Etat Indépendant du Congo, en passant par le Congo Belge, la République Démocratique du Congo, à la République du Zaïre sous le régime dictatorial, même par-delà le processus de démocratisation du régime politique, les structures économiques dualistes ont survécu à tous les changements. Le développement socioéconomique et politique nécessite, en l’espèce, un programme complexe, ambitieux et téméraire exigeant de l’élite africaine un engagement ferme sur les plans spirituel, moral et matériel. Il faut, après tout, un minimum de vertu dans tout processus de développement. D’où, l’urgence pour les Africains de promouvoir les stratégies de développement privilégiant la population et sa richesse culturelle autant que la révolution morale et spirituelle. Les dirigeants politiques se doivent désormais de parier sur l’homme, ou plus précisément, sur les hommes groupés en communauté. Bodin n’écrivait-il pas au XVIe siècle qu’ « il n’est de richesse que d’hommes ». A notre avis, le regroupement des populations en vue du développement peut être réalisé de manière efficace dans le système coopératif. En effet, le coopératisme, à condition de l’adapter aux valeurs et techniques de gestion traditionnelles, pourra favoriser la mutation agricole et la relance économique du continent africain dans le respect et la protection de son environnement naturel. TROISIEME PARTIE LES ATOUTS DU COOPERATISME AFRICAIN Dans cette partie, nous explicitons d’abord les raisons qui militent en faveur du choix du système coopératif entre autres stratégies de développement social et économique ainsi que la capacité réelle du mouvement coopératif à susciter la relance économique de l’Afrique Subsaharienne. Ensuite, nous examinons le problème d’assimilation dudit système par les africains. Enfin, nous tentons de répondre à la question relative aux domaines dans lesquels la contribution du système coopératif peut être déterminante. CHAPITRE VI : RAISONS DE LA PREFERENCE DU SYSTEME COOPERATIF Nous avons souligné dans le chapitre précédent que les approches classiques du développement ont précipité la faillite de l’Afrique Subsaharienne, tant elles n’ont pas pleinement intégré les dimensions socioculturelles des problèmes économiques de cette région. Nul doute que la conception du développement du type industriel, les institutions dites modernes, pas plus que les techniques de management n’aient pu assurer la mobilisation des ressources humaines et matérielles pour le développement harmonieux de l’Afrique. Notre continent est donc aujourd’hui à la recherche des nouvelles approches plus adaptées à ses caractéristiques sociologiques. Pour notre part, le coopératisme est l’un des systèmes qui peuvent stimuler les capacités d’organisation et de gestion des peuples africains aux fins d’enclencher une spirale vers le progrès socioéconomique et politique. Le choix de ce système se justifie du fait de ses similitudes avec le collectivisme millénaire africain. Basé sur la population et sa richesse culturelle, il offre des structures communautaires efficaces dont le continent a besoin pour amorcer son développement économique de manière globale, intégrée et endogène. En outre, le coopératisme peut prospérer à côté d’un capitalisme qu’il aura, par influence ou par réaction, humanisé, malgré les antagonismes entre les deux systèmes. En effet, l’Afrique traditionnelle, régie par la coutume, était caractérisée, à son âge d’or, par son mode de vie communautaire fondé sur l’esprit de solidarité, d’entraide et de justice ainsi que sur la participation populaire. Ces valeurs étaient traduites en politique par la forme que revêtaient les empires et royaumes africains. Ces institutions se situaient au sommet de la pyramide des groupements communautaires bénéficiant de l’autonomie de gestion et assurant la participation de tous les membres à la vie de la communauté. Celle-ci avait jadis institué un espace économique fonctionnel et viable qui assurait aux ménages les meilleures conditions de santé, de travail et d’épanouissement social. Tant et si bien que l’individu était parfaitement intégré dans son groupe social, au sein duquel il bénéficiait de la solidarité des autres membres par la mise en commun des moyens de production. L’union faisait la force de l’Afrique précoloniale . Cette longue expérience du communautarisme suggère, pour l’Afrique un développement communautaire et exclut toute vision d’un développement de type occidental basé sur l’individualisme, la recherche du profit et la sécurité matérielle . Cela est si vrai que tous les projets de développement qui s’évertuent à appliquer le modèle industriel occidental à l’Afrique sans y intégrer les valeurs socioculturelles de ce continent échouent. La politique de mimétisme et de prestige qui sous-tend ces projets ne prend pas en compte les besoins essentiels des populations et renforce, de surcroît, la dépendance du continent noir à l’égard des pays développés. Ainsi, s’est érigé dans cette région, un système socioéconomique extraverti, porteur de germes de problèmes structurels et institutionnels qui brident la relance économique. Dans ces conditions, l’Afrique n’a plus comme ressources que, d’une part, de sélectionner les techniques de gestion occidentales et les adapter à ses spécificités socioculturelles et, d’autre part, de réhabiliter toutes ses propres techniques de gestion efficaces. Nous ne répéterons jamais assez que la nouvelle voie de développement pour l’Afrique devrait tenir compte de sa longue tradition de vie communautaire, car le développement n’a jamais été et ne peut être indépendant de la culture d’un peuple . A cet égard, le système coopératif est propice à toute action visant à lever les hypothèques (structurelles et mentales) qui pèsent sur la croissance économique du continent africain et ce, à un moindre coût sur le plan social. En effet, il pourra atteindre cet objectif en préservant la solidarité et en reconstituant les relations traditionnelles, classiques, villageoises, tribales, ethniques et interethniques dans le cadre d’une agglomération citadine, sans les altérer fondamentalement (instaurer les relations nouvelles et progressistes dans les villes africaines). Contrairement au système libéral, le coopératisme ne combat pas les valeurs socioculturelles africaines. Il prône, à l’instar du collectivisme millénaire africain, les valeurs telles que la solidarité, l’entraide, le self-help, la sociabilité, l’équité et la démocratie, lesquelles sont, entre autres, les éléments formateurs de la culture africaine . Il permet, en principe, de résorber les contraintes au décollage économique de l’Afrique par ce qu’il mise sur la vie communautaire propre à la sauvegarde de la cohésion et de la richesse culturelle des autochtones. Par contre, le déséquilibre entre les masses désœuvrées, une classe ouvrière surexploitée, une bourgeoisie nationale extravertie, une corporation dominante des capitalistes étrangers, ainsi que la généralisation de la misère, menace d’implosion l’Afrique postcoloniale. Le choix du système coopératif conjure cette éventualité en favorisant toutes les réformes socioéconomiques qu’exige la gravité de la situation, sans recours à la violence, ni frénésie démagogique, ni discrimination, mais simplement par des méthodes évolutionnistes et pacifiques . Il se révèle que le coopératisme constitue, en l’espèce, un cran d’arrêt sur la route de la désespérance. Rompus au jeu démocratique, les coopérateurs n’ont de cesse de rechercher, dans un esprit coopératif, le consensus national sur les réformes macroéconomiques, financières, commerciales et fiscales grâce à la concertation entre l’Etat et la société civile. C’est pour cette raison que la dialectique coopératiste ne peut déboucher ni sur la guerre, ni sur l’anarchie, moins encore sur la xénophobie. Car le coopératisme s’est engagé dans la lutte non pas contre les hommes mais plutôt contre le système d’exploitation. En facilitant la résolution des problèmes de l’action collective, il induit, sur le plan politique, le rassemblement des masses aux fins de remettre en question le statu quo et de pousser les élites à démocratiser les institutions publiques en vue du partage équitable des richesses par voie de redistribution, sans détruire les bases de création future desdites richesses . A ce propos, la doctrine coopérative jette plus de lumière sur la manière dont l’Afrique devrait mener particulièrement le combat pour son indépendance économique. En effet, la dominante du coopératisme est la démocratie, c’est-à-dire, la gestion des entreprises par et pour ses propres usagers. C’est pourquoi, la société coopérative s’affirme toujours comme une force profondément enracinée dans le lieu où elle se développe, une force autochtone, et donc un rempart contre l’invasion de capitaux étrangers recherchant des profits faramineux sans tenir compte des besoins réels des populations africaines . Ces dernières peuvent s’organiser « coopérativement » pour orienter leurs ressources propres, les emprunts et les investissements directs étrangers vers les secteurs les plus rentables sur les plans social et financier tout en attribuant à chacun un revenu compatible avec le niveau réel de sa production. En créant les coopératives dans tous les secteurs où les besoins s’expriment, à condition que la production se réalise à des rapports qualité prix plus intéressants que ceux du marché, les coopérateurs rationalisent l’affectation des ressources dans l’ensemble de l’économie et entraînent une réduction des coûts de production. Ainsi, les coopératives constituent, par excellence, les noyaux de développement endogène. A ce titre, les forces coopératives seront capables de redonner une impulsion aux secteurs de santé, de l’éducation et de l’agriculture en vue d’améliorer le bien-être de la population (mesuré par rapport à l’Indice de développement humain établi par le Programme des Nations Unies pour le développement). Ainsi, les coopérateurs pourront adapter la technologie moderne dans la production des biens et services, créer les infrastructures de base et, ipso facto, se dégager des corvées quotidiennes pour se former et pour faire des meilleures projections de leur avenir. Dans la lutte contre la pauvreté, le coopératisme se démarque donc du système capitaliste extraverti, lequel perpétue la misère en créant, pour les nationaux, une flopée d’emplois secondaires mal rémunérés. Le système coopératif corrige, sur le plan international, les tares du capitalisme et ses corollaires : la compétition et l’impérialisme économique qui suscitent d’âpres rivalités entre les nations, suscitant souvent des guerres à l’exemple de la deuxième guerre mondiale. A l’heure de la mondialisation, le coopératisme reste la meilleure voie de réalisation d’un partenariat juste et équitable entre les forces sociales nationales, l’Etat et les investisseurs étrangers ou capitalistes internationaux dans une globalisation efficace des marchés de capitaux, de la production des biens et services et des revenus . C’est à bon droit que l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) a adopté la recommandation n° 193 relative à la promotion des coopératives et s’est jointe à l’Alliance Coopérative Internationale (A.C.I.) pour lancer une campagne mondiale de coopération contre la pauvreté. Cette action, qui est le résultat d’un partenariat continu entre les deux institutions, souligne le rôle que les coopératives peuvent jouer dans les programmes d’éradication de la pauvreté . Pour les croyants, les coopératives constituent le cadre socioéconomique dynamique leur permettant de mettre leurs talents, leur savoir-faire, leurs valeurs morales et leurs biens au service de la communauté renforçant ainsi la communion fraternelle . En se coalisant sans discrimination de classe, de tribu ou de nationalité dans la résolution de leurs problèmes socioéconomiques, les coopérateurs instituent un cadre de solidarité, d’entraide, d’amour et de justice où le Dieu Tout Puissant déverse ses bénédictions, lesquelles survivent à plusieurs générations . De toute façon, le choix du système coopératif s’impose dans le domaine de l’agriculture parce que la production agricole est, par essence, soumise au travail de groupe. Il est même impérieux en ce qui concerne l’Afrique où des traditions culturelles bien vivantes ne laissent pas l’agriculture échapper à la discipline des communautés villageoises . Néanmoins, il faudrait davantage harmoniser les valeurs coopératives avec les valeurs socioculturelles africaines comme nous l’indique le chapitre suivant. CHAPITRE VII : ADAPTATION DU SYSTEME COOPERATIF AUX VALEURS SOCIOCULTURELLES AFRICAINES L’Afrique est pauvre parce qu’elle a cessé d’être elle-même . Elle s’est détournée de sa culture en acceptant les idéologies, les théories, les formalisations et les stratégies conçues par des experts étrangers pour leurs propres intérêts et dans l’ignorance de l’âme africaine . En effet, cette assimilation des connaissances soi-disant scientifiques ou philosophiques, imposant une approche exotique du développement, est la cause de l’isolement du monde rural, de la crise du secteur agricole et de la misère des masses. Tirant un enseignement de cette malheureuse expérience néo-colonialiste, l’Afrique devrait remettre en question les apports culturels extérieurs. Désormais, tout système, toute idéologie, toute théorie doit passer au crible de la culture africaine avant son adoption. Encore faudrait-il revoir toute la démarche du pilotage des réformes afin de concilier les valeurs et techniques traditionnelles aux impératifs d’efficacité et d’accumulation économiques. Car il ne pourrait y avoir un système de production durable, susceptible de survivre aux crises, sans prise en compte des valeurs traditionnelles locales comme le montre l’exemple de la Corée, du Japon et d’autres pays asiatiques . Etant donné que les principaux acteurs sont des êtres humains, il est essentiel de prendre leur mode d’organisation sociale en compte si l’on veut dégager des solutions viables pour promouvoir le développement dans une vision consensuelle et interactive. De toute évidence, les facteurs sociaux conditionnent extrêmement l’efficacité des programmes et projets de développement. De ce point de vue, le système coopératif, bien que très proche du collectivisme millénaire africain, devrait être enrichi avec les techniques de gestion africaines pertinentes. Il y a lieu d’introduire dans le coopératisme moderne les valeurs humanistes que l’Afrique a tirées de l’expérience du communautarisme . C’est ce que Léopold Sédar Senghor appelle : « la contribution du Négro-africain à la civilisation de l’Universel. » D’une part, doivent être promues les valeurs ci-après : la solidarité, l’entraide, l’équité, la co-responsabilité, la participation populaire, la démocratie des palabres, la participation populaire, la propriété collective du sol, combinée avec la propriété individuelle partielle de la production, et d’autre part, il importe de développer les techniques telles que la formule des tontines dans l’incitation de l’épargne, le renforcement des liens contractuels grâce au rituel entourant la passation d’un acte juridique (prêt, contrat de travail, contrat de société…), la recherche du compromis dans le règlement de différend, la redynamisation des structures sociales hiérarchisées (groupes d’âge) et les corporations professionnelles en vue de l’amélioration de la productivité (recherche des stimulants autre que le profit capitaliste), la réorganisation du travail en mettant à contribution la réglementation très détaillée des tâches constitutives d’un métier par la tradition, les techniques agricoles préservant l’équilibre agro-sylvo-pastoral, la pharmacopée traditionnelle… A tout prendre, le coopératisme africain s’appuiera sur la concertation sociale propre à la culture africaine, en ce qu’elle valorise les hommes et leur savoir-faire et facilite le progrès technologique en vue du développement social et économique . Dans les meilleurs des cas, ce système pourra contribuer au développement global, intégré et endogène de l’Afrique ainsi qu’à l’avènement de « l’Homo Africanus » pétri des valeurs culturelles africaines et voué au service de la collectivité. Ainsi, l’Afrique recouvrera son identité et sa capacité de se développer par elle-même. Car, le premier changement devra porter tout d’abord sur la manière dont les Africains se voient eux-mêmes et se définissent par rapport au reste de la communauté internationale. « Les hommes sont ce qu’ils pensent » . Au demeurant, il est indéniable que les racines du coopératisme se trouvent dans l’Afrique traditionnelle. Cette thèse se paraît étayée par l’antériorité du collectivisme africain par rapport au socialisme européen et, surtout, par la survivance de ce système dans l’Afrique contemporaine malgré le choc colonial. Historiquement, l’Occident n’a jamais eu à expérimenter les valeurs coopératives avant la naissance récente des mouvements coopératif et socialiste en Europe. En effet, après la chute de l’empire romain en 395 après Jésus-Christ, s’ouvrit, pour ce continent, une période de près de mille ans de décadence socioéconomique et politique marquée par la décomposition de l’autorité publique et l’absence de tout système commercial et monétaire. L’économie médiévale européenne ne fut, en fait, qu’une économie fermée caractérisée par l’exploitation sordide des masses paysannes dans un régime de type féodal ignorant les vertus coopératives de solidarité et de self help. En fait, la société féodale ne fut qu’une société guerrière dominée par une couche de guerriers qui s’organisa, selon le principe de vassalité, en une hiérarchie de Seigneurs pourvus de fiefs et de chevaliers. La base économique de cette pyramide sociale fut composée des paysans dépendants et des artisans seigneuriaux, sur le travail desquels vécurent les guerriers. Ce système d’exploitation dura jusqu’à la première poussée capitaliste au XIIIe siècle. C’est à partir de cette date que l’esprit d’entreprise commença à attaquer lentement la structure des institutions féodales, qui, pendant des générations, avaient protégé, tout en les enchaînant, le paysan et l’artisan. Cependant, il a fallu attendre plus tard au début du XVIe siècle, la rupture définitive avec l’esprit général du Moyen Âge sous l’impulsion du mouvement de renaissance qui, par une étude savante de l’antiquité, promut l’humanisme et le progrès dans les domaines des lettres, des arts et de la science. Il n’y a donc pas l’ombre d’un doute que les précurseurs du socialisme et les pionniers du coopératisme se fussent inspirés du système communautaire millénaire africain. Par-delà ce processus d’adaptation du système coopératif, la réforme de l’Afrique devrait s’ouvrir à la vérité divine selon laquelle la charité est l’accomplissement plénier de la Loi (le Décalogue) que Dieu a donnée au monde dans le dessein de transformer en profondeur l’homme et son histoire, en le délivrant de l’esclavage radical du mal, du péché et de la mort . Depuis deux millénaires, en effet, les vertus que répand l’Esprit Saint, sans contrainte ni tyrannie, cultivent de plus en plus le respect de chaque être humain dans ses droits à la vie et à la dignité. Il est donc nécessaire que l’amour de Dieu et la liberté dans la vérité et la justice, révélés par Jésus-Christ, marquent de leur empreinte les relations entre les hommes et entre les peuples afin que les changements économiques et sociaux ne puissent pas engendrer d’autres servitudes et ruine pour l’humanité . Pour sa part, l’église, qui encadre en Afrique l’immense majorité de la population en laissant une minorité aux partis politiques, a la responsabilité d’enseigner aux fidèles comment débuter et tourner des affaires avec succès par des méthodes inspirés de principes bibliques notamment : « on récolte ce que l’on a semé ». Une telle campagne prédisposerait les Africains à produire ce qu’ils veulent consommer, en investissant dans ce qu’ils veulent gagner et en semant là où ils veulent récolter . C’est à cette condition que le mouvement coopératif pourra libérer les capacités créatrices de l’homme africain en vue de mettre la science, la technique, la culture, le travail et l’action politique au service de la relance économique de l’Afrique Subsaharienne . CHAPITRE VIII : ETUDE PROSPECTIVE DE LA CONTRIBUTION DU SYSTEME COOPERATIF A LA RELANCE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE Le coopératisme raisonnablement africanisé est à même de contribuer à la relance économique de l’Afrique subsaharienne. Son apport peut être capital aussi bien dans l’introversion des structures socioéconomiques et l’intégration du monde rural, que dans la mutation du secteur agricole, ou encore dans la création d’une classe d’entrepreneurs autochtones, la résorption du chômage, la participation populaire, l’apprentissage de la démocratie, la formation de la jeunesse ou enfin dans la moralisation de la vie économique dans cette région. 8.1. CONTRIBUTION A L’INTROVERSION DES STRUCTURES SOCIOECONOMIQUES ET A L’INTEGRATION DU SECTEUR RURAL Comme nous avons eu à le déplorer au troisième chapitre de cette étude, le système capitaliste extraverti que la colonisation a légué à l’Afrique contrarie son progrès économique. Ledit système s’oppose à toute politique de développement en ce qu’il n’offre pas des structures socioéconomiques dynamiques et viables impliquant la participation populaire. Bien au contraire, il tourne toute l’économie nationale vers les puissances étrangères en entretenant le dualisme, la marginalisation des communautés villageoises, la méconnaissance des valeurs socioculturelles africaines, l’insuffisance de la production des denrées alimentaires et, par-dessus tout, en sacrifiant les intérêts des nationaux au profit de ceux des capitalistes étrangers. Dans ces conditions, on ne peut pas autrement s’attendre à ce que les pays africains mettent à contribution les fabuleuses ressources naturelles et humaines dont ils regorgent en vue d’améliorer la qualité de la vie de leurs citoyens. D’autant que leurs économies fonctionnent dans la périphérie du système capitaliste international se limitant à fournir aux pays développés la production complémentaire et à résorber leur production marginale. Ainsi, tout est ainsi orienté vers l’extérieur au détriment du développement endogène qui aurait pu être réalisé sous les auspices des forces sociales autochtones. Au vrai, cette extraversion des structures socioéconomiques des pays économiquement faibles est la cause en même temps que la résultante de l’ordre économique mondial. En effet, le monde a été restructuré et se restructure sous la domination des firmes multinationales. Ces dernières organisent la dépendance du Tiers-monde par le truchement de la dépendance alimentaire, la subordination technologique et la mise en place d’un système d’alliance des classes (complicité des dirigeants du Tiers-monde) . Du fil en aiguille, tous les leviers de commande de l’économie mondiale sont désormais entre les mains d’une minorité constituée par les décideurs des pays hautement développés. Ceux-ci, de par leur position dominante, détermine à eux seuls la répartition des ressources mondiales en fonction d’une hiérarchie des besoins qui leur est propre . En effet, de nos jours, les progrès révolutionnaires de l’informatique a transformé le paysage économique mondial : l’avantage compétitif des pays s’est modifié, les entreprises éloignées sont reliées entre elles, les services financiers ont pris une dimension planétaire, les alliances stratégiques se sont créées entre les entreprises du monde entier, exacerbant les problèmes de développement et de croissance des pays les plus démunis . A cet égard, la mainmise des puissances étrangères sur l’économie de l’Afrique Subsaharienne contrarie son ascension. En conséquence, le développement de cette partie du continent africain ne pourra se réaliser que par l’abolition des structures extraverties et par la fondation des nations autrement démocratiques avec des institutions socioéconomiques autocentrées, quitte à organiser progressivement et opportunément l’ouverture économique . Monsieur Barber B. Conable, Ancien Président de la Banque Mondiale, ne disait-il pas dans un rapport sur l’Afrique Subsaharienne, qu’une restructuration fondamentale s’imposait si l’on voulait transformer les économies africaines en vue de les rendre compétitives dans un monde où la concurrence ne cesse de s’intensifier . Il faudrait donc, pour notre part, élargir et approfondir les réformes afin de juguler l’exploitation et le pillage de ce continent. Tant il est vrai que même la plus grande puissance économique actuelle, les Etats-Unis d’Amérique, a amorcé son développement en se libérant de la domination socioéconomique et politique anglaise. Le démarrage économique n’a été possible, dans ce cas comme dans d’autres, qu’après que les forces progressistes (entrepreneurs nationalistes) aient pris le contrôle du gouvernement et changé l’orientation de la politique économique. De même, l’Afrique ne doit plus entretenir le système de domination économique par l’adoption des programmes d’ajustement macroéconomique et structurel superficiels, mais elle devrait plutôt révolutionner les structures néo-colonialistes afin de créer une économie autocentrée . Cette transition historique vers une structure de développement implique la suppression de la marginalisation des communautés rurales (paysanneries) ainsi que leur réhabilitation et leur intégration avec l’actuel secteur capitaliste moderne dans un ensemble homogène. Au demeurant, tout programme de développement de l’économie africaine ne se fondant que sur le secteur moderne (villes) en négligeant les potentialités socioculturelles du secteur traditionnel (campagnes) est une gageur, au même titre que l’est toute stratégie se fondant, comme cela se fait couramment, sur les indicateurs économiques du secteur de production moderne en ignorant ceux des secteurs informel et traditionnel. La démarche idéale du développement serait celle qui cherche à tonifier la dynamique de la production des secteurs informel et rural de manière à inciter les communautés villageoises à opérer rapidement et profondément leur mutation, afin de ne plus demeurer une sous-structure fonctionnelle vitale de la société capitaliste extravertie . Conformément à la culture africaine, la démarche vers le développement ne peut être que communautaire. Cela revient à dire que seule l’action à la base incluant la participation populaire, pourrait permettre aux populations africaines de conjurer leur misère. C’est ici le lieu de préconiser le coopératisme comme moyen de réalisation de cette réforme des structures socioéconomiques pour le véritable développement. Ce système renversera tous les obstacles (structurel et mental) qui s’opposent à la croissance économique régulière des pays de l’Afrique Subsaharienne, en créant, pour cette région, un patrimoine de compétences, d’institutions et d’idées propres en matière de développement. Malgré la rareté des capitaux étrangers et nationaux, le mouvement coopératif est en mesure d’inciter les populations africaines à créer, à peu de frais, les unités de base pour le développement en satisfaisant d’abord leurs propres besoins . Ainsi, pour répondre aux besoins alimentaires, il sera créé des coopératives agricoles et celles de consommation, pour les besoins de financement, les coopératives de crédit, pour les besoins de logement, les coopératives d’habitation à loyer modéré, pour les besoins de production, les coopératives de production artisanale, pour les besoins d’assurance, les coopératives d’assurance, etc. A terme, les échanges et l’intégration économiques notamment entre les milieux urbain et rural se développeraient. Il y aurait élargissement du marché intérieur par le fait de la multiplication des échanges intersectoriels : surplus agricole contre surplus industriel, et des échanges intrasectoriels. C’est serait le premier pas vers l’instauration d’une économie coopérative autocentrée, intégrant parfaitement le secteur rural dans l’économie nationale et faisant des communautés villageoises des pôles de progrès économique. De même, l’action coopérative amènerait les populations africaines à tenir en laisse la gestion de leur économie . En constituant, dans les principaux secteurs de l’économie, des sociétés coopératives par leurs propres efforts et pour servir leurs propres intérêts, les Africains contrôleraient les activités économiques et les ressources naturelles de leurs pays. Ils acquerraient la confiance en eux-mêmes, l’autonomie, le courage et l’esprit de solidarité nécessaires pour mener les réformes des structures économiques néo-colonialistes. Sur le plan financier, l’organisation des populations en coopératives favoriserait la mobilisation de l’épargne nationale, surtout en milieu rural, afin de réduire la dépendance à l’égard des capitaux étrangers dans le stade de relance, ou en réalité, celui de « redémarrage économique ». A mesure que le mouvement coopératif prendra de l’ampleur, les communautés villageoises sortiraient de leur enclavement pour participer à la production et réclamer leur part du revenu national en vue de mettre fin à la distribution asymétrique des revenus entre les zones urbaines et rurales, entre citadins et ruraux, entre expatriés et nationaux, de même que dans chacun de ces groupes sociaux . Ainsi, la tendance à exporter les capitaux par les gouvernants et les hommes d’affaires (nationaux et expatriés) sera renversée, tant les structures coopératives créeront les réflexes et l’esprit « communautariste » susceptibles de retenir les capitaux nationaux et même de drainer, à des conditions avantageuses pour le pays, les capitaux étrangers . Par ailleurs, l’action coopérative canaliserait les ressources nationales (main-d’œuvre, terres, capitaux) vers les secteurs vitaux, ceux dont la production satisferait directement les besoins essentiels de la population. Elle permettrait, par ce faire, de corriger l’allocation des ressources entre les secteurs productifs et le secteur tertiaire au profit des premiers, et de rééquilibrer la répartition des terres fertiles entre les sociétés étrangères, l’oligarchie dominante et les paysans en faveur de ces derniers. Cette mutation des structures économiques privilégierait l’autosuffisance dans les domaines de l’alimentation, de logement, de la santé, du crédit, de l’éducation…, en opérant la mobilisation de l’épargne et son affectation aux secteurs prioritaires et les plus productifs, et à l’expansion des marchés financiers. Ainsi, des fabuleuses ressources africaines jusqu’ici laissées en jachère en attendant que les puissances occidentales éprouvent le besoin de les exploiter, pourraient, grâce à l’action coopérative, être mises à contribution à l’effet de susciter le développement socioéconomique interne et, ipso facto, améliorer la qualité de la vie des Africains. A ce titre, le système coopératif lèvera les contraintes structurelles et financières et, par contrecoup, apportera la solution à la problématique de la corrélation entre l’explosion démographique, la faiblesse de la productivité agricole et la dégradation de l’environnement. Participant à la conception et à la réalisation des projets, les coopérateurs auraient l’occasion d’imposer des techniques qui protègeront leur environnement. Sur le plan socioculturel, les populations auront toute licence de créer des coopératives pour gérer les instituts de formation et d’encadrement de la jeunesse (écoles, centres professionnels, institutions de vulgarisation agricole et sanitaire, instituts de prospective et de promotion des projets coopératifs, colonies de vacance, centres culturels, bibliothèques, troupes théâtrales, orchestres, clubs sportifs, écoles de football…). Toutes ces réformes sont du domaine du possible quand on sait que dans toute l’Afrique, une grande partie du secteur moderne est en difficulté depuis près de deux décennies, pendant que le secteur non structuré a fait preuve d’un remarquable dynamisme dans une large gamme d’activités dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, le transport, la finance, les services sociaux, et même les échanges et l’intégration au niveau régional . Il est donc évident que ce dynamisme est la résultante d’une action de restauration des valeurs socioculturelles traditionnelles notamment la solidarité et l’entraide. Sur cette base, les populations africaines pourront bâtir une économie coopérative prospère en édifiant une large chaîne de solidarité et en prenant en charge, malgré la modicité de ressources, la production de biens et services destinés à répondre à leurs besoins existentiels. De ce qui précède, il appert que l’institution des coopératives dans la plupart des secteurs socioéconomiques permettrait de décentraliser les pouvoirs économiques en des petites entités de développement qui formeraient, au niveau macroéconomique, une agglomération économique viable et prospère fonctionnant pour la satisfaction des besoins prioritaires des populations. En fait, le mouvement coopératif, grâce à ses méthodes évolutionnistes et pacifistes, contribuerait à ériger un système nouveau parallèlement au système capitaliste existant qui, sous son influence, sera contraint de s’amender et de mettre fin à l’extraversion de ses structures. En perspective, ce serait l’avènement d’une économie coopérative florissante qui coexisterait avec des poches du système capitaliste à l’intérieur d’une économie autocentrée. Le point d’orgue de ce processus serait l’édification d’une République coopérative . En définitive, les réformes économiques réalisées sous la bannière du mouvement coopératif aboutiront à l’introversion des structures socioéconomiques et à l’extirpation du système économique de domination. Ainsi libérés des réflexes, de l’esprit, des structures et des forces qui entretiennent le système extraverti ; libérés de la dépendance alimentaire et de la vulnérabilité à l’égard de leurs recettes d’exportation, les pays de l’Afrique Subsaharienne pourront maîtriser leur commerce extérieur et rééquilibrer à leur profit les termes de l’échange. Ils auront les mains libres pour jouer sur tout tableau où ils trouvent leurs intérêts pour vendre leurs matières premières à qui ils veulent, au plus offrant, sans rendre compte ni trahir quelque appartenance que ce soit . Contre-indiquant un nationalisme suicidaire, le système coopératif pourrait favoriser la création et le développement de l’appareil de production ainsi que le marché intérieur africain en vue d’améliorer la compétitivité de l’Afrique sur les marchés internationaux. D’autant plus que, dans un proche avenir, ce continent perdra ses débouchés traditionnels du fait de la levée des conditions préférentielles d’accès aux marchés des pays industrialisés (convention de LOME) en application des recommandations de l’OMC. 8.2. EXHORTATION A LA PARTICIPATION POPULAIRE Dans le cinquième chapitre de notre étude, nous avons entre autres mis en exergue la notion du développement endogène, lequel constitue une véritable aventure qui engage toute la nation, faisant appel à toutes ses ressources humaines, naturelles, financières, scientifiques et culturelles. Cela implique la participation de toute la population à la vie politique, sociale et économique du pays . Dans la plupart des pays africains, il y a d’immenses ressources en terres cultivables et en minerais divers, de formidables forces de travail qui ne demandent qu’à être libérées et mises au service du développement du continent . Mais seulement, il faudrait, pour ce faire, réhabiliter toutes les structures de participation qui existent dans la tradition africaine. L’étude que nous avons menée sur la société africaine précoloniale a révélé une prodigieuse tradition de vie communautaire fondée sur les valeurs de solidarité, d’entraide et sur la participation communautaire. C’est précisément cette participation de tous les membres aux activités vitales de la communauté qui assurait l’épanouissement individuel. De toute évidence, l’esprit de solidarité et de travail coopératif pour la survie du groupe ne pouvait qu’être particulièrement vivace dans les communautés des gens qui partageaient les mêmes us et coutumes, ayant par ailleurs sinon des liens de parenté lointains, du moins la même culture . L’individu appartenait à sa communauté et vivait par elle. Chacun avait un rôle socioéconomique à jouer dans le cadre de la mise en commun des forces de production. Aucune place n’était réservée au mercantilisme du type occidental et à l’intérêt personnel . Ces acquis suggèrent à l’Afrique un développement tout à fait communautaire garantissant la participation populaire . Cependant, il est déplorable de constater que toutes les structures de participation communautaire aient été battues en brèche par la colonisation et, plus ultérieurement par les régimes dictatoriaux. A tel point qu’il y a aujourd’hui une scission formelle entre le pouvoir et peuple. Celui-ci n’a plus rien à dire à propos des décisions, des mesures et des projets que le pouvoir élabore concernant la vie de la nation, comme s’il était incapable de savoir et apprécier ce qui est bon ou mauvais pour lui . Un petit groupe de citoyens s’est dès lors érigé en souverain maître, décide et exécute pour la nation, sans consulter celle-ci à l’antipode de ce qui se faisait autrefois dans les empires africains, et comme cela se fait encore de nos jours dans les communautés familiales ou villageoises. Cette nouvelle classe hégémonique issue de la colonisation ambitionne le contrôle exclusif de l’action de développement en ignorant la réalité vivante des groupes sociaux de base. Ainsi bannies de la vie politique et privées des libertés fondamentales, les masses, particulièrement les paysans, témoignent sinon leur indifférence, du moins, leur réticence à l’égard du développement économique de l’Etat . Il s’ensuit malheureusement l’éclosion d’un individualisme anarchiste qui paralyse tout le continent. Cela s’exprime, sur le plan financier, par la résistance des populations à contribuer aux charges budgétaires d’un Etat dont le commun des mortels ne peut ni bénéficier de la sollicitude, ni contrôler la gestion. Du reste, les masses vivant en dessous du seuil de pauvreté ne peuvent s’assumer en tant que citoyens, ni patriotes. Exclues de la sphère du profit généré par le système capitaliste extraverti, elles se sont lancées à une lutte des classes suicidaire culminant dans des actes de vandalisme et de pillage, n’améliorant en rien les rapports de production de type néo-colonialiste. A tous les niveaux, il y a absence de cadre de participation des peuples aux débats sociopolitique et économique alors que l’Africain avait autrefois sa place, chacun selon ses aptitudes, sous l’arbre à palabres ancestral . Dans la tradition africaine, ou plutôt dans l’esprit africain, l’exercice des droits civiques et politiques ainsi que la participation à la vie économique sont intimement liés. Les deux procèdent inséparablement du sentiment profond qu’on a d’appartenir et d’être utile à sa nation . C’est à juste titre que l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Monsieur Boutros Boutros Ghali a-t-il cité, lors de son message annuel aux Nations en 1992, la participation populaire parmi les droits de l’homme que l’ONU doit protéger. Car, il semble de plus en plus clair que la réussite du programme d’investissements publics dépend du degré de partenariat entre l’Etat et les populations bénéficiaires potentiels dudit programme. Que ce soit dans l’étape de conception, de réalisation que de gestion des biens et services collectifs, la participation locale optimise l’efficacité et la rentabilité économique. A la vérité, on ne peut bâtir une nation prospère lorsque le peuple démissionne face à ses obligations relatives à sa contribution dans la production, dans la défense des libertés, de justice et de la bonne gouvernance… Certes, dans une économie moderne, il est difficile d’atteindre les populations les plus reculées pour les engager dans le processus de développement. Tout planificateur est tenté de privilégier les grandes entreprises et les secteurs concentrés. Néanmoins, il ne peut y avoir un système de production stable susceptible de survivre aux crises sans la participation populaire, notamment l’apport des populations organisées en petites et moyennes entreprises. Cela est si vrai que les PME occupent une place qui n’est pas des moindres dans les économies puissantes occidentales. Aux Etats-Unis d’Amérique, les « Small business », encouragés par le gouvernement fédéral, ont joué un rôle moteur dans les périodes de croissance (1968-1977 et 1983-1985) en créant davantage d’emplois que les grandes entreprises et en assurant la mobilité des activités vers les secteurs nouveaux et, en sens inverse, un rôle modérateur en période de récession en assumant le coût d’une relative stabilité du tissu industriel (création d’emplois tandis que les grandes entreprises en supprimaient pendant la période de dépression de 1981-1982) . De cette analyse, nous pouvons arguer que le problème de développement de l’Afrique Subsaharienne ne peut être résolu sans la participation de toute sa population notamment les ruraux. Cette question se pose en termes de restructuration du secteur moderne cantonné principalement dans les villes, et de redynamisation des communautés villageoises. En corollaire, les pouvoirs publics devraient s’engager à réaliser des actions concrètes visant à : - rétablir les libertés fondamentales et le respect des droits de l’homme ; - favoriser l’éclosion des dynamismes locaux et l’expression des besoins réellement ressentis par la population ; - aider les masses rurales à clarifier leurs idées sur le développement ; - concourir à l’auto-organisation et à la restructuration du milieu rural en vue d’une grande productivité. En ce qui concerne particulièrement la situation de la République Démocratique du Congo, il importe de lever les entraves juridiques érigées par les colons pour tenir en laisse les associations d’autochtones pendant la colonisation au travers de lois liberticides d’ordre public et de carcans dans la procédure de création et de gestion des associations, des coopératives, des mutuelles et regroupements. Pour notre part, la participation populaire ne peut être mieux assurée que par le coopératisme parce que ce système est fondé avant tout sur l’élément humain. La préoccupation principale d’une coopérative étant d’organiser les hommes en vue de leur permettre de jouer le rôle moteur de l’économie et de leur offrir les biens et services dont ils ont besoin. En fait, une entreprise coopérative, on ne le dira jamais assez, ne tire pas ses forces des capitaux accumulés, mais plutôt de ses membres, de leur dynamisme et de leur esprit coopératif. Elle s’appuie sur la puissance qu’acquièrent les gens grâce à leur nombre et à la valeur qu’ils possèdent en tant qu’êtres humains. En conséquence, elle suscite le respect et la conscience de soi-même parmi les populations surtout auprès des couches sociales défavorisées. A cet égard, la société coopérative constitue pour les gens ordinaires, et en particulier les femmes et les jeunes, le cadre idéal pour exercer plus d’initiative en vue d’améliorer leur existence. De cette manière, l’Afrique pourra libérer et mettre au service du développement, les formidables forces de travail dont sa jeunesse regorge. Pour ce faire, il importe de concevoir, dans une perspective coopératiste, une politique éducative et une stratégie de formation professionnelle cohérentes aux fins de créer dans toutes les circonscriptions, dans les villes comme dans les villages, des centres d’alphabétisation et d’apprentissage professionnel, des écoles coopérativement organisées où l’instruction générale, l’agriculture, la technologie, la gestion, l’artisanat, l’hygiène et la morale seront enseignés aux enfants du peuple pour leur permettre de s’autosuffire . Loin d’être une démarche platonique, la participation populaire dans une économie coopérative est assurée par la règle de la « porte ouverte » et celle de gestion et direction démocratiques. L’adhésion tout autant que le retrait, est libre et ne peut être refusée à un postulant. Au même titre que se fait l’adhésion, le coopérateur s’engage librement à participer à la vie de la coopérative en y apportant soit son travail, soit ses produits ou encore en utilisant ses services. Au demeurant, il est enclin à s’associer aux autres, de fondre ses intérêts et ses aspirations dans ceux des autres parce qu’il lui est loisible de diriger ou de contrôler sa coopérative et d’obtenir des autres coopérateurs l’assistance en cas de besoin, conformément à la devise coopérative : « un pour tous, tous pour un ». Ainsi, le mouvement coopératif, lorsqu’il prend de l’envergure, peut, en dehors de toute discrimination politique, religieuse, tribale, ethnique ou autre et dans le respect de la propriété privée, développer parmi les populations l’esprit de self-help et d’entraide en vue de bâtir une nation dans la justice sociale et l’égalité politique. C’est que l’action coopérative est autrement capable de mobiliser pour la construction nationale à la fois les citadins, les paysans, les salariés, les indépendants, les artisans, les riches, les pauvres, les nationaux, les étrangers, etc. Tous peuvent par le biais des institutions coopératives, participer indistinctement à la conception et à la réalisation des projets de développement de leurs contrées et tirer équitablement la part de revenu qui leur revient en fonction de leurs efforts de production. La participation populaire, selon la doctrine coopérative, vise, au bout du compte, le développement national, c’est-à-dire le progrès socioéconomique de tout un peuple. Mais au lieu de rechercher ce progrès de façon centralisée et bureaucratique, le coopératisme incite à la participation populaire au niveau des communautés de base, par la création des sociétés coopératives dans tous les domaines de la vie des villages, des églises, des quartiers urbains, des provinces… Dans le contexte africain, cela signifie la prise de responsabilités par la population, même dans le cas où le leadership national et les bailleurs de fonds ne soutiendraient pas une telle action. A l’instar des fourmis qui n’ont ni chef, ni inspecteur, ni maître pour amasser une abondante moisson, les hommes de bonne volonté se ligueront dans les coopératives en vue de juguler leur vulnérabilité économique et sociale . C’est effectivement au sein des structures coopératives que se développeront les valeurs telles que la solidarité et l’entraide respectivement aux niveaux local, provincial et national . En effet, le processus de participation populaire par l’action coopérative part du regroupement à l’échelle locale pour la résolution des problèmes concrets et quotidiens des villages ou des quartiers urbains et la satisfaction des besoins vitaux locaux de manière empirique et solidaire . Ce regroupement coopératif en appelle un autre, à savoir, l’instauration des unions coopératives au niveau du district et de la province, dans le cadre d’une solidarité intertribale, poursuivant la satisfaction des besoins essentiels sous-régionaux et provinciaux. Enfin, le processus atteint son paroxysme, c’est-à-dire la réalisation d’un développement global par le regroupement au niveau national, en l’espèce, l’institution des fédérations coopératives. Ces dernières répondent aux priorités nationales dans le cadre d’une solidarité interethnique . Cette évolution permettrait aux africains de conclure un nouveau pacte social aux niveaux local, provincial, national et continental afin de redistribuer équitablement les richesses du continent. A tous égards, les vertus coopératives engendreraient d’une manière positive la solidarité nationale et consolideraient l’unité nationale tout en générant, pour tout un chacun, des ressources suffisantes pour jouer son rôle de citoyen. Comme nous venons de le démontrer, l’action coopérative implique inévitablement la libre participation des populations dans un esprit grégaire qui s’élargit à la nation et crée la cohésion sociale en vue de la relance économique. Cela amortit, qui mieux est, les effets de déséquilibres qui peuvent accompagner cette étape de développement. En effet, le mouvement coopératif amène ses membres à restaurer les entités de base et à accélérer l’intégration culturelle, économique et politique des familles, clans, tribus et ethnies dans un système national efficace et prospère. De la même manière que le communautarisme traditionnel a permis pendant l’époque précoloniale l’édification des puissants empires en Afrique, le coopératisme est à même de susciter, au niveau de chaque nation, un renouveau technique indispensable pour une plus grande maîtrise des problèmes socioéconomiques . C’est donc que le système coopératif peut mettre en avant une campagne purificatoire, en vue de juguler la perversion actuelle des valeurs traditionnelles qui, malencontreusement, incitent à l’inertie et au nivellement des Africains par le bas. Jadis, noyau du système de production précoloniale, la famille africaine est aujourd’hui un centre d’inefficacité où la prodigalité, la gabegie se le disputent avec l’indolence, le parasitisme, le mépris de la propriété privée, l’insouciance et la criminalité. Sur le plan politique, elle engendre la Kleptocratie et la dépravation des mœurs qui hypothèquent l’essor économique du continent. Face à ce dysfonctionnement critique de la famille, du clan et de l’Etat, le coopératisme suggère la réhabilitation du cadre de participation individuelle à la production collective en venant à la rescousse des structures traditionnelles en désuétude afin de renforcer réellement la cohésion de la société africaine, à partir des cellules familiales jusqu’au niveau de la nation et du continent, redonnant ainsi vigueur à l’idéal panafricain . En dernière analyse, la coopération offre la possibilité de promouvoir les valeurs culturelles africaines dans la conception et la réalisation des stratégies de développement. Loin de les écraser, son action rétablit les pouvoirs traditionnels (les assemblées locales) par le truchement desquels elle s’assure la participation des membres des communautés de base (villageoises ou urbaines). Au même titre qu’elle crée les structures viables susceptibles de drainer les compétences dans les milieux ruraux, elle contribue à l’éclosion d’une nouvelle classe d’entrepreneurs autochtones. 8.3. CONTRIBUTION A LA CREATION D’UNE NOUVELLE CLASSE D’ENTREPRENEURS Dans le troisième chapitre de notre étude, nous avons relevé que pendant environ cinq cents ans, l’Africain ainsi que sa société furent violentés par les diverses dominations et servitudes du fait de la traite et subséquemment du système capitaliste colonial. Fonctionnant pour les besoins des métropoles occidentales et méconnaissant les valeurs socioculturelles africaines, ce système ne concorda pas avec la structure unioniste africaine. Il en résulta une coexistence de deux civilisations diamétralement opposées, l’une africaine, l’autre européenne évoluant chacune dans sa sphère. A défaut d’une structure d’accueil pour le capitalisme et faute de trouver un terrain commun entre l’individualisme et le collectivisme, les colons furent réduits à utiliser les moyens les plus brutaux et coercitifs pour exploiter à leur seul profit les vastes territoires conquis. Ainsi, la conquête coloniale aboutit à l’institutionnalisation d’une triple structure culturelle, socioéconomique et politique supprimant toute initiative pour les Africains. Cette oppression coloniale arrêta l’évolution du dynamisme interne et porta ombrage au génie africain, entraînant la marginalisation des communautés villageoises autochtones. Rendus impuissants, neutralisés, les peuples africains ne devinrent qu’un instrument forcé d’un capitalisme parasitaire, orienté vers les intérêts économiques et stratégies des pays développés. De toute évidence, les couches dirigeantes africaines du XVIe siècle, dépourvues de capitaux, ne purent se muer, à l’avènement du capitalisme dans ce continent, en banquiers, financiers, industriels à l’instar des barons, vicomtes, marquis européens ou des grands seigneurs japonais, Daimyos. Même les indépendances politiques n’ont pas pu rendre à l’Afrique son initiative historique afin de permettre aux Africains de redevenir maîtres de leur destin économique et social. En effet, le système postcolonial s’est accommodé de structures de domination et d’exploitation, si bien que, de nos jours, l’Afrique obéit encore aux impulsions économique et politique des anciennes métropoles. Il lui manque toujours des hommes d’affaires entreprenants capables de présider à leurs destinées socioéconomiques. Néanmoins, il y a eu, aux approches des indépendances, des petits commerçants autochtones qui, du fil en aiguille, se sont appliqués à intégrer les valeurs capitalistes (passion acquisitive, calcul économique et conscience mercantile) dans la culture africaine. Faisant les affaires dans leur communauté, mettant à son service les richesses accumulées, contribuant largement à la consolidation des valeurs d’entraide et de solidarité, vivant à la cité indigène avec tous leurs frères, ces entrepreneurs ont réussi, le tour de force, d’acquérir individuellement une puissance économique sans être frappé d’ostracisme, ni subjuguer, de leur part, les autres membres de la communauté. Mais cette expérience de brassage culturel a avorté avec l’avènement d’un affairisme conquérant, mené par un groupe d’hommes d’affaires sans vocation, combinant la politique, l’administration publique et le commerce. Il s’agit des politiciens affairistes ou hauts fonctionnaires marchands de soupe et de leurs alliés nationaux ou étrangers. Cette classe de commerçants sui generis joue un rôle négatif sur le développement socioéconomique de l’Afrique en ce qu’ils stérilisent tous les revenus qu’ils sont les seuls à tirer des marchés publics, des crédits bancaires, des subventions et autres protections de l’Etat. Pour réaliser un développement endogène, il ne faut surtout pas compter sur cette classe d’entrepreneurs impuissants dont les caractéristiques « naturelles » prédisposent à l’incivisme fiscal, aux prélèvements et non aux initiatives, et ne pouvant s’épanouir que dans les secteurs protégés où il leur est possible de faire supporter à l’Etat tous les risques de pertes ou de déficits et les coûts sociaux dérivés de leurs activités privées. Comme en Angleterre, au XVIIIe siècle, où Ricardo stigmatisa l’inutilité de la classe des rentiers propriétaires terriens dans le développement de l’économie et dénonça son action inhibitrice de l’expansion de l’industrie capitaliste naissante, aujourd’hui en Afrique, il y a lieu de relever l’incapacité de la classe d’entrepreneurs « impuissants » à induire le progrès social. Vivant principalement de revenus occultes ou aléatoires (Windfall profit), son comportement irrationnel de consommation détruit les richesses nationales créées, réduit l’épargne et exacerbe l’extraversion de structures socioéconomiques. L’Afrique devrait plutôt s’appuyer sur sa population tout entière qui, malgré les paralysies structurelles qui frappent le système néo-colonialiste dans lequel elle évolue, développe un dynamisme étonnant en dehors du secteur structuré moderne. Au fait, la vitalité des micro-entreprises du secteur informel en Afrique pourtant privées de toute aide de l’Etat prouve, s’il en était besoin, la nécessité d’organiser, en vue du développement socioéconomique intérieur, les énergies locales, jusqu’ici dispersées et annihilées. En effet, le développement endogène passe positivement par cette organisation des populations laissées pour compte ou, à tout le moins, l’encadrement du dynamisme local longtemps étouffé par le système capitaliste extraverti. En tant que processus d’introversion des structures politiques et socioéconomiques, la démarche coopérative a l’avantage de drainer les compétences qui existent à foison dans le secteur structuré moderne (en chômage ou en activité) vers le secteur informel en vue de développer les talents des populations démunies (surtout ruraux), d’améliorer leurs techniques et connaissances traditionnelles afin de leur permettre d’accéder à l’autonomie économique et d’entrer, en tant qu’entrepreneurs et agents de développement, dans un système socioéconomique nouveau, autrement introverti. C’est bien le lieu de préciser que la structuration du secteur informel en vue du développement n’est possible que si elle suit la pente culturelle africaine, en renforçant les liens sociaux et en préservant la cohésion sociale. Car le développement doit prendre en compte le mode d’organisation sociale de ceux qui l’entreprennent . Comme nous l’avions dit précédemment, la culture africaine est profondément unioniste, elle s’oppose aux valeurs occidentales de sécurité matérielle, d’intérêt personnel et de recherche du profit. Les ressorts psychologiques qui sous-tendent les décisions économiques des Africains ne sont pas tout à fait conformes à l’idéologie libérale. Si bien qu’aujourd’hui encore la barrière culturelle fait que le capitalisme n’ait pas une structure d’accueil susceptible de susciter l’éclosion des vrais entrepreneurs autochtones. Ce n’est donc pas en libéralisant le système socioéconomique à coups de décret que les Africains, après plus de quatre siècles de manque d’initiative économique, deviendront, comme par enchantement, des capitalistes entreprenants. C’est plutôt en érigeant un système autocentré et réellement communautaire que les Africains pourront véritablement sortir de leur inertie quadriséculaire, rassembler les énergies et devenir des entrepreneurs dynamiques. Il faudrait pour l’Afrique Subsaharienne, un système largement fondé sur ses valeurs de solidarité et d’entraide pour secouer l’apathie de l’Africain face au profit et au progrès technique. Ce système devrait permettre à celui-ci d’entreprendre et d’accumuler ses richesses dans le cadre de sa communauté, car, comme nous l’avions dit plus haut, toute réussite économique en dehors du groupe peut conduire, en Afrique, à l’ostracisme et à la dislocation de la communauté . Pour notre part, le système coopératif facilite la réalisation des mutations nécessaires tout en préservant la cohésion des communautés de base africaines. En s’inspirant du communautarisme traditionnel qui garantissait jadis le droit de chaque individu à participer à la vie économique, culturelle et politique du groupe, à avoir une opinion, à s’exprimer, à apprendre, et à entreprendre, le coopératisme réveillerait l’esprit d’entreprise dans le chef de l’Africain longtemps inhibé par la politique coloniale et les dictatures postcoloniales . Evoluant dans un monde coopératif, l’homme africain reprendrait l’initiative sociale, économique et politique en vue de son émancipation. Sur le plan strictement économique, il développerait une culture de calcul et une rationalité dans toutes ses activités en tenant constamment compte de ses besoins réels, de prix des biens et facteurs sur le marché et de la possibilité de les produire soi-même, ou en groupe, à des meilleurs rapports qualité-prix. Par ailleurs, l’instauration du système coopératif accélèrerait la structuration et la fiscalisation du secteur informel par la réorganisation dans les sociétés coopératives des populations travaillant auparavant dans les micro-entreprises ou dans l’artisanat. Il est, sans contredit, le meilleur système applicable au secteur agricole à raison du caractère essentiellement collectif de la production agricole, surtout en Afrique où des traditions culturelles bien vivantes soumettent cette production à la discipline des communautés villageoises. En se regroupant dans les coopératives, les membres des communautés de base acquerront le statut d’associés et donc des propriétaires, avec un rôle social nouveau, celui d’entrepreneurs en ce qu’ils bâtiront des entreprises conçues par eux-mêmes, gérées par eux-mêmes et pour leurs besoins, dans un esprit de self-help et d’entraide. Engagés ainsi dans l’action coopérative, les paysans et les prolétaires urbains, victimes de l’exploitation sordide du système capitaliste extraverti, pourront changer, par leurs propres efforts, leur condition sociale en développant leurs compétences par l’apprentissage et l’esprit de corps. En tant qu’entrepreneurs, ils pourront, en perspective, mettre à contribution d’immenses ressources naturelles existant en Afrique au service de l’amélioration de leur bien-être. De même, le mouvement coopératif permettrait de mobiliser davantage les jeunes et les femmes dans l’entreprise du développement en leur donnant le pouvoir d’exercer plus d’initiative dans la marche de leur communauté. Ainsi, les jeunes diplômés en chômage, les artisans et les femmes pourront-ils monter au créneau des affaires dans un esprit coopératif. Assurément, les populations africaines ne pourront mieux s’exprimer que dans ce havre coopératif, une sorte de zone franche, où elles apprendront des nouveaux métiers et mèneront leurs affaires sans prêter le flanc aux exactions des régimes qui, dans la plupart des cas, élaborent une fiscalité prohibitive aux dépens de petits entrepreneurs nationaux ne bénéficiant pas de la protection politique. En devenant entrepreneurs coopératifs, les Africains auront l’opportunité de reprendre l’initiative du développement de leur économie, se refusant à demeurer dans l’expectative de capitaux ou d’aides que d’hypothétiques Investisseurs ou gouvernements étrangers ont toujours promis de leur apporter ; en même temps qu’ils se départiront du mythe du travail salarié fourni par le secteur capitaliste moderne afin de se consacrer à leurs entreprises propres, oeuvrant pour l’amélioration de leur revenu . L’éclosion de cette classe d’entrepreneurs d’un type nouveau est d’autant plus réalisable que les sociétés coopératives n’exigent pas d’importants capitaux à leur constitution, étant donné la primauté que le système coopératif accorde à l’homme sur les capitaux. En fait, une société coopérative est une organisation d’hommes en vue de répondre, en priorité, à leurs besoins et non une accumulation de biens matériels pour la recherche d’une réussite financière purement spéculative. Elle s’occupe d’abord et avant tout de ses membres afin de les rendre utiles et de construire la solidarité entre eux. L’efficacité du système réside dans l’étonnante souplesse de sa gestion qui fait que même les paysans illettrés qui n’ont jamais vu l’école peuvent s’occuper de leurs propres affaires et améliorer leurs conditions de vie par leurs propres moyens . Selon toute apparence, le mouvement coopératif, lorsqu’il est mené dans le respect des principes et de l’esprit coopératifs, peut s’étendre à tous les secteurs et déployer, en corollaire, des nouveaux hommes d’affaires dans les secteurs tels que l’agriculture, le transport et communication, les mines, le logement, les assurances, la production artistique et sportive, … Ainsi, les Africains pourront prendre le contrôle des secteurs les plus rentables de leur économie lesquels sont, jusqu’ici le monopole des expatriés. C’est certainement cette classe de coopérateurs qui s’engagera, d’une part, dans la mobilisation de l’épargne à grande échelle afin de moderniser le continent africain sans pervertir ses valeurs culturelles, et d’autre part, dans l’adaptation et l’application de la technologie moderne notamment l’introduction rationnelle des techniques informatiques et de télécommunications dans l’ensemble de la chaîne de production : gestion, recherche, conception, fabrication, marketing et distribution. Ainsi, elle contribuera au développement du commerce intérieur et extérieur, à l’intégration économique, et à l’élargissement des marchés intérieurs pour améliorer les revenus et les possibilités d’emploi pour les populations défavorisées surtout dans les zones rurales. A la différence et de l’esprit et des objectifs capitalistes, la mobilisation des citoyens dans le mouvement coopératif relèverait le niveau de l’emploi dans le continent tout entier. Comme chaque citoyen peut adhérer librement à une société coopérative pour satisfaire ses besoins prioritaires moyennant un apport modique, le nombre de coopérateurs ira croissant, tant et si bien qu’à terme, les structures coopératives seront à même de résorber la lourde réserve de chômeurs tant en villes que dans les campagnes. Particulièrement, l’essor des coopératives pourra, répétons-nous, renforcer l’intégration entre les milieux urbain et rural et mettre fin à la marginalisation des communautés villageoises. Aussi, les compétences non utilisées en villes trouveront-elles des structures d’accueil à la campagne. Par ailleurs, la masse des ruraux qui émigrent vers les villes pour y gonfler l’effectif des chômeurs s’effritera. Cela induira l’équilibre entre l’offre et la demande du travail à un niveau de salaire autrement élevé. Sur la même lancée, l’édification d’une économie coopérative normale offrira pareillement les opportunités d’accroissement des revenus susceptibles de retenir les Africains dans leur continent et d’y ramener la diaspora en mal d’intégration en Occident. Sur ces entrefaites, les ménages, loin de se contenter de leur rôle de consommateurs, exerceraient dans les sociétés coopératives, en tant qu’entrepreneurs, des activités rémunératrices répondant directement à leurs propres besoins existentiels, et ce, au prix coûtant. Ainsi, le système coopératif s’attaquerait à la crise économique actuelle à la fois sur le front du chômage et de celui de l’inflation. De même qu’il contribuerait au recul de la pauvreté en favorisant un mode de croissance économique plus diversifié, faisant appel à la main-d’œuvre de manière intensive tout en valorisant le monde rural auquel appartient la grande majorité de la population. C’est de cette manière que l’Afrique subsaharienne relèvera le défi de la mondialisation, c’est-à-dire l’internationalisation grandissante des marchés des biens, des services et des capitaux. En effet, l’importance et la diversité des secteurs d’activité sous contrôle de la nouvelle classe d’entrepreneurs nationaux faciliteraient leur affiliation aux sociétés multinationales dans le cadre d’un partenariat mutuellement avantageux . Ainsi, les pays subsahariens pourront bénéficier d’un afflux des capitaux privés, accéder aux technologies avancées, élargir leurs débouchés extérieurs et diversifier leurs exportations. En fait, la participation des investisseurs locaux éviterait que le processus de libéralisation du commerce extérieur et des marchés des capitaux se mue en une remise sous tutelle coloniale. De la même manière, la montée au créneau des coopérateurs mettrait fin à l’activisme des commissionnaires étrangers et à leur alliance avec les politiques et les entreprises transnationales pour l’exploitation économique du continent et, ipso facto, arrêterait l’invasion des investisseurs resquilleurs, n’ayant aucune envergure internationale, qui arrachent des contrats faramineux à l’issue de processus maffieux. En assurant la promotion des managers africains, le coopératisme ouvrirait la voie à la vraie indépendance économique et politique contrairement à la démarche xénophobe et autarcique des « progressistes ». A l’heure de la globalisation économique, la révolution nationaliste devrait poursuivre, d’une part, l’entrée des Etats africains dans le cercle des grandes puissances industrielles du monde, et d’autre part, l’émancipation des hommes d’affaires africains en vue d’opérer de plain-pied avec les capitalistes étrangers dans les coentreprises transnationales. Cependant, l’avènement de cette nouvelle classe d’entrepreneurs reste tout aussi tributaire des efforts que les gouvernements africains déploieront en matière d’assouplissement de la réglementation sur les PME et de la loi-cadre relative aux coopératives . De manière pratique, le gouvernement de tout pays africain peut, en partenariat avec l’A.C.I., les institutions financières internationales, les fédérations coopératives nationales, les services d’encadrement des PME et les universités, organiser la formation accélérée des pionniers qui s’investiront, à l’instar des diplômés du Vuelvan Caras vénézuéliens, dans la réalisation du programme d’éveil du mouvement coopératif. Ces derniers pourront non seulement vulgariser la doctrine coopérative dans leurs terroirs, mais, qui mieux est, recenser les besoins urgents sur les plans économique et social, concevoir de concert avec les populations concernées des projets pertinents et susciter leur engouement pour le financement et la réalisation desdits projets. A titre d’illustration, un gouvernement peut s’engager à former chaque année 2.000 pionniers qui devront, à l’issue d’une session de trois mois, monter, par groupe de dix, un projet coopératif dont le financement ne peut dépasser USD 20.000. Ils seront ensuite chargés de sensibiliser les habitants de leurs contrées pour obtenir, par projet, l’adhésion d’au moins 500 coopérateurs, lesquels devront s’engager à œuvrer dans la coopérative en gestation et à participer pour moitié au capital, en l’occurrence, un apport d’au moins USD 20 par coopérateur en vue de constituer un montant de USD 10.000. Sur ces entrefaites, l’Etat, les fédérations coopératives, les Institutions de la microfinance et les services d’encadrement des PME pourront dispenser aux coopérateurs entreprenants l’appui technique et l’autre moitié du capital, soit USD 10.000 remboursables en 5 ans. Globalement, en arrêtant un budget de USD 2 millions, l’on pourra susciter, dans le meilleur des cas, 200 coopératives la première année et, par le jeu de refinancement, 160 de plus les quatre années suivantes, soit au total 360 coopératives regroupant 180.000 membres actifs ; cela correspond au nombre d’emplois créés. En intégrant les intérêts sur les emprunts, les montants refinancés s’élèveront et, avec eux, le nombre de coopératives et d’emplois créés. Tableau 4 : Projet de formation et encadrement des pionniers en vue de la prolifération des coopératives Paramètres Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total Financement initial et refinancement en USD 2.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 3.600.000 Nombre de pionniers 2000 400 400 400 400 3.600 Nombre de nouvelles coopératives 200 40 40 40 40 360 Nombre de nouveaux coopérateurs 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 180.000 Source : monographie inédite de l’auteur. Graphique 6 : Evolution probable des indicateurs du projet de formation et encadrement des pionniers Source : Idem. Dans l’absolu, en relevant le financement à USD 10 millions pour 1.800 projets à créer par 10.000 pionniers, le nombre de membres actifs sera porté à 900.000. Etant donné que les projets coopératifs ont une forte intensité de main-d’œuvre et que les coopérateurs apportent ou produisent eux-mêmes les intrants (consommations intermédiaires), la productivité sera substantielle et, en agrégeant, la contribution à l’accroissement du PIB, toutes autres choses restant égales par ailleurs, sera très élevée. Il y a dans le coopératisme un fonds très riche d’effets multiplicateurs que les planificateurs devraient exploiter. Dans tous les cas de figure, l’essor du mouvement coopératif créerait, par surcroît, les meilleures conditions pour l’instauration d’un régime démocratique comme nous allons le démontrer dans la section suivante. 8.4. CONTRIBUTION A LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE Dans la deuxième partie de la présente étude, nous avons souligné que la carence de la gestion institutionnelle constitue l’une des hypothèques qui pèsent sur la relance économique de l’Afrique. Le continent noir souffre, non seulement de la mauvaise gouvernance, mais aussi d’un manque de structures institutionnelles viables dans lesquelles aurait dû s’inscrire le développement . Cette incurie dans la conduite des affaires publiques serait la principale cause des distorsions économiques et sociales qui, en s’intensifiant, débouchent souvent sur des guerres fratricides. La gravité de la situation appelle des réformes structurelles notamment des mesures visant non seulement la rationalité et l’efficacité économiques, mais également le renforcement de la capacité des Africains à gérer les institutions publiques. S’il est vrai que l’initiative du secteur privé, les mécanismes de production, de commercialisation et de répartition de revenus doivent être améliorés, il n’en reste pas moins que ces mesures doivent aller de pair avec une bonne administration des institutions nationales et locales. Il est donc d’une nécessité impérieuse que l’instruction publique y soit perfectionnée afin de permettre aux Africains d’apprendre, d’expérimenter et d’adapter librement les techniques modernes de gestion publique notamment la démocratie, le management, le droit, les techniques informatiques et de télécommunications, etc. Sans doute, après cinq siècles d’esclavage et de domination, l’homme africain ne pourra devenir un acteur de son développement que s’il recouvrait ses libertés fondamentales. En effet, l’impossibilité de s’exprimer, d’agir, d’être représenté et la précarité matérialisent autant la pauvreté qu’un revenu ou un développement humain insuffisants. Ce black-out suscite des frustrations et la rébellion parmi les populations tout autant qu’il complique les mécanismes de résolution des conflits armés qui secouent actuellement l’Afrique. A l’heure où l’Afrique Subsaharienne s’est engagée sur la voie de l’instauration du système démocratique afin de libérer ses habitants du joug des régimes dictatoriaux, il importe de lui doter d’institutions de formation à la gestion et aux principes démocratiques. C’est seulement au bout d’une période d’apprentissage qu’un background sociopolitique et technique pourra pérenniser la démocratie, le progrès économique et la paix sociale. Le système coopératif peut, grâce à ses vertus, aider les Africains à prendre, en douceur, ce tournant historique. D’autant que le coopératisme n’est pas uniquement un bon système économique, mais aussi une vraie école de démocratie et de gestion publique. Ce système cultive dans la société les valeurs scientifiques et morales propres au progrès socioéconomique et politique, conjurant résolument l’obscurantisme qui favorise les discriminations et l’autodestruction des populations africaines. A tous égards, la gestion d’une société coopérative est un apprentissage des principes démocratiques. C’est d’autant plus vrai que dans ce genre d’entreprises, les décisions sont prises selon une procédure démocratique notamment par vote aussi bien à l’échelon de l’assemblée générale qu’à celui du comité de gestion. Plus profondément, la souveraineté revient aux membres coopérateurs réunis en assemblée générale. Celle-ci peut, à certaines conditions de quorum et de majorité, décider de la vie et de l’avenir de la société en nommant ou en révoquant les administrateurs ou autres mandataires, en décidant de la dissolution ou de la prorogation de la durée de la société … En outre, tous les coopérateurs sont placés sur un pied de stricte égalité ; quel que soit le nombre des parts détenues, un homme ne dispose que d’une voix lors des réunions de l’assemblée générale. Les coopérateurs ont donc des droits égaux dans la gestion de leur société quelles que soient leur ancienneté ou l’importance des capitaux apportés. En conséquence, tout coopérateur a le droit de : - se faire élire, suivant ses aptitudes, à n’importe quel poste dans les organes de gestion de la coopérative ; - contrôler la gestion de sa société par lui-même ou en sollicitant auprès des instances judiciaires la désignation d’un expert indépendant ; - bénéficier d’une part de l’excédent des recettes sur les dépenses proportionnellement aux activités qu’il a eues avec la coopérative. La pratique de tous les principes coopératifs susmentionnés modèle la personnalité des coopérateurs qui, finalement, les acceptent comme étant le principe moteur de leur mode de relations sociales. C’est à juste titre que Raymond W. Miller de l’Institut Américain de Coopération, affirme que le coopératisme est un professeur à l’école de la liberté . Il s’investit tellement dans la défense des libertés qu’il garantit aux coopérateurs, par son principe de la porte ouverte, la liberté d’adhérer et de se retirer à tout moment. Bien plus, il ne tolère pas parmi ses membres quelques discriminations que ce soit d’ordre politique, social, ethnique, tribal, racial ou autre. En conséquence, il utilise la persuasion, le volontariat et non pas la contrainte pour diffuser et inculquer ses principes. Au même titre qu’il s’oppose aux monopoles économiques, le coopératisme rejette l’idée de parti unique et le monolithisme politique. Il prône le respect de la propriété privée et la coopération en vue de réaliser l’indépendance économique de l’individu. Les coopérateurs peuvent ainsi constituer des fonds communs de placement et participer aux marchés boursiers ou acquérir des parts lors de la privatisation des entreprises publiques. A tout prendre, le système coopératif est fondé sur des principes de liberté, de solidarité, de démocratie et de responsabilité qui, une fois bien appliqués, marquent la personnalité des coopérateurs et imprègnent leurs rapports sociaux. En pratiquant les principes coopératifs dans le domaine économique, les coopérateurs réalisent la puissance qu’ils peuvent développer en s’associant. Ils peuvent ainsi acquérir confiance en eux-mêmes, autonomie, influence, force et courage pour changer leur condition politique. Parallèlement, ils constituent des patrimoines à l’abri des structures coopératives de manière à les protéger de la mainmise de ceux qui s’appuient sur les ressources nationales pour exercer un pouvoir autocratique. C’est là un contingent inestimable que le système coopératif apporterait à la lutte pour la libération des peuples africains. Quand on sait qu’en règle générale dans le tiers-monde, et dans le continent noir en particulier, les peuples sont pris en otage par une oligarchie qui s’est emparée de l’Etat et l’a privatisé grâce à un système de corruption généralisée que l’économiste anglais Peter Bauer qualifie, sans esprit de fronde, de « Kleptocratie » . Ainsi, la manipulation des institutions publiques et de l’appareil judiciaire par des cliques, des castes ou partis politiques procure à ceux-ci des fabuleuses fortunes lesquelles accroissent leur influence sur des masses aveuglées par la misère et obnubilées par des idéologies démagogiques. Dans ces conditions, le peuple est mis à l’écart de la vie politique par la minorité des partis dominants qui confisque toutes les libertés publiques. Ce petit groupe s’érige en souverain maître, décide et exécute des projets concernant la marche de l’ensemble de la Nation, sans consulter celle-ci contrairement à ce qui se faisait autrefois dans la tradition africaine. En effet, dans la plupart des pays africains, le budget et le compte général de l’Etat sont tenus de manière opaque, empêchant l’opinion publique de suivre la gestion des finances publiques, ni les projets devant être exécutés dans leurs circonscriptions. Plus pernicieusement, les gouvernements ne rendent pas compte annuellement des résultats financiers de leur gestion. Or, il n’y a pas d’Etat crédible sans système comptable rigoureux, ni institutions de contrôle efficaces. Depuis les indépendances, le système politique que nous venons de décrire ci-dessus est entretenu par un processus de dénonciation-récidive : chaque nouveau dirigeant se doit d’attaquer la turpitude de ses prédécesseurs et s’engage à débarrasser le pays du fléau de la corruption avant d’être affecté de la même tare. L’avenir du système capitaliste corrompu est donc plus qu’assuré à moins qu’entre temps les populations africaines s’émancipent et s’organisent en vue d’imposer des réformes économiques, sociales et politiques. Malgré le développement parallèle d’un individualisme anarchiste, il y a une raison d’espérer que les initiatives de communautés locales, que les carences de l’administration publique amènent à prendre les choses en main, puissent, dans l’avenir, inspirer l’amélioration de la gestion des institutions publiques, la consolidation du sens civique et la systématisation du contrôle citoyen des affaires publiques . Force est de reconnaître que le système coopératif, grâce aux effets bénéfiques de ses principes, pourrait apporter une contribution inestimable à la réalisation de ces réformes. En effet, le système coopératif n’a de cesse de cultiver, en Afrique postcoloniale, l’esprit démocratique surtout parmi les couches sociales défavorisées qui, en désespoir de cause, deviennent des proies faciles pour la dictature et se laissent prendre au piège de ses promesses mensongères. Le coopératisme les exhorte à lutter pour la liberté, la démocratie, le progrès et la justice sociale. Il leur apprend qu’un avenir heureux ne les attend que si elles protègent, défendent et renforcent leurs libertés, mais non si elles les perdent ou si elles capitulent devant des dictateurs totalitaires ou devant l’oligarchie dominante . Formés et aguerris dans la gestion de leurs coopératives, les populations actuellement marginalisées, devenues alors coopérateurs, acquerront la capacité de comprendre les grands enjeux politico-économiques, et pourront se constituer en groupe de pression pour défendre leur droit légitime au développement. Ayant, qui plus est, pris conscience, grâce à l’intériorisation de l’Evangile de Jésus-Christ, de leur qualité d’hommes libres appelés à entrer en communion avec Dieu, et expérimenté la foi, l’amour infini de Dieu et la dignité d’être enfants du Très-Haut, statut qu’aucun des puissants de ce monde ne peut leur arracher, les chrétiens coopérateurs possèdent les arrhes de l’Esprit Saint et le germe du Royaume éternel de Dieu, condition d’émancipation à l’égard des prétentions à la domination de la part des détenteurs du savoir et du pouvoir . Percevant la réalité des profondeurs de la liberté dans la vérité, la justice et à la lumière du Saint Esprit, les coopérateurs affranchis du mal feront bloc pour arracher leur part du produit national des mains des gouvernants dépensiers qui la retiennent et la stérilisent . Ils rétabliront cet équilibre des revenus par de méthodes évolutives et pacifiques en tant qu’ils sont épris de concorde, imprégnés d’humanité et tendus vers le bien commun. Ainsi entraînés dans une même vision d’avenir, les gens du peuple pourront transcender leurs divisions pour devenir, par ailleurs, des partenaires de l’Etat dans la réalisation des investissements publics visant les infrastructures de base et les services sociaux. C’est la voie royale vers la restauration du dialogue traditionnel, de la participation populaire et de la transparence qui firent la force des empires africains précoloniaux et qui peuvent aujourd’hui promouvoir la bonne gouvernance. Car, en s’impliquant dans la gestion des affaires publiques, les coopérateurs et toutes les forces vives amèneront les gouvernants à inventorier toutes les ressources nationales (minières, forestières, agricoles, touristiques ou environnementales …), à évaluer exactement les recettes réalisables de l’exploitation desdites ressources, à envisager les coûts de leur transformation par la manufacture locale en vue d’en accroître la valeur ajoutée, à décider de l’affectation du surcroît de revenu à la création et à l’entretien d’infrastructures socioéconomiques… De plus, soucieux de mettre bon ordre dans la gestion de l’Etat, ils participeraient activement aux réformes macroéconomiques, financières, commerciales et fiscales en veillant à leurs intérêts légitimes . En conquérant leur liberté politique, les paysans pourront notamment imposer la réforme agraire en vue de recouvrer le droit de propriété sur leurs terres spoliées par les colons. De même, leur action déteindra sur la politique agricole aux fins de posséder en propre leur production et d’en tirer une juste rémunération, quitte à se regrouper coopérativement pour les grands projets d’infrastructure de production (recherche, engrais, machines…) et de commercialisation. A ce titre, la liberté politique est la condition sine qua non du développement socioéconomique et notamment de la lutte contre la pauvreté. C’est notamment la liberté d’expression qui incitera, en effet, les paysans à défendre leurs intérêts et ceux du secteur agricole. Quand la presse est bâillonnée, estime SWAMINATHAN, les famines, fussent-elles endémiques, passent inaperçues permettant aux dirigeants politiques de se consacrer malencontreusement aux dépenses de prestige et d’armement . Face à la misère envahissante, la classe politique africaine répond le plus souvent par un luxe ostentatoire, ignorant superbement les aspirations des gens du peuple au progrès social. L’hédonisme dominant semble remettre en question la maturité politique des gouvernants, tant ils recherchent leur plaisir dans la jouissance et les ébats égoïstes au lieu de le trouver dans le sublime, le service et le devoir bien accompli . L’action coopérative contribuerait ainsi à l’assainissement de l’environnement sociopolitique et économique à l’effet de constituer un capital humain, scientifique, financier et matériel, socle de la future économie et marché africains . Pour les populations actuellement délaissées, le processus d’édification du système coopératif constitue une occasion de se départir de leur mentalité de dépendance, de croire en leur propre valeur et incarner leur foi dans l’action afin de jouer un grand rôle sur la scène politique. En effet, la liberté et l’indépendance propres à l’esprit coopératif, pousseraient les coopérateurs à se ressaisir et à prendre position face à tous les problèmes qui toucheraient à leurs intérêts et à l’intérêt général sans avoir à tenir compte des autorités publiques ou étatiques, non plus que des partis politiques. Les groupes coopératifs feraient participer, au-delà de la période électorale, les populations aux choix et décisions de leurs gouvernants, contrôlant ainsi l’action du gouvernement et réprimant la «captation» de l’Etat par des petites bourgeoisies politico-administratives compradores . Ce faisant, les coopérateurs, en tant que citoyens, bâtiront des Etats stables et prospères lesquels garantiront la paix sociale et la mobilisation de tous, citadins, ruraux, nationaux et étrangers, à l’entreprise du développement national dans le respect des valeurs humanistes africaines. Par ailleurs, nous savons, d’un point de vue pratique, que la décentralisation du pouvoir de décision est un aspect essentiel du système démocratique. Ce dernier répartit les compétences entre les assemblées siégeant au niveau de village, secteur, commune, ville, province et du Parlement, au niveau central. Le système coopératif renforcerait cette décentralisation du pouvoir politique en aidant les populations à gérer de manière autonome la vie économique et sociale à tous les niveaux susmentionnés. Il amènerait surtout les membres de chaque communauté de base à réfléchir et à débattre sur tous les problèmes économiques, sociaux voire politiques qui se poseraient dans la gestion de leurs coopératives et à suggérer des solutions appropriées à l’autorité politique . Ipso facto, les coopérateurs consolideraient la souveraineté et l’autonomie des communautés de base longtemps marginalisées par le système capitaliste dualiste. Dans le cadre de la décentralisation économique, les coopératives pourraient initier la création d’entreprises provinciales d’eau, d’électricité, de mines, de transport, de voirie et de travaux publics en joint-venture avec les entreprises publiques nationales, les administrations provinciales et les privés. Les anciennes entreprises publiques, désormais holdings, conserveront le contrôle de la production et la gestion des équipements, tandis que les nouvelles filiales provinciales s’occuperont de l’exploitation ou de la distribution, selon leur capacité financière et technique . Au travers des institutions coopératives, le partage du pouvoir économique et politique entre les différentes entités de base aboutit à l’édification d’une économie coopérative dans ce que Albert TEVEODJRE appelle une « république coopérative » . Cette perspective est salutaire pour les paysanneries dominées, ne prenant pas part jusqu’aujourd’hui aux grandes décisions qui concernent leur avenir. En effet, la décentralisation coopérative du pouvoir permettra, selon toute apparence, d’accroître leur poids politique et social . Au bout de cette mutation, les organes traditionnels de gestion communautaire pourront recouvrer, comme à l’époque précoloniale, leur autonomie de gestion et susciter la participation de tous les membres à la vie sociopolitique de leurs terroirs . A la lumière de l’analyse menée ci-dessus, il appert que le système coopératif relève le standard éducatif, moral, social et politique des populations et les prépare aux techniques de gestion démocratique. En fait, l’action coopérative, on ne le dira jamais assez, engage les gens simples à jouer un nouveau rôle sociopolitique. En prenant part à la vie des associations coopératives, les paysans, les fermiers, les ouvriers, les artisans, producteurs ou consommateurs, même les plus frustes, peuvent rapidement accroître leur influence, développer des aptitudes à diriger, à parler, à organiser, à édifier une nouvelle structure sociale, un nouveau système . Au-delà, cette prodigieuse expérience en matière de gestion coopérative suscitera parmi les coopérateurs des dirigeants en matière politique. De toute évidence, les sociétés coopératives seraient, comme toutes les autres organisations de base, la pépinière des nouveaux dirigeants politiques rompus dans les techniques de gestion moderne, soucieux de l’intérêt général, respectueux de la légalité, pétris par la culture africaine et vivant en symbiose avec leurs administrés avec lesquels ils partagent une longue et exaltante expérience dans la recherche des solutions à leurs problèmes vitaux, dans un esprit d’entraide, de self help et de décentralisation. Nous sommes éminemment convaincu qu’à la faveur de la gestion des organisations coopératives, les peuples prendront conscience de la nécessité de révolutionner la gestion de l’Etat, de l’économie nationale et de l’appareil judiciaire. A cet effet, ils pourront choisir parmi eux les hommes et les femmes honnêtes, entreprenants, compétents, affables, sociables, patriotes et dignes d’être élevés dans la hiérarchie sociopolitique, à telle enseigne que les élections qui s’organiseraient dans un contexte coopératif auraient toutes les chances d’être libres, transparentes et démocratiques, tant les populations de base ne pourraient élire que des hommes qu’elles connaissent personnellement dans leur vie privée ou qu’elles ont côtoyés dans les affaires. En occupant l’échiquier politique, les coopérateurs contrôleraient la réforme de la fonction publique en y imposant un système de mérite et en y injectant leurs meilleurs membres. Car, le système démocratique procède de la bonne gouvernance, laquelle permet à l’Etat de s’assumer et de générer suffisamment des ressources en vue de les répartir équitablement entre les classes et les secteurs socioéconomiques, assurant à tout un chacun les moyens de défendre ses droits et libertés . Cette hypothèse parait être étayée par l’histoire du peuple américain qui, malgré son individualisme, reste, pourtant celui qui regorge le plus de gens disposés à s’associer dans des groupements ou associations de tous ordres. C’est à l’école de ces organisations de base auxquelles on adhère librement, que le peuple américain a le mieux appris à se gouverner . De même, c’est dans la gestion des coopératives que les futurs dirigeants de pays de l’Afrique Subsaharienne pourraient développer leurs talents d’hommes d’Etat en s’illustrant dans le domaine du développement communautaire, notamment en matière des réformes agricoles comme nous allons l’examiner dans la section suivante. 8.5. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE L’Afrique Subsaharienne ne peut relancer son économie qu’à condition d’élever la productivité de son secteur agricole notamment dans la culture vivrière. En principe, le démarrage économique ne va pas sans mutation agricole préalable ou concomitante. La croissance dans le secteur industriel ne se réalise qu’à mesure que la productivité dans le secteur agricole augmente et permet de dégager des excédents. En ce qui concerne particulièrement le continent noir, le renforcement de la capacité de production de l’agriculture demeure la condition sine qua non de l’amélioration du niveau de vie de ses populations. Au cours des prochaines années, l’agriculture africaine devra accomplir une tâche énorme : subvenir aux besoins d’une population en accroissement rapide par une croissance assez élevée pour réduire les importations des produits alimentaires. D’après une étude menée par les Services de la Banque Mondiale, la sécurité alimentaire des Africains ne pourrait être assurée que si la production vivrière augmentait d’environ 4% par an. Au-delà de cet objectif, si l’on veut faire augmenter les revenus et répondre aux besoins d’importations, la production des cultures d’exportation doit croître d’au moins 4% par an . Ainsi, l’Afrique doit relever le défi de réaliser une croissance de 4% par an au minimum pour les décennies à venir. La réalisation de cet objectif est tout à fait du domaine du possible puisque le potentiel agricole de l’Afrique est extrêmement riche. La main-d’œuvre abondante du continent, sa proximité de l’Europe et les caractéristiques de ses saisons donnent à certaines parties de l’Afrique un avantage comparatif pour maintes cultures. Il n’est en rien surprenant que plusieurs pays africains aient déjà obtenu le taux de croissance de 4% pendant d’assez longues périodes entre 1965 et 1987. Mais dans l’ensemble, au cours de 30 dernières années, la production agricole africaine n’a connu qu’une croissance de 2% par an ; les exportations ont diminué alors que les importations alimentaires se sont accrues d’environ 7% par an. Une centaine de millions de personnes restent sous-alimentées . Plus précisément, dans les quatre pays les plus importants (Ethiopie, Nigeria, Soudan et République Démocratique du Congo) ayant ensemble 47% de la population de l’Afrique Subsaharienne, la production agricole n’a progressé que de 1,5% par an au cours de deux dernières décennies . A la lumière des projections relatives à la croissance agricole de l’Afrique subsaharienne faites par diverses organisations internationales spécialisées, les perspectives agricoles de cette région s’annoncent encore plus difficiles. La FAO, par exemple, projette au mieux un taux de 3,5%, lequel ne ferait que suivre l’accroissement démographique, entraînant ainsi l’augmentation des personnes mal nourries. Longtemps encore, les Africains auront à supporter parmi les peuples la honte d’avoir faim. Cela va sans dire que l’agriculture africaine n’est pas encore à même de réaliser les performances que plus d’un spécialiste attend d’elle. Jusqu’à ce jour, les structures extraverties et dualistes que ce secteur a héritées du système colonial hypothèquent son avenir. En effet, les pays africains ont malencontreusement conservé après leurs indépendances, les structures décadentes de l’appareil de production agricole colonial avec tout ce qu’elles comportaient comme distorsions sur les plans économique, politique et culturel. C’est précisément les paralysies, les impuissances ou les effets inhibiteurs engendrés par ces structures anachroniques qui expliquent les contre-performances enregistrées dans ce domaine alors que les autres continents y ont réussi . Pour autant qu’on examine attentivement la situation agricole de l’Afrique, la crise se manifeste à travers les faiblesses institutionnelles du continent, le cloisonnement des secteurs agricole et industriel, la marginalisation et la domination des communautés rurales, la décadence des campagnes et l’exode rural, la désorganisation de la production vivrière et l’insécurité alimentaire des populations, la spécialisation dans un nombre réduit des cultures d’exportation et la détérioration des termes de l’échange, la désorganisation des marchés et la dégradation constante des revenus des producteurs, l’insuffisance des infrastructures économiques et sociales, l’extraversion des réseaux de transport et des communications, l’absence de politique agricole et le manque d’innovation … Pour tout dire, la stratégie actuellement pratiquée dans la plupart des pays d’Afrique porte encore la marque du système colonial. Les gouvernements ont, en effet, tendance à administrer les prix agricoles, les marchés et l’approvisionnement en intrants ; à utiliser des institutions paraétatiques plutôt que privées pour l’octroi de crédit et la mise au point de nouvelles cultures ; à privilégier l’irrigation sur une grande plutôt que sur une petite échelle ; et à assurer les services de recherche et de vulgarisation dans le cadre de différents projets de développement local financés par des bailleurs de fonds extérieurs, plutôt que dans le cadre de programmes nationaux coordonnés. A quelques exceptions près, ils ne prêtent guère attention à l’environnement, au régime foncier ou à la façon de donner aux hommes et aux femmes dans les zones rurales les moyens de prendre en main leur existence . Même les actions induites par les organismes internationaux de développement ont péché par un choix d’institutions et de techniques de gestion inadaptées aux caractéristiques socioculturelles et géographiques propres à l’Afrique subsaharienne . Il est dès lors impérieux que l’Afrique Subsaharienne opère une vraie révolution en réformant ses structures agricoles afin de juguler les paralysies issues du système capitaliste néo-colonialiste. Plus que jamais, il faudrait que l’agriculture africaine devienne le moteur de la croissance économique de ce continent, d’autant plus qu’on ne peut espérer une croissance stable et générale des revenus qu’en développant le secteur agricole, grand employeur de main-d’œuvre. Pour ce faire, les gouvernements devraient adopter des nouvelles politiques autrement compatibles sur le plan socioculturel, renforcer les institutions et, surtout, développer les ressources humaines en réorganisant les communautés villageoises en vue de les rendre assez dynamiques pour relever les rendements de la production agricole notamment celle destinée au marché intérieur. A tout prix, le monde rural se doit de sortir de son inertie afin de dégager constamment, dans son activité primaire qui n’est rien d’autre que l’agriculture, un surplus économique nécessaire à l’entretien du processus de développement . Par ailleurs, les interventions directes sur les prix agricoles qui jouent au détriment dudit secteur devraient être abolies, en même temps que la protection disproportionnée de l’industrie. En tout cas, il serait primordial de faire correspondre le taux de change à sa valeur d’équilibre à long terme et de réduire la taxation directe de l’agriculture, tout en empêchant les groupes d’intérêts de miner le programme de stabilisation des prix et des revenus agricoles. Globalement, la politique agricole devrait être cohérente tant dans ses aspects techniques, économiques, administratifs, politiques, éthiques, éducationnels et culturels. Néanmoins, les efforts des pouvoirs publics ne pourront porter des fruits que s’ils s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme générale de l’économie nationale . Au demeurant, la réussite de toutes ces réformes dépend de leur adaptation aux valeurs socioculturelles africaines. C’est à juste titre que René LENOIR soutient que le développement ne peut être indépendant de la culture d’un peuple . Tenant compte de cette dimension culturelle, nous sommes fondé à penser qu’en Afrique, le développement agricole rime avec le développement communautaire. En corollaire, toute stratégie basée uniquement sur l’épanouissement individuel a peu de chance d’aboutir. Il est illusoire de miser sur quelques agriculteurs de pointe, formés et équipés en vue de jouer le rôle de leaders de la réforme de l’agriculture et de la diffusion des techniques modernes. Selon toute vraisemblance, ces agriculteurs sélectionnés ne seront pas suivis par les autres membres de la communauté. Ainsi, la réalisation d’une pareille stratégie déboucherait-elle sur une dislocation de la société, du fait que tous les agriculteurs privilégiés seront frappés d’ostracisme par le reste du groupe. C’est que la motivation par la concurrence individuelle a fort bien rempli son rôle en Europe et en Amérique, parce qu’elle intervenait dans un milieu qui en admettait à la fois le principe et les conséquences, c’est-à-dire les profondes inégalités. En Afrique, la préoccupation égalitaire, le sens de solidarité et d’entraide sur lesquels sont bâties les sociétés rurales suggèrent pour le secteur agricole le choix d’un développement de type communautaire, d’autant plus que l’agriculture demeure, dans ce continent, un domaine obéissant traditionnellement à la discipline du groupe. Comme nous l’avions largement développé dans le chapitre précédent, l’organisation socioéconomique et politique des Etats africains précoloniaux était basée sur les communautés villageoises dont les membres unissaient leurs moyens de production et partageaient équitablement les récoltes . Aujourd’hui, l’Afrique peut mettre à contribution cette expérience millénaire du communautarisme. En clair, la stratégie en matière de développement agricole devrait s’appuyer sur les communautés villageoises de peur qu’elle ne mette en péril la cohésion sociale et qu’elle n’énerve les valeurs fondamentales africaines. Elle devrait se baser sur le génie propre des peuples d’Afrique, lesquels ont débordé d’innovations au cours de la période précoloniale, et sont à même de réformer les structures agricoles actuelles à condition qu’ils soient associés à la conception et à la réalisation des projets de développement, aux expériences techniques, qu’ils gèrent les moyens disponibles et qu’ils contrôlent toutes les étapes de l’aventure afin de ne pas hypothéquer l’avenir commun . A notre avis, les sociétés coopératives pourront, grâce aux vertus de leurs principes de gestion, amener les membres des communautés rurales à réaliser des réformes du secteur agricole. Etant fondées avant tout sur l’élément humain, elles réorganiseront les ruraux, actuellement dispersés, en vue de relever leur productivité et leur dynamisme et partant, d’améliorer la production, la commercialisation, l’infrastructure sociale et le revenu agricole global. 8.5.1. Contribution à la croissance de la production agricole Comme nous l’avons suggéré ci-haut, l’appareil agricole dans la plupart des pays africains devrait être restructuré en vue d’en accroître la productivité et de dégager les excédents susceptibles de contribuer au développement de l’industrie et des secteurs sociaux. En fait, les gains de productivité indispensables pourront venir aussi bien de la réhabilitation économique, politique et culturelle, que de changements technologiques, à savoir : l’amélioration des méthodes d’élevage et de culture, l’utilisation rationnelle des facteurs de production chimiques et organiques, l’intégration de l’élevage dans les systèmes culturaux de façon à utiliser la traction animale et le fumier, l’introduction de nouvelles cultures d’un meilleur rapport, le recours aux meilleures techniques d’irrigation, le perfectionnement des instruments manuels, des techniques de stockage des récoltes et de l’infrastructure rurale . Néanmoins, le potentiel agricole des pays africains demeure très dissemblable. D’une part, il y a l’Afrique Centrale, l’Afrique de l’Ouest humide et l’Afrique Australe disposant de vastes terres cultivables et une faible densité de la population, d’autre part, il faut compter la majeure partie du Sahel, certaines régions de l’Afrique de l’Est montagneuse ainsi que la bande aride s’étendant depuis la côte de l’Angola à travers le Botswana et le Lesotho, jusqu’au sud du Mozambique ayant une population trop nombreuse pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais quand on tient compte des contraintes sur les terres arables (30% des superficies disponibles) et la nécessité de préserver la forêt primaire qui recouvre une bonne partie des terres arables non encore utilisées, la productivité des terres, plus que la productivité de la main-d’œuvre, doit être accrue d’au moins 4% par an dans les pays à fort potentiel agricole pour pouvoir subvenir aux besoins de la population africaine en constante augmentation . Ce défi est renforcé par la perspective d’une augmentation des prix alimentaires dans le monde, du fait de la baisse de la production à long terme consécutive à l’assèchement des nappes aquifères, du réchauffement de la planète, de la levée des subventions à l’exportation et d’un éventuel déficit céréalier en Chine au cas où les recherches biotechnologiques n’arrivaient pas à accroître la productivité du secteur riz de 15 à 20% dans la province de Hunan . Malheureusement, le secteur agricole n’a pas bénéficié de l’appui des pouvoirs publics depuis l’accession des pays africains à l’indépendance à cause du préjugé défavorable audit secteur par rapport à l’industrie. La politique des prix agricoles mise en œuvre par les gouvernements a faussé les incitations au détriment de l’agriculture, entraînant une baisse des termes de l’échange intérieurs du secteur agricole. Cette situation a été exacerbée par la protection élevée de l’industrie, la surévaluation du taux de change et la ponction massive de revenu, faisant de l’agriculture un secteur moins attrayant que les autres . Par-delà les méfaits de la politique agricole énoncée ci-dessus, la mutation agricole demeure profondément hypothéquée par des facteurs psychologiques néfastes engendrés par toutes sortes de dominations et exclusions dont les paysans ont été l’objet pendant les périodes coloniale et postcoloniale et qui, en conséquence, les prédisposent à une sorte d’individualisme anarchiste, leur interdisant de se penser eux-mêmes comme membres d’une classe capable de se mobiliser en vue d’imposer une transformation systématique des rapports socioéconomiques . Désabusés, les gens du peuple ont développé les mécanismes individuels de survie au détriment des activités de production proprement dites. Aujourd’hui, les masses rurales sont, qui pis est, dispersées et incapables de mener des actions collectives. C’est ici le lieu de relever que le système coopératif chemine heureusement vers la réponse à cette carence. Il pourrait contribuer de manière décisive au développement durable du secteur agricole en augmentant les parts du capital et du travail agricoles ainsi que celle de la production agricole dans le revenu national. En effet, l’esprit coopératif qui fut jadis très fort dans l’Afrique traditionnelle peut, de nos jours, être ravivé par les deux piliers psychologiques du coopératisme moderne, à savoir : le self help ou l’union des forces pour la prise en main de ses propres affaires et l’entraide ou le regroupement pour faire face aux besoins communs par des actions communes. A défaut de reconduire les structures sociopolitiques de l’Afrique précoloniale, le système coopératif peut restaurer l’organisation ancienne de la production notamment la mise en commun des moyens de production. Car, aujourd’hui plus qu’autrefois, l’union s’impose entre les membres de communautés africaines partageant les mêmes us et coutumes, ayant sinon des liens de parenté lointaine, du moins la même culture . Par ailleurs, les caractéristiques propres des sociétés coopératives telles que l’autogestion, le volontariat, la démocratie, la liberté, la primauté de l’homme sur la matière, le réalisme, la mise au service de la communauté des biens privés, la neutralité, l’indépendance vis-à-vis de l’Etat et des partis politiques, l’unité, la solidarité, font qu’elles soient capables de rendre leurs membres indépendants et confiants en eux-mêmes, en leurs propres possibilités et en leur aptitude à opérer les réformes des structures agricoles. Sur le plan stratégique, les coopérateurs agricoles africains pourront ainsi être armés contre la politique des dons alimentaires qui, sauf en cas de catastrophe, font chuter les prix, ruinent la paysannerie locale et, à terme, diminue la production alimentaire. En créant des unités de production sous forme de coopératives agricoles, les paysans réaliseraient efficacement les réformes dans le domaine de la production agricole notamment : - le recouvrement par les paysans de la propriété des meilleures terres dont ils ont été dépossédés par les colons et l’oligarchie dominante ; - l’affectation prioritaire de ces nouvelles propriétés à la culture vivrière ; - l’intensification de l’emploi des facteurs de production tels que le travail et le capital ou l’apport des meilleures techniques traditionnelles et des techniques modernes : machines, engrais, semences améliorées sans oublier le crédit et les réseaux de distribution ; - la protection de l’environnement afin d’éviter que la croissance agricole n’aggrave les problèmes environnementaux tels que la pollution chimique et biologique de l’eau, la saturation des sols, les érosions, la salinisation, l’assèchement des nappes phréatiques, la destruction de la forêt tropicale. La réalisation de cette mutation est tout à fait du domaine du possible parce que l’implantation des sociétés coopératives dans le milieu rural permettrait d’enrayer la désintégration et la marginalisation des communautés villageoises. Grâce à l’action coopérative, les propriétaires terriens, les paysans, agriculteurs ou artisans, pourraient de nouveau se regrouper, dans un esprit coopératif, au sein des unités de production autrement structurées utilisant des méthodes de gestion les plus efficaces, et fonctionnant pour la satisfaction prioritaire de leurs propres besoins. Vraisemblablement, les incitations à la production locale seront d’autant fortes que les paysans eux-mêmes gèreraient, grâce au mouvement coopératif, les structures rurales dans leur propre intérêt, participeraient à la conception et à la réalisation des projets, contrôleraient les recherches et les expériences techniques dans leur milieu. Dans le meilleur cas, il en résulterait un accroissement de la productivité dans les campagnes. Nous n’insisterons jamais assez sur l’étonnante capacité des sociétés coopératives à relever le standard social, éducatif et moral de leurs membres. C’est dans leurs entreprises que les paysans développeront leurs talents en vue d’améliorer leur productivité et leur capacité managériale. Libérés, en effet, des corvées quotidiennes, confrontés à des responsabilités plus grandes, ils seront plus enclins à consacrer assez de temps au relèvement de leur niveau éducatif et à se lancer dans la planification à long terme. En outre, le développement coopératif entraînerait la décentralisation des pouvoirs économique et social au profit des producteurs directs paysans, augmentant ainsi leur poids politique et leur pouvoir économique. Ils pourront, dès lors, participer activement à la gestion de leurs collectivités et, ipso facto, décupler leurs efforts en vue d’augmenter et de stabiliser la production agricole. En particulier, le rôle des femmes dans l’agriculture sera accru du fait de l’absence de toute discrimination dans les organisations coopératives. Cela pourrait augmenter sensiblement la production globale d’autant plus que dans les pays pauvres, les deux tiers d’alimentation vivrière sont produits par des femmes . De la même façon, l’institution des coopératives stimulerait la production agricole en pratiquant des justes prix, plus rémunérateurs pour les producteurs en raison de l’élimination des intermédiaires spéculateurs à la baisse, tandis qu’en créant les infrastructures de base et en mettant en commun les matériels lourds, le système coopératif libèrerait les paysans des corvées improductives afin d’accroître le temps de travail proprement agricole et, par conséquent, d’améliorer leur productivité . De toute évidence, l’organisation coopérative de la production agricole serait propre à susciter l’accroissement de l’offre en remédiant aux problèmes d’approvisionnement, de commercialisation et de financement du monde rural. En effet, l’optimum du système coopératif rural serait assuré par une symbiose entre les sociétés coopératives, lesquelles assumeraient la production de biens et services collectifs susceptibles de générer les économies externes, et les exploitations familiales, qui s’occuperaient de la production agricole comme cela se faisait autrefois dans la société traditionnelle africaine . Aussi, le système garantirait-il un équilibre sur les marchés ruraux de l’emploi, de biens et services et de crédit. Car les coopérateurs paysans prendront librement les décisions économiques optimales en vue de maximiser leur utilité, leur rendement ou leur revenu. Tout étant fait en fonction de la satisfaction de leurs besoins collectifs et individuels et en tenant compte des opportunités qu’offriraient les marchés intérieur et international. A cet effet, les structures coopératives présenteraient l’avantage d’être assez souples pour s’accommoder aux exigences de compétitivité, tant elles permettraient de trouver à tout moment, grâce à des alliances coopératives, et à la politique de la porte ouverte, les meilleures échelles de production pour réduire les frais de production et résorber les distorsions entre l’offre et la demande de facteurs, de biens et de services. A la vérité, le mouvement coopératif, lorsqu’il est mené par des vrais coopérateurs animés d’un esprit conformiste, finit par gagner tous les secteurs socioéconomiques du monde rural. Immanquablement, ce développement de l’économie coopérative rurale influera sur la croissance du secteur agricole du fait qu’il y apporterait le progrès technique, la diversification de la production, la création des nouvelles industries en amont comme en aval et aussi l’instauration des circuits de distribution efficaces . En fait, dans une économie coopérative, le progrès technique est possible grâce à la participation de tous les membres à toutes les activités de conception et d’exécution ainsi qu’au partage équitable des bénéfices du progrès proportionnellement au rendement de chacun. Bannissant toute discrimination, l’action coopérative faciliterait la réalisation, dans un esprit de solidarité, de liberté et d’entraide, d’une symbiose entre les techniciens modernes issus de l’école urbaine et les paysans détenteurs de la culture et des techniques traditionnelles. Ces deux groupes pourront ainsi mettre en commun les connaissances scientifiques, techniques et traditionnelles, les moyens matériels et financiers en vue de consolider le bien-être de chaque membre. Ces synergies entre connaissances scientifiques et connaissances traditionnelles, entre monde urbain et monde rural, stimuleraient la créativité et l’innovation et permettraient la diffusion permanente des techniques et méthodes efficaces dans le secteur agricole. Le rapprochement, à travers le mouvement coopératif, des hommes de diverses souches et situations, fondera une solidarité intertribale et interethnique dont l’Afrique a besoin pour résoudre le problème des pays africains à faible potentiel agricole, par exemple le Sahel. Dans le cadre de cette solidarité coopérative, les citoyens de ces pays pourront augmenter leurs revenus en participant dans l’agriculture des pays voisins de manière temporaire, saisonnière ou permanente. Ces migrations guidées par l’esprit coopératif apportera, à n’en pas douter, un accroissement de productivité dans les pays à fort potentiel agricole notamment l’Afrique Centrale. Ainsi, la coopération économique se développera sur des bases saines entre les pays de l’Afrique Subsaharienne en vue de la prospérité de cette région . Dans une perspective coopératiste, la production agricole satisfera, au premier chef, aux besoins alimentaires des paysans ainsi qu’à leur désir de s’assurer des revenus stables. Ces facteurs inciteront naturellement les agriculteurs coopératifs à diversifier leur production en raison de la multiplicité des besoins à combler . Par ailleurs, la présence des coopératives dans l’agriculture canaliserait dans ce secteur l’investissement privé en vue d’y relever la production et les revenus. Or, c’est précisément ce relèvement qui conditionne la croissance industrielle de l’Afrique Subsaharienne. Ainsi que nous l’avions souligné dans le chapitre précédent, si les revenus agricoles s’amélioraient, la demande de produits manufacturés augmentera également et la possibilité d’acquérir des biens de consommation à un prix abordable devrait encourager les agriculteurs à accroître leur production. L’industrie sera alors à même d’assurer la transformation de la production agricole excédentaire et de fournir aux agriculteurs les intrants et le matériel dont ils auraient besoin pour accroître leur productivité . Les alliances coopératives veilleraient à concentrer les flux économiques intra-muros afin d’éviter toute dispersion à l’extérieur du système. Par ailleurs, le développement de l’économie coopérative dans le monde rural apportera le progrès dans l’organisation de l’artisanat. Celui-ci acquerra l’expérience technique et managériale pour tirer parti des débouchés que lui offrira éventuellement l’agriculture en expansion. Bien restructuré, il adapterait les techniques modernes aux ressources disponibles en préservant, en outre, l’environnement. Ainsi, les campagnes pourront se doter des réseaux de communications, des centrales électriques, des unités d’exploitation de matières précieuses, … A une prochaine étape de leur développement, les coopératives de production transformeront le surplus de la production agricole et les matières premières d’exploitation artisanale. Ainsi, le développement coopératif pourrait conjurer l’adoption par les gouvernements africains de la politique insidieuse de complexes agro-industriels de type capitaliste. Ceux-ci constituent un instrument de paupérisation des paysans fascinés par l’attrait et le prestige attachés au travail salarié, mais avec des bas salaires qui entraînent, en définitive, le blocage du développement social et économique . En dernière analyse, l’accroissement de la productivité agricole en Afrique Subsaharienne dépend de la reprise par les communautés de base rurales de leurs initiatives économique, politique et culturelle et par-dessus tout, de l’institutionnalisation du système coopératif aussi bien au niveau de la production qu’à celui de distribution. 8.5.2. Contribution au développement des marchés agricoles Le développement de l’agriculture en Afrique est largement contrariée par la désorganisation des marchés locaux, la faiblesse des échanges intra-régionaux et le manque de compétitivité sur les marchés internationaux. Globalement, les marchés agricoles africains sont inefficaces. Cet état des choses explique l’aggravation de l’insécurité alimentaire des ménages, la dissonance entre les secteurs agricole et industriel, les villes et les campagnes, la faiblesse des revenus des ruraux et leur misère, ainsi que le gaspillage des réserves en devises dans les importations alimentaires. Sur le plan intérieur, il existe déjà un marché en pleine croissance pour les produits alimentaires mais dont la demande est largement satisfaite à l’aide d’importations. Il s’agit, pour l’avenir, d’améliorer le système de commercialisation et les dispositifs de stockage afin d’accroître, à l’intérieur, le commerce des cultures vivrières et de rapport, de créer des unités de commercialisation en vue d’éliminer les intermédiaires spéculateurs et de stimuler la production des produits et intrants agricoles au profit des centres ruraux. Sur le plan du commerce international, la levée progressive des barrières ouvrirait des débouchés internationaux pour une production africaine plus diversifiée. En perspective, il serait d’une nécessité impérieuse de prendre des mesures adéquates en matière de change, de commercialisation, de techniques de production afin que l’agriculture africaine devienne assez compétitive pour reconquérir les marchés internationaux. Il faudrait au même titre amplifier les échanges intrarégionaux des produits vivriers, des produits transformés et des intrants à l’effet de renforcer la coopération et l’intégration régionales, telles que recommandées par le Plan d’action de LAGOS . Dans le même ordre d’idées, les accords de partenariat économique signés en juin 2000 entre l’Union Européenne et les Etats ACP induisent notamment le renforcement de l’intégration régionale, susceptible de relever les revenus dans les zones rurales où vivent 73% des pauvres des pays en développement . De notre point de vue, les sociétés coopératives constitueraient des organes de commercialisation assez efficaces pour renouer les liens entre les villes et les campagnes dans un commerce florissant, lequel déborderait inexorablement le cadre national. En effet, la prolifération des coopératives agricoles apporterait la transformation des structures socioéconomiques dans le secteur agricole grâce aux vertus de la philosophie coopérative. Plus précisément, le quatrième principe limitant le taux d’intérêt du capital initial exclut le profit des opérations coopératives, apportant un surcroît de motivation pour les producteurs, lesquels pourraient obtenir la valeur réelle ayant cours sur le marché sans que celle-ci ne soit diminuée du montant du profit injustifié qu’appliqueraient éventuellement les intermédiaires ou les organismes publics de commercialisation. Parallèlement, le développement des coopératives de consommation améliorerait l’approvisionnement dans les zones rurales et urbaines en ce qu’il aiderait les consommateurs à acquérir les marchandises à la valeur réelle de leur argent aucunement grevée des prélèvements effectués par les spéculateurs. Il en résulterait une tendance à la stabilité des prix au niveau de toute l’économie du fait de la disparition de la marge bénéficiaire des intermédiaires spéculateurs et la résorption des anticipations des agents économiques sur le taux d’inflation . C’est donc qu’à travers le système coopératif s’édifierait un cadre concurrentiel sain pour le développement des marchés agricoles locaux en mettant directement en rapport les offreurs (producteurs) et les demandeurs (consommateurs) par l’exclusion d’une multitude d’intermédiaires spéculant à la baisse au niveau des producteurs et à la hausse au niveau des consommateurs ainsi que de nombreux organismes publics chargés du contrôle des stocks et des prix. La proximité et l’identité entre producteurs et consommateurs susciteraient le développement d’un réseau serré de distribution et de service après-vente qui favoriserait l’expérimentation et le développement de la production industrielle, tant la grande fidélité de la clientèle permettrait un rapprochement entre les coopératives de production et celles de consommation dans une diversité de filières (agro-alimentaire, textile, logement, acier, …). Cela règlerait également la détermination du volume et de la composition des importations suivant les besoins réels de l’économie nationale. Grâce à ce système, le volume des échanges entre les villes et les campagnes s’accroîtrait non seulement en ce qui concerne les produits vivriers mais aussi pour les intrants, les produits manufacturés et autres services modernes. De fait, le mouvement coopératif recréerait les conditions économiques de la société africaine précoloniale qui étaient autrefois favorables au maintien d’une structure commerciale appropriée à la concurrence parfaite ainsi qu’à l’expansion du commerce extérieur . Par ailleurs, la propension à la diversification d’activités propre au développement de l’économie coopérative suppléerait au manque de dynamisme de l’industrie néo-capitaliste extravertie grâce à l’éclosion de nouvelles coopératives de transformation de produits agricoles et de production artisanale des intrants tels que les semences, les machines et matériels agricoles, outillage, engrais … Cette extension de la gamme d’activités en dehors de l’exploitation agricole provoquerait l’essor d’une agglomération économique dynamique susceptible de favoriser l’expansion des marchés intérieurs et de relever les revenus, surtout dans les zones rurales. Sur sa lancée, le mouvement coopératif lèvera progressivement les obstacles au développement du commerce intérieur notamment l’extraversion des réseaux de transport et de communication. En effet, les coopérateurs en partenariat avec les pouvoirs publics entreprendront efficacement les travaux de réhabilitation des équipements collectifs et particulièrement du réseau routier . L’apport le plus décisif du coopératisme reste cependant le relèvement du standard éducatif et social des paysans qui, en Afrique, n’ont généralement pas accès à l’éducation de base. Embarqués dans l’action coopérative, ceux-ci deviendraient indépendants et confiants en eux-mêmes et en leur capacité d’intervenir valablement sur les marchés agricoles en tant qu’agents économiques à part entière. Etant devenus entrepreneurs, les ruraux africains ne seront plus soumis à la politique coloniale et néo-colonialiste de bas salaires qui a longtemps entravé la formation des capitaux nationaux et le développement du marché intérieur . En ce qui concerne le commerce international, les coopératives africaines pourront à l’instar de celles du Danemark ou de l’Irlande rechercher activement les débouchés en Afrique et dans le monde entier. A l’intérieur de cette région, il sera question de développer les échanges de produits vivriers, de produits transformés et d’intrants entre les pays potentiellement riches de l’Afrique Centrale, de l’Afrique de l’Ouest humide, de l’Afrique Australe, d’une part, et les régions arides du Sahel, certaines régions de l’Afrique de l’Est montagneuse ainsi que la bande s’étendant depuis la côte de l’Angola à travers le Botswana et le Lesotho, jusqu’au sud du Mozambique, d’autre part. Au-delà de la région subsaharienne, les coopératives agricoles africaines serviront d’unités de base pour renforcer les capacités locales en vue de reconquérir les parts des marchés d’exportation perdues et de diversifier lesdites exportations. Ainsi, l’Afrique Subsaharienne sera capable de tirer largement profit de la libéralisation des échanges et de la levée des obstacles tarifaires consécutive aux accords négociés sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) . 8.5.3. Contribution à la création d’infrastructure économique et sociale Depuis les indépendances, l’Afrique Subsaharienne s’est sabordée en se détournant du développement des campagnes. Cette erreur stratégique a entraîné la décadence du monde rural, spécialement, le déclin de son infrastructure. Aujourd’hui, dans la plupart des pays africains, les routes et les moyens de communications rurales continuent de se dégrader, la recherche agricole piétine, le régime foncier devient de plus en plus précaire, le financement agricole s’effrite, les services sociaux adéquats font gravement défaut . Privés d’institutions éducatives adéquates, d’organes de santé, de services financiers, de leur base culturelle et de tous les avantages matériels qu’offrent les techniques modernes, les paysans ne sont plus en mesure d’améliorer leur productivité aux fins de promouvoir leur bien-être. Par ailleurs, le niveau élevé des taux d’intérêt et des prix des intrants, hypothèque tous leurs projets de construction des bâtiments et d’acquisition de matériels pour développer leur exploitation et leur milieu social. Il est impérieux que les gouvernants africains aient égard aux problèmes de réhabilitation de l’infrastructure économique et sociale afin d’ouvrir des nouvelles perspectives pour les ruraux. En effet, l’amélioration des services d’infrastructure est un élément clé de la lutte contre la pauvreté en tant qu’elle permet non seulement d’accroître les revenus, mais aussi de diversifier les activités agricoles et les sources de revenus des ménages ruraux, d’étendre et de rendre compétitif le réseau de distribution, en facilitant la circulation des produits alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires, d’agrandir et de redynamiser le marché de l’emploi , étant donné que les programmes de travaux d’utilité publique demandent un assez grand nombre d’ouvriers souvent relativement peu qualifiés . En priorité, il faudrait, d’une part, développer les réseaux de transport et de communication afin que les familles rurales puissent accéder aux intrants et aux biens de consommation et vendre leur production et, d’autre part, assurer la fourniture des services de base tels que l’eau, l’électricité, l’irrigation, la santé, l’éducation… Dans la foulée des réformes, les zones rurales devraient être dotées d’institutions de recherche et de vulgarisation agricole qui se chargeront de la mise au point, de l’adaptation et de la propagation des techniques agricoles améliorées, y compris l’adoption de nouvelles cultures. Il s’agirait surtout de parfaire la gestion des fonds de recherche, car la recherche agricole est en plein déclin en Afrique Subsaharienne alors que les montants y consacrés ont été relativement plus élevés dans cette région que partout ailleurs dans le monde en développement : 360 millions de dollars environ en 1980, contre à peu près 190 millions en Asie du Sud où les agriculteurs sont pourtant plus nombreux . Sur le plan financier, il est urgent de promouvoir les organisations financières paysannes afin d’apporter aux ruraux des meilleurs services financiers susceptibles de les inciter à épargner ou à emprunter pour investir dans l’agriculture et le développement rural. Sur ces entrefaites, les gouvernements devraient, avec la collaboration des organisations rurales, garantir les droits de propriété foncière afin de faciliter l’accès des paysans au crédit grâce au montage des prêts hypothécaires normaux. A cette fin, les organisations rurales prendraient, elles-mêmes, l’initiative d’élaborer les outils juridiques pour renforcer les régimes fonciers en vue d’assurer une plus grande sécurité, sans pour autant battre en brèche les droits d’accès traditionnels aux terres de la tribu ou du clan qui en assuraient une redistribution équitable . Dans l’entreprise de réhabilitation de l’infrastructure, le système coopératif apporterait un remède sans pareil. L’action coopératif réaliserait, en effet, le tour de force de regrouper les paysans sans distinction de sexe, ni discrimination d’origine tribale, raciale, politique ou religieuse, dans un élan coopératif, en vue de la résolution de leurs problèmes concrets et quotidiens ainsi que la satisfaction de leurs besoins d’infrastructure de manière tout à fait décentralisée et démocratique. Ce faisant, les coopérateurs contribueraient à la mobilisation de l’épargne locale et à son affectation aux investissements dans les secteurs vitaux prioritaires et les plus productifs. De même qu’ils participeraient à l’identification et à l’évaluation des problèmes des collectivités locales nécessitant une intervention de l’Etat, et partant, rehausseraient l’efficacité du programme d’investissements publics. En tout cas, il y a toujours un type de société coopérative pour répondre aux problèmes et besoins des ruraux. Ainsi, en réponse aux problèmes et besoins d’édification d’un appareil de production agricole, d’institutions de recherche et vulgarisation, de réforme agraire, de développement de l’élevage et de la pêche, le système coopératif propose les structures des coopératives agricoles, coopératives de pêche, d’élevage, etc. Face au problème et besoin de financement, il offre des coopératives de crédit et de garantie mutuelle ; face à ceux d’approvisionnement en biens manufacturés et d’équipement, des coopératives de consommation et de production artisanale. Dans l’absolu, les problèmes de réhabilitation et développement du réseau de transport et communication peuvent être solutionnés par les coopératives de construction et de cantonniers, les coopératives de transport et communication … En outre, les coopératives d’habitat à loyer modéré (HLM), les coopératives de santé, d’assurance, les coopératives de formation, les coopératives d’assainissement, d’approvisionnement en eau et électricité peuvent créer l’infrastructure adéquate en vue du mieux-être des ruraux. Dans tous ces secteurs, les sociétés coopératives, grâce à leurs structures souples, permettront, à court terme, une meilleure combinaison des facteurs en vue de satisfaire à moindres frais les besoins des coopérateurs et, dans une perspective de long terme, de programmer les investissements en vue de minimiser les coûts totaux. C’est ainsi qu’il serait possible de réaliser des économies d’échelle particulièrement dans la construction et le maintien des infrastructures de base par la participation populaire aux grands travaux et la régulation de la collecte de l’épargne . Par ailleurs, la gestion collective du problème d’approvisionnement en eau, énergie et en produits de première nécessité, d’une part, du problème de commercialisation de la production rurale et de l’entretien d’équipements, d’autre part, libérera les paysans des tâches moins productives, leur laissant davantage de temps pour s’occuper du travail agricole proprement dit afin d’accroître d’autant leur rendement. Ainsi, la gestion coopérative des travaux publics constituerait véritablement une voie de sortie de l’impasse d’un secteur public budgétivore dont le développement est freiné par la gabegie et la réglementation des prix. Tant il est vrai qu’en assurant, aux prix coûtants, les services publics sous les auspices des coopérateurs usagers, l’exploitation collective ne pourra subsister que si lesdits prix sont, à l’équilibre les plus bas, c’est-à-dire, assez avantageux pour attirer les membres dans leur entreprise. A tout prendre, le mouvement coopératif peut, à travers et par-delà son action efficace dans le secteur agricole, transformer l’environnement rural en y développant une activité plurisectorielle qui comprendrait, outre la création des industries de transformation à la campagne, la construction d’installations ou d’équipements sociaux (écoles, dispensaires, routes, télécommunications, approvisionnement en eau, etc.), l’instauration des services et programmes socioculturels ainsi que l’encadrement politique de toutes les couches de la population rurale. En réussissant à déclencher le développement agricole, le mouvement coopératif fournira, sans cesse, aux ruraux, les moyens indispensables à la création, au fonctionnement et à l’entretien des équipements et les divers services. Faisant ainsi des communautés villageoises des pôles de développement économique. En fait, l’augmentation de la production globale (output) consécutive à l’accroissement du rendement des millions de coopérateurs va, sur le plan macroéconomique, accélérer l’investissement et relever la capacité productive de l’économie nationale . Cette thèse est étayée par une étude récente de la Banque Mondiale laquelle démontre que la participation des usagers à la conception, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure, à l’instar de la participation coopérative, permet de mieux répondre aux besoins des pauvres. Lorsque les usagers eux-mêmes prennent l’initiative de développer l’infrastructure et sont prêts à y contribuer (financièrement ou en nature), les projets d’investissement y gagnent sous tous les rapports. En effet, ils risquent moins d’être inutilement complexes (et coûteux) lorsque la communauté précise ses besoins et doit faire des sacrifices pour réaliser les investissements nécessaires. En substance, lorsque les usagers participent à la conception d’un projet et à sa mise en oeuvre, son fonctionnement et son entretien sont en général mieux assurés, surtout pour certains types d’infrastructures tels que la voirie rurale, les canaux d’irrigation… 8.5.4. Apport dans l’accroissement du revenu agricole global et dans l’amélioration du niveau de vie en milieu rural Le secteur agricole, qui domine les campagnes africaines, est appelé à devenir, sous l’impulsion du mouvement coopératif, un pôle dynamique et une source majeure d’emplois et de revenus pour de nombreuses familles rurales. C’est dire à quel point l’instauration des coopératives dans l’agriculture y diversifierait la production, entraînant ipso facto une augmentation des revenus globaux et individuels. Cette démarche est essentielle à la réalisation de l’ODM de réduction marquée de la pauvreté. Si l’on part du principe que, pour épargner, les ménages doivent d’abord atteindre et dépasser le niveau de consommation de subsistance, l’action des coopératives dans le secteur vivrier parviendrait incontestablement à améliorer, à peu de frais, la consommation alimentaire de la plus grande partie de la population, laissant une part de plus en plus croissante de ses revenus disponible pour la constitution de l’épargne . En plus, la participation effective des masses dans la gestion de coopératives d’épargne assurera la transparence des mécanismes d’octroi des crédits à tout membre se trouvant dans le besoin. Cela accroîtrait leur propension à épargner malgré leur condition difficile. Dans l’idéal, la prolifération des coopératives au rythme de l’expression des besoins locaux, serait une source de croissance industrielle en ce qu’elle stimulerait la création des nouvelles industries coopératives en amont et en aval de l’agriculture, générant ainsi des revenus supplémentaires pour les ruraux. En fait, l’accroissement du revenu dans le système coopératif va de soi dans la mesure où il regroupe les populations dans un cadre propice dans lequel la conjugaison des efforts tend vers la réalisation des investissements productifs dans les secteurs primaire et secondaire en vue d’obtenir un revenu mérité, plutôt que de se livrer à la spéculation en vue d’un profit injustifié et volatil. Par ailleurs, le coopératisme, en prônant le self-help et la solidarité, exhorte les Africains à monter leurs propres affaires dans tous les secteurs économiques afin de sortir du rang des travailleurs soumis à la politique néo-colonialiste de bas salaires. Il est donc évident que l’instauration de l’économie coopérative créerait un climat favorable à l’investissement, au maintien de la compétitivité et à l’accroissement de l’épargne intérieure. Immanquablement, l’expression des besoins existentiels locaux et l’engagement des coopérateurs à les satisfaire par leurs propres soins contribuera, sur le plan macroéconomique, à former une « demande effective » susceptible d’inciter les membres des sociétés coopératives à utiliser au maximum le potentiel économique national élevant, par contrecoup, le niveau de l’emploi et du revenu . Dans le même ordre d’idées, l’action coopérative amènerait les communautés rurales économiquement vulnérables à accroître leur influence afin d’obtenir des pouvoirs publics l’abolition des politiques économiques qui pénalisent jusqu’ici l’agriculteur et son milieu. Envisagé sous cet angle, la mouvance coopérative pourrait tellement déteindre sur les gouvernants qu’ils consentiront d’augmenter la part du budget consacrée au secteur agricole et à l’infrastructure rurale. Elle aura ainsi assez de poigne pour tenir la dragée haute au cartel dominant en vue de drainer vers l’agriculture d’importantes ressources en devises gaspillées dans les importations alimentaires et dans d’autres dépenses de fonctionnement du gouvernement . Une fois cette bataille héroïquement gagnée, les gens du peuple disposant d’un revenu plus élevé, pourront se départir de la pression de la misère et envisager des investissements à plus long terme, plus rentables. En tout état de cause, le mouvement coopératif mobilisera les paysans, agriculteurs ou artisans, dans des entreprises financièrement viables, offrant de garanties en nombre et en masse, susceptibles d’élargir leur accès aux crédits bancaires et coopératifs, tout en relevant le niveau de leur épargne, de leurs investissements directs et de leurs investissements de portefeuille grâce aux fonds communs de placement. Cela contribuerait à l’expansion des marchés financiers et à l’application des taux d’intérêts stables et réalistes. Devant la carence actuelle d’intermédiaires financiers ruraux, les coopératives de crédit peuvent efficacement restaurer la solidarité africaine et les techniques traditionnelles de tontines, de guichets mobiles, de garantie personnelle afin de lever l’épargne des populations évoluant dans le milieu rural et leur apporter le financement dont elles ont besoin. De toute façon, les caractéristiques propres des coopératives en font des intermédiaires financiers ruraux dynamiques en Afrique Subsaharienne. En principe, la qualité de leur gestion est garantie du fait du choix et du contrôle des gestionnaires par l’assemblée générale des membres, de l’indépendance vis-à-vis de l’Etat, de la participation de tous les coopérateurs, dans un esprit de self-help, à la collecte de l’épargne et au suivi du remboursement des crédits. Mais il y a plus. La prise en compte des intérêts des clients qui sont, en l’occurrence des coopérateurs, centre le fonctionnement des coopératives de crédits sur la manière dont les projets financés sont exécutés. En effet, la solidarité de tous envers chacun, d’une part, le contrôle et la sanction de chacun par tous, d’autre part, incitent les emprunteurs à réaliser les investissements rentables et à rembourser dans les délais les sommes empruntées. La limitation du taux d’intérêt au strict minimum permet de couvrir l’intégralité des coûts de financement, de fonctionnement et le risque de crédit afin de fournir des prestations à bas prix. Du reste, l’unité coopérative tant au niveau national qu’international intègre, de facto, les coopératives au système financier aux niveaux provincial, national et régional réduisant les risques financiers tout en apportant les techniques d’information et de gestion modernes. Ainsi, chaque union coopérative se doit de créer une coopérative de cautionnement pour la garantie des crédits accordés à la base par les coopératives d’épargne et de crédit. Particulièrement, l’engagement de tous les coopérateurs à porter remède aux pénuries de crédit dans leurs contrées avec les ressources communes reste le plus grand atout pour l’essor des intermédiaires financiers ruraux efficaces . Même dans le cas extrême des pays ne disposant pas de moyens suffisants de réglementation, de supervision, et de contrôle prudentiel des activités financières et bancaires, les coopératives en se ressourçant dans la culture africaine seront à même d’édifier un système financier protégé contre les risques d’insolvabilité. Néanmoins, il faudrait pour ce faire, que les gouvernements assainissent la gestion macroéconomique et adoptent une politique agricole cohérente et culturellement compatible, susceptible d’encourager l’initiative des communautés de base et l’investissement agricole. Dans cette perspective, Ils accorderaient aux coopératives et autres associations le soutien technique et financier et s’abstiendraient de les paralyser par des réglementations et contrôles administratifs excessifs ou par une législation trop restrictive. Cela impliquerait une réforme visant non seulement l’abolition des interventions sectorielles ou directes sur les prix agricoles, mais aussi la levée de la protection industrielle, et de toutes les mesures d’ordre macroéconomique qui pénalisent le secteur agricole. Cette approche globale passe notamment par l’ouverture des échanges commerciaux et le maintien des taux de change réels à un niveau compétitif susceptible d’encourager les exportations et de protéger dans une certaine mesure les activités qui font concurrence aux importations . Avant de conclure notre étude, il convient d’examiner comment l’action coopérative peut-elle relever le standard moral de la société. 8.6. Contribution au relèvement du standard moral et éducatif de la société africaine contemporaine Au cours du XIXe siècle, le triomphe du capitalisme industriel suscita en Occident une compétition sauvage qui bannit toutes les règles éthiques dans les affaires. La fièvre de l’accumulation de profit relégua l’homme au rang d’outil pour l’industrie. L’exploitation irresponsable des facteurs de production ainsi que la constitution de deux classes antagonistes (les capitalistes et les prolétaires) furent les conséquences forcées de cette déshumanisation de l’économie . C’est dans ce contexte que naquirent, en Europe et en Amérique du Nord, des idées novatrices comme le mouvement coopératif, lequel eut, entre autres, comme objectif de moraliser progressivement le mode de production de l’époque . L’Afrique noire, quant à elle, fut profondément affectée par cette perversion des rapports socioéconomiques. Comme nous l’avons développé dans le chapitre précédent, notre continent fut soumis, dès le XVe siècle, à une exploitation sordide de ses ressources humaines et naturelles, lui privant de toute initiative sur les plans économique, culturel et politique. Contre toute attente, ce système injuste a survécu aux indépendances africaines sous la forme d’une société capitaliste extravertie (économie d’enclave) assurant des gros profits aux étrangers et à la classe dirigeante au détriment des masses. Et pour comble de malheur, la révolution indépendantiste a engendré un anarchisme étatique, social, économique et religieux ainsi que le règne de l’obscurantisme et la perversion de valeurs africaines de solidarité, d’entraide et de responsabilité collective. C’est cette crise morale et spirituelle qui est, à la vérité, la cause principale de la débâcle économique et politique de l’Afrique. Pire encore, le vent de démocratie, qui souffle et emporte depuis 1990 les régimes dictatoriaux, n’a pas réussi à éveiller le patriotisme, le civisme et la participation des peuples à l’édification de l’Etat de droit, mais a plutôt exacerbé ce libéralisme anarchique conjugué avec la retribalisation des populations, la violence et la corruption frappant toute la société, partant de la famille à l’Etat en passant par l’entreprise, l’école, l’église et toutes les organisations de la société civile chargée de l’encadrement des masses. Ainsi déculturée, sans foi, ni loi, une génération de cadres s’obstine à croire qu’elle ne peut jouir de libertés plus larges qu’en abolissant tous les fondements socioéconomiques et politiques tout en répudiant les valeurs telles que la science, la probité et la sagesse . En fait, la corruption, la fraude et l’immoralité, en général, menacent non seulement la société africaine mais par-dessus tout, le système économique mondial. Elles faussent, comme nous l’avons souligné plus haut, les mécanismes de marchés tout en élevant les coûts des transactions commerciales entraînant ipso facto une affectation inefficace des ressources disponibles . Ces travers antisociaux ont indéniablement freiné le progrès même dans les pays qui étaient pourtant en plein essor. Dans les économies émergentes d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie, Philippines et Malaisie), le Krach monétaire de l’été 1997 et la récession qui en résulta ont eu le mérite de jeter un coup de projecteur sur les effets néfastes de la corruption, du copinage et du népotisme . Tandis qu’aux Etats-Unis, la succession des scandales financiers après la faillite frauduleuse de la société ENRON a porté préjudice aux salariés et aux actionnaires tout en sapant la confiance dans les marchés financiers. Face à cette crise, le Président Bush, dans le discours qu’il a prononcé le 09 juillet 2002 à New York, a souligné que l’Amérique avait le plus grand besoin, dans le domaine économique, des normes éthiques plus rigoureuses, et des lois strictes appliquées par des dirigeants d’entreprise responsables . En Afrique Subsaharienne particulièrement, le népotisme et l’incivisme perturbent les activités économiques en excluant, d’une part, les véritables entrepreneurs au profit de politiques, hauts fonctionnaires et leurs clientèles, en favorisant, d’autre part, le développement de l’économie souterraine et, partant, la fuite d’importants capitaux prélevés sur l’économie nationale. Etant enraciné dans la morale et la justice sociale, le système coopératif dispose des atouts pour transformer la société africaine actuellement en déliquescence. Sans développer un puritanisme de façade, l’esprit coopératif est à même d’y introduire des changements révolutionnaires dans les rapports économiques et sociaux. Le développement du mouvement coopératif en Afrique pourrait entraîner le relèvement du standard éducatif, moral et social des populations grâce aux vertus des principes coopératifs. Etant une institution d’éducation doublée d’une organisation commerciale, les coopératives les prépareront à évoluer dans une société autrement juste et dans laquelle règnera la collaboration plutôt que l’antagonisme . Comme à l’origine du mouvement coopératif sous la conduite des pionniers de Rochdale, la prolifération des sociétés coopératives dans tous les secteurs économiques, contribuera à moraliser les activités commerciales, surtout dans les pays de l’Afrique Subsaharienne où les affaires frisent la maffia et où on assiste à la constance des manœuvres dolosives usées par les administrateurs des sociétés au détriment des associés, par les employeurs aux dépens de travailleurs et réciproquement, par les contribuables, les fournisseurs, les assureurs, les intermédiaires spéculateurs à l’endroit de l’Etat , des clients, des assurés, des producteurs directs, ou inversement . Mais il y a plus : l’instauration de l’économie coopérative assainira certainement cet environnement socioéconomique en restaurant la confiance entre les agents économiques sans laquelle aucun investissement, donc aucun progrès n’est possible. En effet, le système coopératif cherche à établir des nouveaux rapports économiques en s’appuyant sur le service, l’entraide, les valeurs et besoins humains et non sur le profit, les rivalités et la possession du capital . Plus profondément, l’économie coopérative est à cheval sur le respect de la nature et de la dignité humaines. Elle fonde son existence avant tout sur l’élément humain, le capital étant relégué au rôle de serviteur. Ainsi, cherche-t-elle à rétablir l’homme dans son rôle moteur de l’économie. C’est pourquoi, nous sommes éminemment convaincu que le développement coopératif libérera la main-d’œuvre africaine de l’exploitation dont elle est l’objet de la part des entrepreneurs capitalistes depuis cinq siècles et l’embarquera dans les institutions coopératives où elle pourra, elle-même, domestiquer le capital et s’en servir. Ce faisant, l’on brisera les antinomies qui semblent persister entre les valeurs humanistes africaines et l’efficacité économique. Bien plus, l’on pourra tirer parti des synergies entre lesdites valeurs et l’idéal coopératif en vue d’un développement socioéconomique authentique. A terme, les Africains pourront reconstruire une nouvelle solidarité aux niveaux local, provincial, national et régional, et redonner ainsi vigueur au panafricanisme. Dans cette perspective, les principes coopératifs de suppression du profit et de limitation du taux d’intérêt du capital initial extirperaient l’égoïsme et la mégalomanie qui déshumanisent, de nos jours, les affaires. En exhortant les coopérateurs à la pratique de juste prix et de revenu mérité, et en combattant toute forme de monopole économique, le coopératisme freinera la spéculation pernicieuse au bénéfice des consommateurs qui pourront obtenir la valeur réelle de leur argent en marchandises ou en services sans y ajouter un profit injustifié. De même, les vendeurs percevront la valeur réelle ayant cours sur le marché de leurs produits ou services sans que cette valeur ne soit diminuée du montant du profit abusivement appliqué par un intermédiaire. Les travailleurs, les producteurs directs et les artisans pourront, pour leur part, bénéficier équitablement du fruit de leur travail. Il faut se rendre à l’évidence que le culte de l’effort productif contribuera à développer et à mobiliser les compétences individuelles dans une nouvelle société où les hommes seront classés selon leurs mérites. Cela pourra éventuellement inciter les populations africaines à se former et à se perfectionner dans un système d’enseignement adapté aux besoins de l’économie à l’instar du régime éducatif japonais . Par ailleurs, le développement de l’économie coopérative ne peut pas aller sans transformer l’ordre économique international en ce qu’il assurerait la promotion les échanges directs entre les coopératives des différents pays pratiquant des justes prix dans un esprit coopératif. En fait, l’arrivée des coopératives dans le commerce international, constitue pour l’Afrique la chance d’équilibrer les termes de l’échange de leurs exportations. Qui mieux est, la prolifération des coopératives dans tous les secteurs socioéconomiques place les autochtones en meilleure posture pour contrôler et développer le commerce intérieur. En corollaire, le développement de la production et du commerce intérieurs pourra libérer l’Afrique de la dépendance à l’égard des exportations et de l’emprise des puissantes sociétés multinationales, instaurant ainsi une plus grande justice dans les transactions commerciales internationales. Pour tout dire, l’action coopérative peut améliorer progressivement la valeur des hommes afin de les rendre indépendants, d’heureuse nature, confiants en leurs propres possibilités et leurs aptitudes à gérer les institutions socioéconomiques. Car, en Afrique, les institutions ont dans la plupart des cas, souffert de l’incurie de leurs animateurs . D’où le continent se retrouve dans l’impasse, laquelle se pose en termes d’interrogations suivantes : Comment bâtir une démocratie sans démocrates ? Une économie libérale sans libéraux ? Un système coopératif sans coopérateurs ? Un Etat sans hommes d’Etat ? Une Nation sans nationalistes ? Comment créer une société nouvelle et prospère sans hommes nouveaux et prospères ? Comment relever le niveau de la production sans producteurs directs ? En réponse à la carence susévoquée, les sociétés coopératives préparent les hommes à pratiquer dans leurs affaires et dans leur vie tout entière les vertus de travail productif, de probité, de justice, de partage, d’entraide, d’amour et de solidarité. Si bien qu’à mesure de leur participation dans la gestion de leurs sociétés, les coopérateurs deviendront suffisamment aguerris pour monter en première ligne sur tous les fronts de la lutte pour la sortie du continent noir de la déliquescence dans laquelle il est tombé depuis bientôt un demi-siècle. D’un point de vue strictement moral et spirituel, le mouvement coopératif pourra, dès lors qu’il sera réellement orthodoxe, apporter un contingent d’hommes d’envergure exceptionnelle, audacieux, capables de renverser les fatalités et de lever les obstacles spirituel, mental, culturel, politique et économique qui contrarient le développement de l’Afrique. Au niveau de l’administration publique, il poussera les fonctionnaires et autres agents de l’Etat à se départir, dans leurs rapports avec les administrés, des manières autoritaires et peu amènes héritées du régime colonial. Force est de constater que le mouvement coopératif parviendra, en se développant, à restaurer le communautarisme et les valeurs humanistes qui firent jadis le puritanisme et la prospérité des royaumes africains précoloniaux. Aujourd’hui encore, la conjonction de la soumission au Dieu Tout - Puissant, de la responsabilité solidaire, des palabres démocratiques, de la structure sociale traditionnelle, de la promotion collective, de la tradition de transparence dans la gestion des finances publiques et de la justice coutumière punissant sévèrement l’incivisme, le vol et la corruption, peut avoir une influence moralisatrice dans la vie socioéconomique et politique de l’Afrique moderne . En fin de compte, le coopératisme renouerait implicitement avec les impératifs d’une existence croyante. Témoignant en effet leur foi, les coopérateurs brilleront par une solidarité active, une hospitalité agissante et une morale vivante. Et la vie tout entière deviendra, pour eux, un Mémorial des actions pour le salut de l’âme et pour le progrès social . En combattant, en effet, le règne de la société sauvage par le culte de l’amour, la fraternité, la solidarité, l’intégrité, la responsabilité, le travail productif, le mérite et le partage, les néo-coopérateurs remettront en exergue les dix commandements divins sans lesquels aucune société véritablement humaine et démocratique ne peut prospérer . C’est pourquoi, nous ne pouvons clore ce chapitre sans insister sur la qualité des hommes qui devront animer le mouvement coopératif africain. De même que tout système vaut souvent plus par la noblesse d’esprit des animateurs que par la perfection de ses assises doctrinales, les institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer. L’élite africaine devrait barrer la route à tous les commerçants véreux, aux fonctionnaires et politiques, personnalités scientifiques ou mercenaires de tous bords qui, comme cela se fait de nos jours, s’engageraient dans le mouvement coopératif en vue de le détourner à leur profit, ou qui créeraient des entreprises individuelles camouflées sous la forme juridique de société coopérative en dehors de tout esprit coopératif et dans l’ignorance des principes coopératifs de gestion. Il importe que ce mouvement soit animé par des hommes pour le moins sérieux, voire honnêtes, en tout cas pieux . Des hommes qui, dans toute leur action, cherchent à faire la volonté de Dieu, celle de bâtir pour l’homme, sa meilleure créature, un monde prospère, débarrassé de la misère, de l’exploitation, de l’esclavage, de la dictature, de l’obscurantisme, de l’impiété, de l’idolâtrie, de la corruption, de l’injustice, de l’égoïsme, de la guerre, des rivalités, du mensonge et de tous les maux semblables . Seuls, ces hommes complètement transformés pourront effectivement vivre à la hauteur des principes coopératifs et remplir les exigences républicaines et démocratiques à savoir : le droit, la justice, l’équité, l’éthique, la transparence, la responsabilité, la solidarité, la liberté, l’autogestion…. Du coup, le problème du développement socioéconomique tourne au spirituel avec un rôle catalyseur à l’Eglise qui, loin de cultiver l’hypocrisie et la résignation passive, a la charge d’induire le changement des mentalités en instruisant les masses et en forgeant leur conscience en tant que soldats du Christ, citoyens, parents, enfants, gouvernants, fonctionnaires, producteurs, coopérateurs,… La formation du clergé, des religieux et des laïcs devra mettre l’accent sur la doctrine sociale de l’Eglise. Chacun selon son état apprendra ses droits et ses devoirs, le sens et le service du bien commun, la gestion honnête de la chose publique, sa manière propre d’être présent à la vie politique, de façon à intervenir de manière crédible face aux injustices sociales . Il est manifeste que partout où l’évangile est occulté, l’obscurantisme, la déviance, l’idolâtrie et le mal envahissent l’église et les institutions publiques. Dès lors, il faudrait une révolution morale et spirituelle pour assainir l’environnement sociopolitique et économique à l’effet de retrouver la voie du progrès et d’un ordre social juste . Dans le domaine de l’éducation, le mouvement coopératif doterait les gens du peuple des bases scientifique et technique et, qui mieux est, les rendrait capables de s’adapter aux changements accélérés que connaît notre époque sous tous les rapports. En ajustant le revenu des coopérateurs par le biais de l’accroissement de leur productivité et, surtout, en créant les infrastructures de base qui les délivrent des corvées quotidiennes, le système coopératif les incitera à la formation et au perfectionnement ainsi qu’au recours à la main-d’œuvre qualifiée surtout dans le secteur agricole. Particulièrement, l’abolition de toute discrimination à l’égard des femmes dans la gestion des coopératives, permettrait à ces dernières de générer un revenu qui leur est propre, lequel pourra être affecté prioritairement à l’éducation et à la nutrition des enfants . Par contrecoup, le développement coopératif constituerait un capital de connaissances scientifiques et techniques susceptible de promouvoir la participation des masses à la vie économique et politique de la Nation et aux échanges sur l’échiquier international. Ainsi, pourront éclore des brain-trusts, des bureaux d’études, des observatoires pilotant les réformes politiques, macroéconomiques, fiscales, financières et commerciales afin d’édifier un environnement stable et propice à la croissance de l’investissement et de la production du secteur privé. Cela susciterait l’intérêt des coopérateurs pour l’enseignement et leur engagement dans l’amélioration de l’infrastructure éducative notamment par la création d’écoles populaires gérées coopérativement. En outre, ils participeraient à la révision des matières enseignées en vue de bénéficier directement, dans leurs affaires, des apports technologiques et managériaux. A cette fin, ils pourraient obtenir, à moindres coûts, la généralisation de la scolarisation primaire et le renforcement de l’éducation générale prônant le développement du sens critique, de la capacité d’auto-apprentissage des techniques et valeurs ainsi que la renaissance culturelle de l’Afrique. En outre, l’amélioration de la production alimentaire aura une incidence directe sur la capacité des enfants à apprendre. Aussi, les programmes seraient-ils réorientés à leur initiative en vue de : privilégier la connaissance du milieu et de la culture pour une utilisation rationnelle des ressources locales ; instituer un système d’enseignement participatif à l’instar du système d’initiation traditionnelle prônant l’uniformisation des techniques d’apprentissage en vue de doter chaque citoyen d’un bagage technique et scientifique nécessaire à son insertion sociale. En outre, il devrait cultiver la contradiction scientifique et le sens critique à grand renfort de la sagesse populaire traditionnelle afin de développer les talents individuels, la personnalité et le savoir-faire des élèves ; associer l’école aux activités socioéconomiques notamment la création et l’amélioration de l’infrastructure économique et sociale, (institution de recherche et de vulgarisation, travaux communautaires, production des intrants agricoles, encadrement agricole et sanitaire, logement, …) ; adapter les techniques traditionnelles tout en assimilant les techniques modernes notamment l’informatique ; renforcer la formation morale et spirituelle alliée à la rigueur scientifique ainsi que l’exaltation de l’humanisme, de la responsabilité, du sens civique et de la discipline. De sorte qu’au plus tard à l’âge de 18 ans que chaque individu soit doté du background intellectuel et moral ainsi que d’une bonne conscience en vue d’arrêter lui-même ses options fondamentales et de se réaliser dans sa vie sociale, professionnelle, politique, … Tout compte fait, la réforme de l’enseignement dans une perspective coopérative pourra déclencher une révolution sociale susceptible de lever les obstacles au développement de l’Afrique Subsaharienne . Elle devra conjurer la primauté d’une formation platonique afin de mieux armer les élèves dans la compétition économique internationale. Car le grand but de l’éducation, disait Herbert Spencer, n’est pas le savoir, mais l’action . L’objectif serait donc de développer les aptitudes de l’individu dans sa sphère d’influence en vue d’une promotion personnelle et collective tout en préservant l’équilibre vital sur les plans spirituel, moral, scientifique et matériel. A l’optimum, les centres coopératifs urbains et ruraux seront pourvus de cadres d’un haut niveau scientifique et technique ayant une connaissance parfaite de l’environnement socioculturel et économique de l’Afrique afin d’y promouvoir des techniques managériales efficaces, tout en menant une action novatrice sur les matières et les technologies locales en vue d’une production conforme aux normes internationales de qualité et de prix. Comme l’a conclu John Maynard KEYNES, la prospérité économique d’une nation ne dépend pas de l’excellence de quelques individus, mais de l’échelle à laquelle on peut produire des hommes compétents et intègres dans toutes les professions . CONCLUSION Après quatre décennies consacrées au développement avec le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux, les résultats réalisés dans l’ensemble de l’Afrique Subsaharienne sont des plus médiocres. Plus d’un économiste incrimine d’emblée les facteurs tels que la dualité systémique, la dépendance extérieure, la persistance d’un régime de commerce international défavorable, l’insuffisance d’infrastructures de base, l’affectation irrationnelle des capitaux et de ressources humaines, la crise de l’endettement, la faiblesse de l’épargne et la réticence des investisseurs privés. Cependant, ces contre-performances sont trop troublantes pour ne pas y voir le signe de comportements culturels et politiques qui débordent le cadre de l’économique et mettent en cause les valeurs, les institutions et, en général, le système sociopolitique de l’Afrique postcoloniale, tant il a été observé, par ailleurs, l’inefficacité de l’Etat, la déliquescence de la moralité publique, la prévalence des conflits armés et de l’instabilité politique ainsi que le recours permanent aux idéologies étrangères inadaptées. A travers cette étude, nous avons souligné la dissonance entre les valeurs socioculturelles africaines et les fondements du libéralisme économique que les experts ultralibéraux se sont évertués à appliquer à l’Afrique Subsaharienne en tentant d’universaliser des réformes préétablies à l’ensemble des pays à travers le monde. En effet, cette inadéquation culturelle a bloqué le brassage de civilisations européenne et africaine et, partant, la mutation de la société traditionnelle africaine vers l’économie moderne d’échange, accouchant d’un système capitaliste extraverti, lequel a amplifié les travers et les contradictions hérités de la colonisation. Pire encore, l’ouverture de l’économie, consécutive à la mondialisation, n’y a fait qu’exacerber la vulnérabilité économique et sociale du fait de l’intensification de la concurrence internationale. Dans ces conditions, la relance économique de l’Afrique Subsaharienne nécessite des innovations stratégiques en vue d’une réforme systémique. Ainsi, nous avons, pour notre part, posé un regard critique sur l’histoire de cette région aux fins d’élaborer une stratégie de secours efficace. En effet, au cours de cinq siècles d’esclavage et de colonisation, les puissances européennes ont détruit avec acharnement une partie des structures coutumières et des formations politiques précoloniales et ont maintenu les Africains dans un état de subordination politique, économique et sociale qui explique largement la persistance de la pauvreté des masses dans leur continent. Face à cette situation dramatique et suivant le cheminement de la pensée de nos devanciers africains, nous avons tenté de traduire en réalités sociopolitiques et économiques les vertus et atouts du coopératisme. De manière prospective, nous avons relevé dans cet essai, ce que serait la contribution du système coopératif à la résolution des problèmes structurels et institutionnels ainsi qu’à la levée des entraves endogènes et exogènes qui brident la croissance économique de nombreux pays africains. En fait, le système coopératif, contrairement au libéralisme, ne combat pas les valeurs socioculturelles africaines. Il prône, à l’instar du collectivisme millénaire traditionnel, la solidarité, l’entraide, le self-help, la sociabilité, l’équité, la probité et la démocratie, lesquels sont, entre autres, les éléments formateurs de la culture africaine. A ce titre, il pourra, sur une base communautaire, favoriser toutes les réformes socioéconomique et politique qu’exigent la gravité de la situation du continent, par des méthodes évolutionnistes et pacifiques, en sauvegardant la richesse culturelle de l’Afrique, la cohésion sociale et l’équilibre entre les forces sociales nationales, l’Etat et les investisseurs étrangers ou les sociétés transnationales. De plus, le choix dudit système s’impose dans le domaine de l’agriculture, d’autant que la production agricole est, par essence, soumise au travail du groupe. C’est précisément en réussissant à déclencher le développement agricole dans un continent qui a une vocation essentiellement agricole, que le mouvement coopératif fournira à l’immense majorité des Africains les moyens indispensables à la création, au fonctionnement et à l’entretien des équipements et les divers services, faisant des communautés villageoises, des vrais pôles de développement économique. A la bonne heure, ce sera la renaissance de l’Afrique précoloniale, avec ses structures unionistes et ses valeurs morales qui constituent l’humanisme africain. Cette vision africaniste, si singulière soit-elle, constitue le fil conducteur de notre démarche. C’est pourquoi, dans un environnement international marqué par une forte tendance à l’uniformisation, nous avons mené une étude ontologique de la société africaine précoloniale aux fins d’asseoir le particularisme africain. Cependant, cette démarche nous a plutôt rapproché du coopératisme, lequel constitue un système à part entière, ayant sa propre philosophie soutenue par un esprit particulier. Loin d’être l’ultime recours des masses désespérées, le système coopératif joue un rôle influent et décisif dans les rapports économiques, en faisant des simples acheteurs, clients, usagers, artisans ou paysans des véritables entrepreneurs. Mieux encore, il est porté naturellement à développer les capacités d’organisation et de gestion des gens du peuple dans le but d’investir les principaux secteurs de l’économie et d’occuper une position déterminante dans une économie nouvelle : « l’économie coopérative » dans un « Etat coopératif ». En vue de donner à un large public les clés de lecture du coopératisme, nous avons auparavant défini les caractéristiques de la société coopérative en évoquant l’histoire de la coopération à partir de 1844 à Rochdale, en Angleterre, avec la fondation de la « Société des Equitables Pionniers de Rochdale », et enfin, en relevant les réalisations du mouvement coopératif à travers le monde où il a permis à l’homme de créer la vie, la richesse, le bonheur et l’abondance dans un environnement naturel difficile comme en Israël ou en Suisse. Bien qu’il n’ait pas encore eu un impact sur l’évolution de l’économie africaine à cause des contraintes juridiques et de politiques macroéconomiques paralysant le monde rural, le système coopératif, grâce aux vertus de ses principes, dispose des atouts pour susciter le développement global, intégré et endogène de l’Afrique Subsaharienne ainsi que l’avènement de l’homo Africanus, pétri des valeurs culturelles africaines, et voué au progrès de la collectivité et à la protection de son environnement. Ainsi, le coopératisme africanisé grâce à un apport des valeurs et techniques traditionnelles assurera l’introversion des structures socioéconomiques et politiques de notre continent en résorbant le dualisme systémique qui demeure le dilemme essentiel du sous-développement. En effet, les réformes sous la bannière du mouvement coopératif tonifieraient la dynamique de la production des secteurs informel et rural de manière à inciter les communautés villageoises à opérer rapidement et profondément leur mutation vers la modernité économique. Ce faisant, les Africains contrôleraient les secteurs économiques prépondérants, notamment la gestion des ressources naturelles, réduisant la dépendance extérieure et mettant un terme à la distribution asymétrique des revenus entre les citadins et les ruraux, entre les expatriés et les nationaux, de même que dans chacun de ces groupes sociaux. D’autant que les coopératives diffuseront parmi les populations les réflexes et l’esprit de solidarité permettant de retenir les capitaux nationaux et, qui mieux est, de drainer, à des conditions avantageuses, les capitaux étrangers. S’appuyant sur la puissance induite par l’union des forces, les institutions coopératives concourront à fédérer les masses populaires, en dehors de toute discrimination, en vue d’exercer plus d’initiative dans l’amélioration de leur existence devenant, de facto, les forces motrices de la croissance économique. C’est dire que la création d’entreprises coopératives, conçues et gérées par lesdites forces, pour leurs propres besoins, les amènera à accumuler les richesses dans le cadre de leur communauté de base, en conjurant le risque de dislocation et de fracture sociale et, par contrecoup, en résorbant la lourde réserve des chômeurs tant en villes que dans les campagnes. Car, comme Michel NORRO le souligne, les premières phases du développement devraient être non pas tant la croissance que la cohérence, c’est-à-dire, une mutation profonde de l’ensemble des structures de production, en découvrant les complémentarités cachées, les aptitudes, les ressources et les potentialités insoupçonnées en vue d’améliorer l’efficacité économique du pays. Par ailleurs, l’organisation des coopératives à tous les échelons de la territoriale favoriserait la décentralisation du pouvoir économique et politique et, par ce faire, accroîtrait le poids politique des populations. L’expérience de gestion des coopératives instituerait dans ces institutions-phares, la pépinière des nouveaux dirigeants politiques, rompus dans les techniques modernes, soucieux de l’intérêt général, respectueux de la légalité, modelés par la culture africaine et vivant en symbiose avec leurs administrés, lesquels partagent ensemble une longue et exaltante aventure dans la recherche des solutions à leurs problèmes vitaux, dans un esprit d’entraide et de self help. Nous sommes éminemment convaincu que le mouvement coopératif, lorsqu’il est mené par des vrais coopérateurs, animés d’un esprit conformiste, finira par lever les entraves structurelles, politiques, techniques, financières et commerciales qui brident le développement du secteur agricole en Afrique Subsaharienne. A la vérité, l’action coopérative mettrait à contribution l’expérience millénaire du communautarisme, lequel assurait la mise en commun des moyens de production, la stabilité de la productivité et la répartition équitable des récoltes. En effet, le développement agricole rime avec le développement communautaire, et partant, toute stratégie visant uniquement l’épanouissement de quelques agriculteurs de pointe serait vouée à l’échec. En tout état de cause, le coopératisme mobilisera les paysans, agriculteurs ou artisans, dans des entreprises financièrement viables, offrant de garanties en nombre et en masse, susceptibles d’élargir leur accès aux crédits bancaires et coopératifs, tout en relevant le niveau de leur épargne, leurs investissements directs et leurs transactions de portefeuille grâce aux fonds communs de placement. Face à la dépravation des mœurs administratives et politiques ainsi qu’à la perversion des rapports socioéconomiques, le système coopératif africain présente des atouts pour relever le standard moral et éducatif des masses. Celles-ci pourront, au travers de principes coopératifs et de débats démocratiques organisés lors des assemblées générales, développer leurs capacités managériales et parfaire leur connaissance de l’environnement sociopolitique et économique, tout en montant en première ligne de front dans la campagne contre la fraude, la corruption, l’incivisme, l’injustice, l’exploitation irresponsable des facteurs de production, ainsi que contre toutes sortes de discriminations, d’antagonismes et de conflits sociaux. A la faveur de cet assainissement de l’environnement socioéconomique, les coopérateurs africains restaureront la confiance entre les agents économiques, tant publics que privés, aussi bien nationaux qu’étrangers, sans laquelle (confiance) aucun investissement, donc aucun progrès n’est possible. Etant un système économique doublé d’une institution d’éducation, le coopératisme introduira, sans doute, des changements révolutionnaires dans les rapports économiques et sociaux en s’appuyant sur le service, l’entraide, l’équité, les valeurs et besoins humains et non sur le profit, les rivalités et la possession du capital. Sans doute, il brisera les antonymies qui semblent persister entre les valeurs humanistes africaines et l’efficacité économique. Bien plus, il permettra de tirer le meilleur parti des synergies entre le système traditionnel africain, la doctrine coopérative et les fondements spirituels chrétiens en vue de la relance économique de l’Afrique Subsaharienne. Considérant les atouts du « coopératisme », nous exhortons tous les gouvernements africains à s’engager dans la campagne mondiale de coopération contre la pauvreté, en suivant le mot d’ordre de l’O.I.T. et de l’A.C.I. : « coopérer pour sortir de la pauvreté ». BIBLIOGRAPHIE I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES 1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Document de l’OUA du 27 juin 1981 in ZAIRE-AFRIQUE [CONGO-AFRIQUE] n°191, CEPAS, KINSHASA, janvier 1985, pp.31-40. 2. Loi n° 002-2002 portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de crédit, Journal Officiel de la RDC, n° spécial, mai 2002. 3. Code de Commerce, Tome 1, Les textes coordonnés des décrets du 27/2/1887, 4/5/1912, 16/2/1922, 25/4/1925, 10/11/1949, 23/6/1960, 284 pages. 4. Décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, Les Codes LARCIER de la RDC, Tome III, Vol 1, 2003. 5. Décret du 23 mars 1921 relatif aux sociétés coopératives et sociétés mutualistes, Les Codes LARCIER de la RDC, Tome III, Vol 1, 2003. 6. Décret du 16 août 1949 portant principes généraux régissant l’agrément et le fonctionnement des coopératives au Congo Belge et Ruanda-Urundi. 7. Décret du 4 mars 1956 portant autorisation de création des coopératives indigènes. 8. Ordonnance du 1er juillet 1885 portant charte foncière coloniale. 9. Ordonnance 21-235 du 8 août 1956 relative à la forme des statuts des coopératives indigènes, Les Codes LARCIER de la RDC, Tome III, Vol 1, 2003. II. OUVRAGES 1. ABOLIA, J.M., « Finances et comptabilité de l’Etat en République Démocratique du Congo », Becif, Kinshasa, 2005, 472 pages. 2. ADADEVOH, D., « Entre à l’avant-garde des réformes en Afrique », International Leadership Foundation, Orlando, 2006, 106 pages. 3. ADJAHO, R., « La faillite du contrôle des finances publiques au Bénin, 1960 à 1990 », Flamboyant, Paris, 1992, 206 pages. 4. AZAMA LANA, « Droit fiscal Zaïrois », CADICEC, Kinshasa, 1986, 400 pages. 5. BABA KAKE, I. et al., « Conflit belgo-zaïrois [congolais] », Présence africaine, Paris, 1990, 206 pages. 6. BELLON, B., « Interventionnisme libéral : la politique industrielle de l’Etat fédéral américain », Economica, Avril 1986,175 pages. 7. BINET, J., « Psychologie économique africaine », Payot, Paris, 1970. 8. BOUGI, A., « La Générale de Belgique ou la Stratégie de l’araignée » dans l’ouvrage collectif « Conflit belgo-zaïrois [congolais] », Présence africaine, Paris, 1990. 9. BURGENMEIER, B., « Analyse et Politique économiques », 3ème Edition, Economica, Paris, 1989, 472 pages. 10. CASTELAIN, L., « éléments de Droit commercial », A. DE BOECK, Bruxelles, 1970. 11. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, «Instruction sur la liberté chrétienne et la libération », Saint Paul Afrique, Kinshasa, 1986, 59 pages. 12. DACIER, P., LEVET, J. L. et TOURRET, J. C., « Les dossiers noirs de l’industrie française : échecs, handicaps, espoirs », FAYARD, 1985, 409 pages. 13. DAVIDOVIC, G., « Vers un monde coopératif », édition du jour, OTTAWA ,1975. 14. DOGBE, Y. E., « Participation populaire et développement », Edition AKPAGNON, Nîmes, 1983, 140 pages. 15. ELIKIA MBOKOLO, « Le Congo, Colonie modèle » dans l’ouvrage collectif « Conflit belgo - zaïrois [congolais] », Présence africaine, Paris, 1990. 16. GALBRAITH, J.K., « Les conditions du développement économique », Nouveaux Horizons, Paris, 1964, 152 pages. 17. GEISER, W., « Comment découvrir la volonté de Dieu ? », St-Johannis, Lahr, 1982. 18. GUICHAOUA, A., « Destins paysans et politiques agraires en Afrique Centrale », Harmattan, Paris, 1989, 208pages. 19. HETMAN, F., « Les secrets des géants américains », Seuil 1969. 20. KAZADI NDUBA wa DILE, « Politiques salariales et développement en République du Zaïre [RDC] », PUZ, Kinshasa, 1973, 478 pages. 21. KIMPIANGA MAHANIAH, « Les coopératives au Zaïre [RDC], cas du Manianga, un milieu rural du Bas-Zaïre », Centre de vulgarisation agricole, Kinshasa, 1992. 22. LAJUGIE, J., « Les Doctrines économiques », Presses Universitaires de France, Paris, 1960, 136 pages. 23. LEMEUNIER, F., « Comment constituer et gérer une société coopérative », MASSON, Paris, 1983, 416 pages. 24. LENOIR, R., « Le Tiers- Monde peut se nourrir », Fayard, 1984. 25. LEWIS, A., « L’ordre économique international : Fondements et Evolution », Economica, Paris, 1981. 26. LUKOMBE NGHENDA, « Droit et développement agricole : étude du droit agricole », Publications des Facultés de Droit des Universités du Congo, Kinshasa, février 2004, 992 pages. 27. MARCHENKO, G., « Karl Marx Inconnu », société san Parlo, Alba-in, Italie, 1981, 110 pages. 28. MARQUET, E., KAKE, I. B. et SURET-CANALE, J., « Histoire de l’Afrique centrale : Des origines au milieu du 20ème siècle », Présence africaine, Paris, 1970. 29. McDOWELL, J., « Bien plus qu’un charpentier », VIDA, Deerfield, Floride, 1994, 128 pages. 30. Mc MILLEN, S.I. M.D., « Maladie ou santé à votre choix », M. WEBER, HAUTE-Savoie, 1973, 202 pages. 31. MEIDINGER, C., « La nouvelle économie libérale », Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 1983, 280 pages. 32. NORRO, M. et al. , « Indépendance, inflation, développement : l’économie congolaise de 1960 à 1965 », IRES, MOUTON, PARIS, 1968, 865 pages. 33. OBENGA, T., ‘’Afrique centrale précoloniale’’, Documents d’histoire vivante, Présence Africaine, Paris, 1974. 34. PERROUX, F., « Pour une philosophie du nouveau développement », Editions AUBIER-MONTAIGNE, Presses de l’UNESCO, Paris, 1981. 35. RAISON, P., OUDIN, R. et FIDHER, R., « Cours de Géographie : Les grandes puissances du monde », ARMAND COLIN, Paris, 1964, 368 pages. 36. ROCHAT, J. D., « Comment bien gérer son capital de vie ? Cœur-âme-pensée-force…», CARREFOUR, Chailly s/ Montreux, 2003, 199 pages. 37. ROSTOW, W.W., « Les étapes de la croissance économique », Seuil, 1970, 256 pages. 38. SCHELESINGER, A. M., « En parcourant l’histoire américaine ». 39. SCHUMPETER, J.A., « Histoire de l’analyse économique », Gallimard, Tome 1 : L’âge des fondateurs, Paris, 1983, 520 pages. 40. SQUIRE, L. et VAN DER TAK, H.G., « L’analyse économique des projets », Economica, Paris, 1977, 164 pages. 41. SORMAN, G., « La nouvelle richesse de Nations », Fayard, Paris, 1987. 42. UMBA-di-NDANGI, « Finances publiques », BECIF, Kinshasa, 2006, 427 pages. 43. ZAMENGA BATUKEZANGA, ‘’Souvenirs du village’’, Roman, Saint Paul d’Afrique, Kinshasa, 1982, 112 pages. 44. ZERBATO, M. et al. , « Keynésianisme et sortie de crise : Keynes contre le libéralisme ? », Dunod, Paris, 1987, 268 pages. III. ARTICLES . 1. AYLWARD, L., « From Subsistence to Exchange and other essays » in Finances et Développement, juin 2001. 2. BHATTACHARYA, A., MONTIEL, P. J. et SHARMA, S., « Afrique Subsaharienne : comment attirer davantage des capitaux privés ? » in Finances et Développement, juin 1997. 3. BIRDSALL, N., « Une banque indispensable », critique du livre de SEBASTIAN MALLABY : « The world’s Banker », in Finances et Développement, mars 2005, pp.50-51. 4. BLAKE, R. O., « Les défis de la recherche agricole dans le monde »in Finances et Développement, mars 1992. 5. BONAZZA, P. et WEBER, O., « Asie du Sud-Est, les « tigres » dans la tourmente », in Hebdomadaire d’information LE POINT n° 1306 du samedi 27 septembre 1997, pp. 72-78. 6. BOUGTHON, J.M. et QURESHI, Z., « Revitaliser les objectifs de développement pour le Millénaire », in Finances et Développement, septembre 2004, pp. 42-44. 7. BROOKS, K. et LERMAN, Z., « Réforme agricole dans les économies en transition » in Finances et Développement, décembre 1994. 8. CASHIN, P., MAURO, P. et SAHAY, R., « Politiques macroéconomiques et réduction de la pauvreté », in Finances et Développement, juin 2001, pp. 46-49. 9. CHANDAVARKAR, A., « Un nouveau regard sur Keynes » in Finances et Développement, décembre 2001, pp. 60-63. 10. CHHIBBER, A., « L’Etat dans un monde en mutation » in Finances et Développement, septembre 1997. 11. CLEMENT, J. A. P., « Comment retrouver la stabilité : le réalignement du franc CFA » in Finances et Développement, juin 1994. 12. DORCE, F. et TALLA, B. P., « Ces hommes qui pillent le continent » in Jeune Afrique Economie n° 241 du 19 mai 1997, GIDEPPE, pp.50-69. 13. EASTERLY, W. et PRITCHETT, L., « Les déterminants de la réussite économique : le rôle du hasard et du gouvernement. » in Finances et Développement, Décembre 1993, pp.38-41. 14. FINANCES ET DEVELOPPEMENT, « Le commerce agricole mondial : cueillir en abondance les fruits de Doha », Décembre 2004, pp. 34-35. 15. GOSME DIKOUME, « Stratégie du développement rural en Afrique », in Cahiers économiques et sociaux, Vol. XVI n°3, PUZ, Kinshasa, septembre 1978. 16. HAFEZ et GHANEM WALTON, « L’avenir des travailleurs dépend des débouchés extérieurs et de l’action des pouvoirs publics » in Finances et Développement, septembre 1995, pp. 3-6. 17. HANNA, N., « L’informatique et les pays en développement », in Finances et Développement, décembre 1991. 18. HARMESEN, R., « L’Uruguay Round : une manne pour l’économie mondiale » in Finances et développement, mars 1995, pp. 22-24. 19. HARRISON, G., RUTHER, T. et TARR, D. « Evaluation chiffrée des résultats de l’Uruguay Round », in Finances et Développement, décembre 1995, pp. 36-39. 20. HELLMAN, J. et KAUFMANN, D., « La captation de l’Etat dans les économies en transition : un défi à relever » in Finances et Développement, septembre 2001, pp. 31-35. 21. HERNANDEZ-CATA, E., « Afrique Subsaharienne : politique économique et perspectives de croissance » in Finances et Développement, mars 1999, pp. 10-13. 22. HONDT, L. D., « L’orient perdu du monde salarial », publié au journal LA LIBRE ENTREPRISE du samedi 3 mai 1997. 23. ISRAEL, A., « Gestion et Développement des Institutions », in Finances et Développement, septembre 1983, pp.15-18. 24. JONES, C. et KIGUEL, M. A., « L’Afrique en quête de prospérité : l’ajustement a-t-il eu des effets positifs ? », in Finances et Développement, juin 1994. 25. KABEYA TSHIKUKU, « Sous-développement, dépendance, transition au développement » in CES, Vol XVIII, n° 2, PUZ, Kinshasa, 1980. 26. KAYEMBA NTAMBA - MBILANJI, « L’impuissance de l’Afrique noire Post-coloniale », CES, VOL. XV, n° 4, PUZ, Kinshasa, 1977. 27. LAGARDE, D. et MESMER, P., « Japon : les nouvelles fractures » in Journal EXPRESS n° 2777 du 20 au 26 Septembre 2004, pp. 38-45. 28. LANDEL-MILLS, P., « Etudes prospectives nationales en Afrique ou la vision d’un avenir meilleur » in Finances et Développement, décembre 1993. 29. LANDEL-MILLS, P., « Gestion : un frein au développement » in Finances et Développement, septembre 1983. 30. LANJOUW, P., « Infrastructure et ascension sociale des pauvres », in Finances et Développement, mars 1995. 31. LUTETE MVUEMBA, « Nationalisme, indépendance économique et mondialisation : l’urgence de la politique d’intégration de l’économie congolaise aux marchés internationaux», in journal LE POTENTIEL n°1485 et 1486 des 2 et 3 décembre 1998. 32. LUTETE MVUEMBA et LETA KABASELE, « Evolution historique du système de contrôle des finances publiques et ses conséquences sur la situation socioéconomique et politique de la RDC » in journal LE POTENTIEL n° 2491 du 9 avril 2002. 33. MAMADOU DIA, « Développement et valeurs culturelles en Afrique subsaharienne » in Finances et Développement, décembre 1991. 34. MANUEL, T. A., « L’Afrique et le consensus de Washington : trouver la bonne voie », in Finances et Développement, septembre 2003, pp. 18-20. 35. MUBAKE MUMEME, « Crise, Inflation et comportements individuels d’adaptation au Zaïre [RDC] : solution ou aggravation du problème », in revue ZAIRE-AFRIQUE [CONGO-AFRIQUE] n°185, CEPAS, Kinshasa, mai 1984. 36. MUKOKA NSENDA, « Problématique de l’application des méthodes et techniques modernes de gestion dans l’administration publique zaïroise [congolaise]» in CES, Vol. XVIII n° 2, PUZ, Kinshasa, 1980. 37. MUYAYALO-VATI, « Paradoxe de l’industrialisation en Afrique » in CES, vol XVIII n° 2, juin 1980. 38. NDONGALA TADI LEWA, « Quelques traits d’organisation économique Kongo au seuil de la colonisation belge, vue au travers des études Kongo du Révérend Père VAN WING, CES, Vol. XVIII n° 3-4, septembre, décembre 1980. 39. NSOULI, S. M., « Ajustement structurel en Afrique Subsaharienne » in Finances et Développement, septembre 1993. 40. OSTRY, J. D. et REINHART, C. M., « Epargne et taux d’intérêt réels dans les pays en développement » in Finances et Développement, décembre 1995. 41. PENNANT-REA, R. et HEGGIE, I., « Commercialiser les routes », in Finances et développement, décembre 1995. 42. QUICK, P. J., « Blanchiment de l’argent et stratégies macroéconomiques » in Finances et Développement, mars 1997, pp. 7-9. 43. QURESHI, Z., « Mondialisation : des chances à saisir, des écueils à éviter » in Finances et Développement, mars 1996, pp. 30-33. 44. SALOP, J., « La lutte contre la pauvreté » in Finances et développement, décembre 1992. 45. SCHIAVO-CAMPO, S., « Réformer la fonction publique », in Finances et Développement, septembre 1996. 46. SCHIFF, M. et VALDES, A., « L’agriculture, grande sacrifiée dans les pays en développement » in Finances et Développement, mars 1995, pp. 42-45. 47. SERAGELDIN, I., « Pour un développement durable », in Finances et Développement, septembre 1983. 48. SHOME, P., « Réformes fiscales en Amérique Latine » in Finances et Développement, mars 1995. 49. SORMAN, G., « SWAMINATHAN , le père de la révolution verte », in Jeune Afrique Plus, Mai-Juin 1990, n° 6, p.90. 50. SUBRAMANIAN, A., « Un économiste militant », in Finances et développement, juin 2006, pp.4-7. 51. SUMMERS, L. H., « Les défis du développement » in Finances et Développement, mars 1992, pp. 6-7. 52. TIKER TIKER, « Agriculture zaïroise [congolaise], de la stagnation à la régression » in CES, Vol. XVIII n° 3 et 4, PUZ, Kinshasa, 1980. 53. TIKER TIKER, « Le concept du développement rural dans le processus du développement économique du Zaïre [RDC] », in Cahiers Economiques et Sociaux, Vol XVI n°3, PUZ/Kinshasa, septembre 1978. 54. TIZIANO RAFFAELLI, « Order and creativity in Marshall ‘s views of social progress », Kwansei Gakuion Univesity, Annual Studies, Vol. XLIV, Nishinomiya, Japan, 1995, pp. 200-207. 55. VITO TANZI, « La corruption, les administrations et les marchés » in Finances et développement, décembre 1995, pp. 24-26. 56. WALTON, M., « Asie de l’Est : l’enfant prodige devient adulte » in Finances et Développement, septembre 1997, pp. 7-10. 57. WOOT, P. D., « Il faut réinventer l’Europe » publié dans le journal La Libre Entreprise, du samedi 03 mai 1997. 58. YARON, J. et Mc DONALD B., « Le développement des intermédiaires financiers ruraux » in Finances et Développement, décembre 1997, pp. 38-41. 59. YEATS, A. J., AMJADI, A., REINCKE, U. et FRANCIS NG., « A quoi tient la marginalisation de l’Afrique Subsaharienne dans le commerce mondial ? » in Finances et Développement, décembre 1996, pp. 36-37. IV. AUTRES DOCUMENTS 1. ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL, « Recueil des cours 1947 », I. Tome 70 de la Collection, SIREY, Paris, 1948, 610 pages. 2. AGENCE D’INFORMATION DES ETATS-UNIS, « Esquisse d’une histoire des Etats-Unis d’Amérique », 1987, 210 pages. 3. ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE, « La sainte bible », version LOUIS SEGOND. 4. ASSOCIATION DE COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT EN AFRIQUE (ACECA), «Organisation et administration des coopératives d’épargne et de crédit », ACOSCA, NAIROBI, 65 pages. 5. BANQUE MONDIALE, « Etude sur les orientations stratégiques pour la reconstruction économique du Zaïre [R.D.C.] », novembre 1994. 6. BANQUE MONDIALE, « L’Afrique Subsaharienne : De la crise à la croissance durable », Washington, novembre 1989. 7. BANQUE MONDIALE, «Rapport sur le développement dans le monde 1992 ». 8. Banque Mondiale, « Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001 : combattre la pauvreté », abrégé, ESKA, Paris, 2001. 9. BAZA LUEMBA, « Cours de Théorie de l’échange international », UNIKIN, 1984-1985. 10. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COOPERATION (France), « Rapport de l’exercice 2000 », DIES. 11. DEUTSCHLAND, « Revue sur la politique, la culture, l’économie et les sciences », D 2000 3F n° 12/94 F1, FRANKFURTER, Sociëtas-Druckerei GmbH, 1994, 68 pages. 12. FEDERATION DE QUEBEC DES CAISSES POPULAIRES DES JARDINS, « Actes de la rencontre internationale de MONTREAL 5-6-7 Octobre ». F.R.C.P.D, Québec, Août 1976, 493 pages. 13. KABUYA KALALA, «Cours de Macroéconomie », UNIKIN, 1984-1985. 14. Le périodique Réveillez-vous, septembre 2006, WTBSB, Londres. 15. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, « Vers l’autosuffisance : la réforme des coopératives en Tanzanie », Reportage de ANDREW BIDDY, http : //fr.rd.yahoo.com/news/rs/ 16. PINEIRO HARNECKER, C., « Le nouveau mouvement coopératif vénézuélien », http : //risal.collectifs.net/ 17. PNUD/BANQUE MONDIALE, « Données économiques et financières sur l’Afrique », New York, 1990, 210 pages. TABLE DES MATIERES PREFACE………………………………………………………………….5 AVANT- PROPOS……………………………………….…………….. 11 INTRODUCTION…………………………………….………………… 17 PREMIERE PARTIE : LE SYSTEME COOPERATIF……………… 23 CHAPITRE PREMIER : NOTIONS GENERALES SUR LE SYSTEMECOOPERATIF ...…..……… 25 1.1. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES D’UNE SOCIETE COOPERATIVE ………..………………….25 1.2. HISTORIQUE DU COOPERATISME ..………………………27 1.3. PHILOSOPHIE DE LA COOPERATION…………………… 29 1.3.1. Philosophie de la coopération……………………………29 1.3.2. Esprit coopératif…………………………………………….31 1.4. LE SYSTEME COOPERATIF OU L’ECONOMIE COOPERATIVE .………………..……………. 33 1.4.1. Edification du système coopératif………………………..33 1.4.2. Le coopératisme et les autres systèmes……………….. 35 1.4.2.1. Le coopératisme et le capitalisme…………………… 35 1.4.2.2. Le coopératisme et le socialisme………………….. 40 1.4.2.3. Le coopératisme et le communisme………………… 47 1.4.3. Réalisations économiques à travers le monde…………..53 DEUXIEME PARTIE : LE PASSAGE DE LA SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE A LA MODERNITE ……………………………….... 73 CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA MUTATION DE LA SOCIETE TRADITIONNELLE AFRICAINE VERS L’ECONOMIE MODERNE …………..……….75 2.1. CONCEPTION CLASSIQUE DU DEMARRAGE ECONOMIQUE ………………………………………………. 75 2.2. LA SOCIETE AFRICAINE PRECOLONIALE .………………83 2.2.1. Aperçu historique de l’Afrique précoloniale………………83 2.2.1.1. Organisation politique, administrative et judiciaire ………………...…………………………. 84 2.2.1.2. Organisation socioéconomique……………………… 87 2.2.2. Originalité de l’humanisme africain………………………. 95 Chapitre III : LE SYSTEME CAPITALISTE EXTRAVERTI………… 97 CHAPITRE IV : LES CONTRAINTES DE LA RELANCE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ………………………………... 123 4.1. Blocage de la mutation du secteur agricole………………… 124 4.2. Prévalence des conflits armés et de l’instabilité politique .………………………….……………... 134 4.3. Inadaptation de l’idéologie libérale aux réalités profondes de l’Afrique .………………………………………. 140 CHAPITRE V : RECHERCHE D’UNE PHILOSOPHIE AUTHENTIQUE DU DEVELOPPEMENT ..…..... 155 5.1. Conception mécaniste et linéaire de l’histoire et du développement……..………………………………….. 166 5.2. Approche technologique de la gestion et du développement institutionnels……………………………..... 167 5.3. Approche ethnocentrique……………………………………. 169 5.4. Développement Global………………………………………... 171 5.5. Développement intégré……………………………………….. 173 5.6. Développement endogène…………………………………….174 5.7. Développement écologiquement viable…………………….. 177 TROISIEME PARTIE : LES ATOUTS DU COOPERATISME AFRICAIN …………………………………..181 CHAPITRE VI : RAISONS DE LA PREFERENCE DU SYSTEME COOPERATIF ...…….…….……. 183 CHAPITRE VII : ADAPTATION DU SYSTEME COOPERATIF AUX VALEURS SOCIOCULTURELLES AFRICAINES ………...…………………………….191 CHAPITRE VIII : ETUDE PROSPECTIVE DE LA CONTRIBUTION DU SYSTEME COOPERATIF A LA RELANCE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ……………………………....197 8.1. Contribution à l’introversion des structures socioéconomiques et à l’intégration du secteur rural …............................................................... 197 8.2. Exhortation à la participation populaire……………………. 204 8.3. Contribution à la création d’une nouvelle classe d’entrepreneurs …………….……………………...... 213 8.4. Contribution à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance………………..… 224 8.5. Contribution au développement du secteur agricole………237 8.5.1. Contribution à la croissance de la production agricole …………..……………….......... 242 8.5.2. Contribution au développement des marchés agricoles…………………………….….……… 251 8.5.3. Contribution à la création d’infrastructure économique et sociale ..………………………………….255 8.5.4. Apport dans l’accroissement du revenu agricole global et dans l’amélioration du niveau de vie en milieu rural ………………………….. 260 8.6. Contribution au relèvement du standard moral et éducatif de la société africaine contemporaine .………………………………………...… 264 CONCLUSION………………………………………………………….277 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………….283 TABLE DES MATIERES………………………………………………293 TABLE DES FIGURES Graphique 1 : Le Cycle International de production industrielle ………………..…………………………p. 80 Graphique 2 : La part de l’Afrique subsaharienne dans les exportations mondiales de produits agricoles de 1980 à 1998 .……….….... p. 125 Graphique 3 : Répartition de l’investissement direct étranger vers les pays en développement de 1990 à 1994 ...………….……………………... p. 157 Graphique 4 : Tendance de réduction de la pauvreté à travers le monde ……………………………….. p. 160 Graphique 5 : Prévision du nombre de pauvres pour 2015 …………..……………………………………. p. 164 Graphique 6 : Evolution probable des indicateurs du projet de formation et encadrement des pionniers ……………………………………....p. 224 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : L’importance économique de la coopération en Europe en 1998 ……….…………………………... p. 60 Tableau 2 : La part de l’Afrique subsaharienne dans les exportations mondiales des produits agricoles de 1980 à 1998 …...….…………………. p. 125 Tableau 3 : Tendance actuelle et prévue de réduction de la pauvreté à travers le monde d’ici 2015 ….… p. 160 Tableau 4 : Projet de formation et encadrement des pionniers en vue de la prolifération des coopératives …………………………………...……. p. 223 Adresse mail : albertlutete @ yahoo.fr"
Edition Notes
"Juillet 2007."
Includes bibliographical references (p. [283]-292).
Adresse mail : albertlutete @ yahoo.fr
Classifications
Contributors
The Physical Object
Edition Identifiers
Work Identifiers
Community Reviews (0)
| December 20, 2020 | Edited by MARC Bot | import existing book |
| April 3, 2017 | Edited by Charles Horn | Update covers |
| November 16, 2016 | Edited by FSRC | Added new cover |
| November 16, 2016 | Edited by FSRC | Added new cover |
| December 11, 2009 | Created by WorkBot | add works page |










